À diverses époques, des auteurs chrétiens, prenant au pied de la lettre le commandement biblique «Tu ne tueras pas», et surtout les textes évangéliques -invitation à « tendre l’autre joue» (Mt 5,39) et à «aimer ses ennemis», etc.- ont enseigné qu’un disciple de Jésus ne peut porter atteinte à la vie de qui que ce soit, y compris celle de ses ennemis: il ne peut donc en aucun cas recourir à la violence meurtrière, même pour se défendre. Cette position, majoritaire jusqu’au IIIe siècle, puis devenue très minoritaire, a été remise à l’honneur au XXe siècle.
Réfléchissant sur l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de libération, ses partisans ont réalisé qu’il est vain de «condamner la violence» sans proposer des alternatives crédibles aux défis posés par les actes d’agression ou les situations d’injustice structurelle. Se démarquant d’une lecture fondamentaliste du Sermon sur la montagne, tirant les leçons des combats menés par Gandhi, Martin Luther King et d’autres, ces chrétiens récusent alors le mot pacifisme, lui préférant celui de non-violence.
La résistance non-violente
Le concile Vatican II, prenant acte de ce changement de perspective, encourage dans la constitution Gaudium et Spes de 1965, mais dans une formule alambiquée qui évite le mot «non-violence», «ceux qui, renonçant à l’action violente pour la sauvegarde des droits, recourent à des moyens de défense qui, par ailleurs, sont à la portée même des plus faibles, pourvu que cela puisse se faire sans nuire aux droits et aux devoirs des autres ou de la communauté» (GS 78,5). Le mot cependant apparaît dès 1971 dans l’exhortation apostolique Justitia in Mundo de Paul VI: «Il est absolument nécessaire que les différends entre nations ne soient pas résolus par la guerre, mais que (…) soit favorisée en outre l’action non-violente…» (JM 68).
«Depuis 1945, la diplomatie des grandes puissances occidentales a été dominée par la leçon qu’on croyait tirer des événements qui conduisirent à la Seconde Guerre mondiale, à savoir que, lorsqu’on est en face d’un adversaire dépourvu de scrupules et déterminé à atteindre par n’importe quel moyen des objectifs impérialistes, on ne le convertit pas à la paix, mais on aiguise son appétit en lui faisant des concessions. (…) Un pays a le droit et même le devoir de se tenir prêt (…) Mais la sagesse demande davantage. D’abord, il ne faut pas s’armer de telle manière que l’adversaire éventuel prenne peur et soit tenté de passer à l’attaque préventive. (…) Il importe de se rappeler que, lorsque deux adversaires sont face à face, la sécurité militaire de l’un est l’insécurité de l’autre.» Daniel Marrald, «Psychologie et politique de la paix», in choisir n° 104, juin 1968, p. 9
L’instruction Liberté chrétienne et libération, publiée en 1986 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, confirme ce soutien, même si elle utilise l’expression -moins adéquate- de «résistance passive» pour désigner la résistance non-violente. Dans les décennies 70 et 80, de nombreux chrétiens d’Amérique latine, encouragés par plusieurs évêques -notamment Dom Helder Camara- recourent à l’action non-violente pour défendre les droits de l’homme bafoués par les dictatures militaires. En février 1986, l’épiscopat des Philippines la préconise et l’organise à l’échelle de la ville de Manille pour faire tomber le régime du dictateur Marcos. Jean-Paul II en fait souvent l’éloge, soulignant son enracinement biblique, par exemple dans son discours aux jeunes de Maseru (Lesotho) le 15 septembre 1988: «Certains peuvent vous dire que le choix de la non-violence est une acceptation passive des situations d’injustice. (…) Rien n’est plus loin de la vérité. (…) C’est une recherche active à ‹être vainqueur du mal par le bien›, ce à quoi saint Paul nous incite.»
La «guerre juste»
Qu’en est-il par contre de la résistance par les armes? Argumentée déjà par Aristote et Cicéron, la « doctrine de la guerre juste » a été développée par des auteurs chrétiens, d’Augustin à Vitoria en passant par Thomas d’Aquin. Elle consiste en un ensemble de critères pour juger dans quels cas il est moralement permis de recourir aux armes (jus ad bellum) et quelles limites on doit respecter dans cet usage des armes (jus in bello). Ces réflexions ont nourri l’élaboration du Droit international de la guerre. Cependant, si pour les moralistes catholiques la conformité d’une décision avec ce Droit est très importante, elle n’est pas décisive: il peut arriver qu’une décision prise par un pouvoir légitime et en conformité avec le Droit ne soit pas moralement juste et, inversement, qu’on puisse juger légitime un recours aux armes non autorisé par le Droit international. Pour l’Église, d’autres conditions, qui doivent toutes être réunies, entrent en ligne de compte.
Tout d’abord la juste cause. De nos jours, il n’y a plus qu’une seule «juste cause» retenue, celle de la «légitime défense»: «On ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense» (GS 79,4). L’Église admet aussi qu’un peuple gravement opprimé par un pouvoir tyrannique puisse légitimement recourir aux armes pour se libérer du tyran. Le cas est évoqué en 1967 par Paul VI, mais comme une exception: «…sauf le cas de tyrannie évidente et prolongée qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et nuirait dangereusement au bien commun du pays» (encyclique Populorum Progressio 31).
Les conflits armés des années 1990 ont conduit les autorités de l’Église à poser de nouvelles questions sur la notion de «légitime défense»: s’agit-il seulement d’autodéfense ou aussi de la défense d’un tiers injustement agressé? Sur cette question -vivement débattue sous le nom de «devoir d’ingérence», rebaptisé «responsabilité de protéger» par l’ONU -Jean Paul II prend clairement position. Ainsi en 1993 à propos du conflit bosniaque: «Une fois que toutes les possibilités offertes par les négociations diplomatiques, les processus prévus par les conventions et organisations internationales ont été mis en œuvre, et que malgré cela des populations sont en train de succomber sous les coups d’un injuste agresseur, les États n’ont plus le ‹droit à l’indifférence›. Il semble bien que leur devoir soit de désarmer cet agresseur, si tous les autres moyens se sont avérés inefficaces (…) Les principes de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans leurs affaires internes -qui gardent toute leur valeur- ne sauraient constituer un paravent derrière lequel on pourrait torturer et assassiner. »[1]
La formule «désarmer l’agresseur» fixe ici une limite stricte: dès que l’agresseur est désarmé (et donc «hors d’état de nuire»), plus rien ne justifie la poursuite de l’action militaire; on ne saurait profiter de celle-ci pour viser d’autres objectifs, comme abattre un régime totalitaire, saisir des territoires ou des ressources, étendre une zone d’influence, etc. Ce critère «d’intention droite», rarement invoqué, est difficile à vérifier et à respecter. La guerre déclenchée en 2003 par l’administration Bush contre l’Irak a donné l’occasion de préciser une autre limite du principe de légitime défense: il ne saurait légitimer une «guerre préventive».
Un autre critère important est celui de l’ultime recours: aucun usage des armes n’est légitime s’il existe un autre moyen, non meurtrier, de désarmer l’agresseur. Mais comment être sûr que toutes les possibilités de règlement pacifique sont épuisées?
Proportionnalité et espérance de succès
Vient ensuite la notion de proportionnalité: le remède ne doit pas être pire que le mal. Il peut donc arriver, comme l’a déclaré Pie XII, qu’on ait l’«obligation de subir l’injustice».[2] Jean-Paul II s’y est aussi référé devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, à propos de la première guerre du Golfe. Soulignant qu’une guerre serait «particulièrement meurtrière, sans compter ses conséquences écologiques, politiques, économiques et stratégiques», il a rappelé que «le recours à la force pour une cause juste n’est admissible que si celui-ci est proportionnel au résultat que l’on veut obtenir et en soupesant bien les conséquences de l’action militaire». Ce principe joue un rôle essentiel dans la condamnation par le Concile de tout recours aux «armes de destruction massive», même en cas de légitime défense.[3]
«On peut encore conduire une démocratie à la guerre en cette fin de siècle. Aux États-Unis, personne n’imaginait que le syndrome vietnamien serait surmontable. (…) La question ‹aurait-on pu faire autrement ?› doit rester sous-jacente. (…) Certes, on ne pouvait savoir à l’avance comment se comporterait l’armée de Bagdad, ni qu’à l’heure de vérité les Irakiens s’écrouleraient de manière calamiteuse. (…) S’est-on vraiment préoccupé du droit dans le cas du Koweït ou davantage de l’ordre, pétrolier en particulier, et de son rétablissement ? Faut-il rétablir un peuple dans ses droits et refuser si promptement l’évocation du précédent quand il s’agit d’un autre peuple, que ce soit le palestinien ou le kurde ? (…) S’il est vrai que la coalition a réussi pour ainsi dire à vaincre sans coup férir, les dizaines de milliers de morts irakiens et les destructions de l’Irak, les dégâts écologiques et climatiques, l’état du pays et de la région après-coup, bref tout ce qui fait le coût si problématique d’une guerre, ont pratiquement été passé sous silence.» Antoine Maurice, «Les énigmes de la guerre du Golfe», in choisir n° 377, mai 1991, pp. 22-28
Un autre critère vise à interdire les «guerres privées». Il s’agit de l’autorité légitime, qui reconnaît aux seuls détenteurs de l’autorité légitime, en tant que garants du «bien commun», le droit de décider de recourir aux armes. C’est aux gouvernements que Gaudium et Spes reconnaît le droit de légitime défense, mais le Concile précise aussitôt que cela vaut «aussi longtemps (…) qu’il n’y aura pas d’autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes» (GS 79,4). L’ONU peut-elle être identifiée, dans son état actuel, à cette «autorité publique de compétence universelle»? C’est bien son contournement par l’administration Bush en 2003 qui a notamment mené Jean-Paul II à condamner l’initiative américaine.
Enfin, l’espérance de succès: la décision de recourir aux armes n’est moralement juste que si l’on a de sérieuses raisons de penser qu’elle mènera au désarmement de l’agresseur. Les textes contemporains de l’Église n’évoquent plus guère ce principe de sagesse, mais un document publié en 2000 par la Conférence des évêques de France s’y réfère pourtant, pour réfuter l’opinion selon laquelle les interventions extérieures seraient immorales du fait qu’elles visent à sauver certains et pas d’autres (argument du «deux poids, deux mesures»: on sauve les Kosovars, mais on abandonne les Tibétains à leur oppresseur). «L’évaluation éthique, peut-on y lire, doit tenir compte du ‹succès prévisible› des opérations. Ce n’est pas du cynisme. Le vieil adage à l’impossible nul n’est tenu n’est pas seulement de la Realpolitik, c’est aussi un principe éthique. Le mépriser serait propager une idée dangereuse: il faudrait toujours faire quelque chose ‹pour le principe› même dans les cas où le rapport des forces en présence laisse prévoir qu’il n’existe aucune chance de soustraire les victimes à leurs bourreaux par la force armée.»[4]
Respecter la discrimination
 Une fois justifié le principe d’une intervention armée, reste à délimiter ce qui est permis ou non dans l’usage des armes (jus in bello). Toute l’élaboration du Droit international de la guerre se fonde sur la distinction entre «acte de guerre» et «crime de guerre». Cette réflexion intègre surtout l’exigence de discrimination [n.d.l.r. : dans le sens de distinguer]. Il importe de ne pas faire de victimes «inutiles», et donc de «discriminer» entre combattants et non-combattants. Ce principe est intégré dans les règlements des forces armées de presque tous les États modernes et se trouve au cœur des réflexions contemporaines, religieuses ou non, sur l’éthique de la guerre.
Une fois justifié le principe d’une intervention armée, reste à délimiter ce qui est permis ou non dans l’usage des armes (jus in bello). Toute l’élaboration du Droit international de la guerre se fonde sur la distinction entre «acte de guerre» et «crime de guerre». Cette réflexion intègre surtout l’exigence de discrimination [n.d.l.r. : dans le sens de distinguer]. Il importe de ne pas faire de victimes «inutiles», et donc de «discriminer» entre combattants et non-combattants. Ce principe est intégré dans les règlements des forces armées de presque tous les États modernes et se trouve au cœur des réflexions contemporaines, religieuses ou non, sur l’éthique de la guerre.
Son fondement est simple: si on admet que le respect de toute vie humaine est une exigence fondamentale de toute éthique, il importe que les exceptions que l’on est amené à faire soient les moins nombreuses possible. Ne peuvent donc être visées intentionnellement que les personnes qu’il importe de «mettre hors de combat» pour parvenir à faire cesser l’agression, le génocide, le massacre ou la purification ethnique dont elles sont les agents. Toutes les autres sont «innocentes», au sens étymologique du terme: elles ne «nuisent» pas, puisqu’elles ne jouent aucun rôle dans l’agression à faire cesser.
Ce principe est invoqué très souvent dans les textes de l’Église, notamment dans Gaudium et Spes. Pour le Concile, cette limite est impérative. Si l’on commet, pour se défendre, des actes portant atteinte délibérément à des non-combattants, il ne s’agit plus d’actes de guerre mais de «crimes de guerre». Le refus d’obéissance devient alors un devoir moral: «On ne saurait trop louer le courage de ceux qui ne craignent point de résister ouvertement aux individus qui ordonnent de tels forfaits» (GS 79,2). L’Église fait ainsi sienne la «jurisprudence Nuremberg»: quand un exécutant reçoit l’ordre de commettre des actes criminels, il ne peut dégager sa responsabilité en prétextant qu’il a seulement «obéi aux ordres» d’un supérieur. Cela concerne au premier chef, évidemment, la stratégie dite «anti-cités», que le Concile condamne avec une solennité particulière: «Ce saint synode déclare: tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation» (GS 80,4). Ce jugement porte rétrospectivement aussi bien sur les destructions des populations civiles de Dresde, Hambourg ou Tokyo que d’Hiroshima et Nagasaki.
Respecter ce principe de discrimination ne va pas de soi en un temps où les conflits armés opposent souvent des armées régulières à des guérillas ou à des milices, dont les combattants se distinguent mal des populations non-combattantes. En outre, la puissance militaire d’un pays dépend, beaucoup plus qu’hier, de multiples facteurs qui s’imbriquent dans l’activité civile ordinaire: recherches, communications, capacités de production, etc. Ces réalités, qui rendent moins nette qu’hier la frontière entre combattants et non-combattants, ne peuvent être ignorées par le jugement moral : ce n’est pas parce que cette frontière est devenue floue qu’elle n’existe plus.
«Un esprit entièrement nouveau»?
Ce parcours à travers l’utilisation par les autorités catholiques contemporaines des critères de la «guerre juste» montre qu’elles considèrent toujours comme pertinent –du moins jusqu’à l’avènement du pape François- l’appareil conceptuel élaboré au long des siècles sous ce nom. On peut donc s’interroger sur le sens de la formule du Concile invitant à «reconsidérer la guerre dans un esprit entièrement nouveau» (GS 80,2). En quoi consiste la nouveauté?
En fait, ce qui semble «radicalement nouveau» c’est que l’Église, sans abandonner ses vieux critères, en propose désormais une application si stricte que les cas où un recours aux armes y satisfait tous deviennent rarissimes. L’«esprit nouveau» consiste donc à donner au pôle limitation la nette prééminence (qu’il aurait toujours dû avoir) sur le pôle légitimation -une conscience chrétienne ne peut « légitimer» une activité aussi contraire à l’Évangile que si cette légitimation est accordée dans les circonstances très exceptionnelles définies par le Jus ad bellum.
Autre manifestation de cet «esprit entièrement nouveau»: la désuétude de l’expression «guerre juste», qui a presque disparu du discours catholique officiel. Pour les Pères conciliaires, il ne s’agit plus de se contenter d’humaniser la guerre, il faut viser son éradication. Dans la phrase où il reconnaît le droit de légitime défense, le Concile introduit une incise qui peut sembler anodine: «aussi longtemps que le risque de guerre subsistera». En fait, ces mots refusent l’idée que la guerre serait tellement inhérente à la nature humaine qu’on ne pourrait que la réguler. Voilà pourquoi on ne peut plus accoler au substantif «guerre» l’adjectif «juste», qui évoque quelque chose de positif: la guerre est un mal, parfois encore un «moindre mal», mais toujours un mal.
Quelles sont les raisons d’un tel changement? Sans doute d’abord l’avènement, depuis plus d’un siècle, de la «guerre totale», celle qui implique l’ensemble d’une société et non plus les seuls militaires et qui met donc à mal les principes de proportionnalité et de discrimination. Le développement des armes de destruction massive, notamment nucléaires, a fortement accentué cette prise de conscience.
La position du pape François
Cet «esprit entièrement nouveau» s’exprime plus nettement encore depuis l’avènement du pape François. À diverses reprises, il a condamné le recours à la violence armée comme réponse à la violence. Ainsi il déclare, dans son message du 1er janvier 2017, qu’un tel recours «conduit, dans la meilleure des hypothèses, à des migrations forcées et à d’effroyables souffrances, puisque d’importantes quantités de ressources sont destinées à des fins militaires et soustraites aux exigences quotidiennes des jeunes, des familles en difficulté, des personnes âgées, des malades, de la grande majorité des habitants du monde. Dans le pire des cas, il peut conduire à la mort, physique et spirituelle, de beaucoup, voire de tous.» Dans son message urbi et orbi de Pâques 2021, il emploie l’adjectif «scandaleux» à propos des conflits armés qui ne cessent pas et des arsenaux militaires qui se renforcent. Et dans son encyclique Fratelli tutti (2020, ch. 7), il aborde en ces termes la question de la «guerre juste»: «Il est très difficile aujourd’hui de défendre les critères rationnels, mûris en d’autres temps, pour parler d’une possible ‹guerre juste›.»
S’agit-il d’une rupture avec ce que disaient ses prédécesseurs? Il convient de peser exactement les mots du pape François: il juge qu’il est «très difficile» de défendre les «critères rationnels», mais il n’écrit pas «impossible». Un tel mot équivaudrait, en toute logique, à déclarer qu’aucun usage des armes n’est jamais permis (même en cas de résistance à une agression armée ou d’intervention visant à interrompre un génocide) et que, par conséquent, le métier militaire est incompatible avec l’éthique chrétienne. Le pape ne va pas jusque-là mais fait un pas de plus dans l’évolution décrite ci-dessus: plus les «critères rationnels» sont difficiles à respecter, plus rares -voire exceptionnelles- sont les situations justifiant qu’on recoure à la violence des armes.
[1] La Documentation catholique, n° 2066, février 1993, p. 157.
[2] Pie XII, dans une allocution à des médecins militaires. Voir Documentation catholique, Paris 1953, col 1413.
[3] Voir Christian Mellon, «Nucléaire: la dissuasion n’est plus ce qu’elle était», in choisir n° 316, avril 1986, pp. 24-27, et Dissuasion nucléaire, 25 novembre 2019, in doctrine-sociale-catholique.fr (n.d.l.r.).
[4] Justice et Paix-France, «Dossier de réflexion sur les interventions militaires extérieures», in Documents-Épiscopat, 8 mai 2000, p. 10.
Interrogé au sujet de la vente d’armes à l’Ukraine, lors de la conférence de presse donnée le 15 septembre 2022 dans l’avion qui le ramenait du Kazakhstan, le pape François a réitéré sa position. «C’est une décision politique qui peut être morale si les conditions sont réunies. (…) Cela peut être immoral si c’est fait avec l’intention de provoquer plus de guerre ou de vendre plus d’armes ou de se débarrasser des armes qui ne servent plus. La motivation est ce qui qualifie en grande partie la moralité ou non de cet acte.»


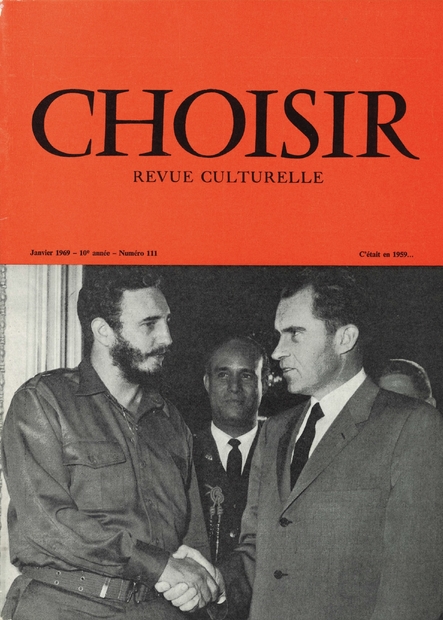 Est-il permis de faire la guerre dans certaines circonstances? Les réponses peuvent être classées en quatre catégories: le pacifisme -la guerre n’est jamais permise; la guerre juste -elle est légitime dans certains cas et limites; le cynisme -la morale n’a rien à dire en ce domaine; la guerre sainte -elle est permise si c’est sur l’ordre de Dieu ou de ses représentants. La réponse de l’Église s’inscrit dans la deuxième, mais intègre aussi des références de la première.
Est-il permis de faire la guerre dans certaines circonstances? Les réponses peuvent être classées en quatre catégories: le pacifisme -la guerre n’est jamais permise; la guerre juste -elle est légitime dans certains cas et limites; le cynisme -la morale n’a rien à dire en ce domaine; la guerre sainte -elle est permise si c’est sur l’ordre de Dieu ou de ses représentants. La réponse de l’Église s’inscrit dans la deuxième, mais intègre aussi des références de la première.