
Ethique
L’éthique serait-elle devenue une appellation fourre-tout, à l’élasticité commode, qui s’adapterait à l’évolution des mœurs et aux intérêts particuliers? Au contraire de la morale religieuse qui, elle, se référerait à des principes universels? Ce qui expliquerait l'engouement de notre revue pour l’éthique, les jésuites étant des «champions» du discernement …et donc, selon certains, du relativisme? Décryptage de ces raccourcis saisissants avec Rémi Brague, président de l’ASMP.[1]
Membre de l’Institut de France, Rémi Brague enseigne la philosophie grecque et arabe à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a reçu le Grand prix de philosophie de l’Académie française en 2009 et le prix Ratzinger en 2012. Parmi ses ouvrages, citons La sagesse du monde… (2002), La Loi de Dieu… (2008) et Le règne de l’homme… (2015).
 La traite des êtres humains est, après le trafic d’armes, l’un des marchés les plus profitables au niveau international. Le développement des technologies de l’internet a contribué à l’essor de ses territoires de recrutement et d’exploitation. Chaque pays est devenu un lieu d’origine, de transit et de destination de ce trafic. Une marchandisation des personnes qui trouve son origine dans notre «culture du déchet» et notre système économique.
La traite des êtres humains est, après le trafic d’armes, l’un des marchés les plus profitables au niveau international. Le développement des technologies de l’internet a contribué à l’essor de ses territoires de recrutement et d’exploitation. Chaque pays est devenu un lieu d’origine, de transit et de destination de ce trafic. Une marchandisation des personnes qui trouve son origine dans notre «culture du déchet» et notre système économique.
On ne cesse, en Occident, d’évoquer la notion de dignité de la personne. Cette notion n’est pas sans receler quelque ambiguïté. La dignité est-elle intrinsèque à la personne ou doit-elle être acquise à force de performance et de raison, ce qui exclurait les plus vulnérables d’entre nous?
Bernard N. Schumacher dirige le pôle de recherche et d’enseignement «Vieillissement, éthique et droit» à l’Institut interdisciplinaire d’éthique et de droits de l’homme de Fribourg, dont il est le coordinateur. Il est l’auteur de L’éthique de la dépendance face au corps vulnérable (érès 2019).
 Depuis le philosophe taoïste Tchouang-Tseu (IVe siècle av. J.-C.), si ce n’est depuis que le monde est monde, l’humanité a pris conscience d’un fait curieux: chacun ressent une certaine consolation à s’occuper d’autrui. Cette consolation est d’autant plus forte que l’acte altruiste se veut efficace. Dans son manuel de Philosophie morale, Éric Weil souligne que l’altruisme tend à devenir un «égoïsme de transfert»[1]. Au fond, pourquoi pas?
Depuis le philosophe taoïste Tchouang-Tseu (IVe siècle av. J.-C.), si ce n’est depuis que le monde est monde, l’humanité a pris conscience d’un fait curieux: chacun ressent une certaine consolation à s’occuper d’autrui. Cette consolation est d’autant plus forte que l’acte altruiste se veut efficace. Dans son manuel de Philosophie morale, Éric Weil souligne que l’altruisme tend à devenir un «égoïsme de transfert»[1]. Au fond, pourquoi pas?
 Né à la fin des années 2000 dans les pays anglo-saxons,[1] le mouvement de l’altruisme efficace part de l’idée qu’œuvrer au bien-être des autres via des dons en temps ou en argent est facteur d’épanouissement pour tous … mais que cela exige, pour être vraiment efficient, un discernement en amont. Le philosophe australien Peter Singer, l’un des fers de lance du concept, en explique ici les grandes lignes.
Né à la fin des années 2000 dans les pays anglo-saxons,[1] le mouvement de l’altruisme efficace part de l’idée qu’œuvrer au bien-être des autres via des dons en temps ou en argent est facteur d’épanouissement pour tous … mais que cela exige, pour être vraiment efficient, un discernement en amont. Le philosophe australien Peter Singer, l’un des fers de lance du concept, en explique ici les grandes lignes.
 Le gouvernement doit-il forcer la population à se faire vacciner? Les personnes vaccinées doivent-elles bénéficier d’avantages? Autant de question éthiques qui secouent la société en ce moment. Stève Bobillier, collaborateur scientifique de la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses (CES), apporte de précieuses clarifications et nuances.
Le gouvernement doit-il forcer la population à se faire vacciner? Les personnes vaccinées doivent-elles bénéficier d’avantages? Autant de question éthiques qui secouent la société en ce moment. Stève Bobillier, collaborateur scientifique de la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses (CES), apporte de précieuses clarifications et nuances.
 Vaccinera, vaccinera pas? La question est sur toutes les lèvres. Le temps est peut-être arrivé où la couverture vaccinale se heurte à un plafond de refus et d’indécision. La pesée des intérêts est mise en avant par les autorités pour inciter les citoyens à passer par la case piqûre, mais la possibilité d’une vaccination altruiste commence aussi, timidement, à se frayer un chemin dans le discours.
Vaccinera, vaccinera pas? La question est sur toutes les lèvres. Le temps est peut-être arrivé où la couverture vaccinale se heurte à un plafond de refus et d’indécision. La pesée des intérêts est mise en avant par les autorités pour inciter les citoyens à passer par la case piqûre, mais la possibilité d’une vaccination altruiste commence aussi, timidement, à se frayer un chemin dans le discours.
 La Commission nationale suisse Justice et Paix a examiné en détail les demandes et propositions de l’initiative pour l’eau potable et de l’initiative contre les pesticides sur lesquelles le peuple suisse est appelé à voter le 13 juin 2021. Les demandes de ces deux initiatives en lien avec la politique agricole suisse sont justifiées sur le plan éthique, dit-elle, car «il faut indéniablement agir». La commission apporte toutefois des nuances et juge l’initiative sur les pesticides mieux ficelée que sa sœur ainé.
La Commission nationale suisse Justice et Paix a examiné en détail les demandes et propositions de l’initiative pour l’eau potable et de l’initiative contre les pesticides sur lesquelles le peuple suisse est appelé à voter le 13 juin 2021. Les demandes de ces deux initiatives en lien avec la politique agricole suisse sont justifiées sur le plan éthique, dit-elle, car «il faut indéniablement agir». La commission apporte toutefois des nuances et juge l’initiative sur les pesticides mieux ficelée que sa sœur ainé.
Plus...
 Le Conseil national suisse a approuvé le 5 mai 2021 l’initiative et le contre-projet favorisant le système du consentement présumé en matière de don d’organes, une idée généreuse de prime abord, visant à prévenir le manque récurrent d’organes à greffer. La commission de bioéthique (CBCES) propose une troisième voie, celle du système de «déclaration volontaire».
Le Conseil national suisse a approuvé le 5 mai 2021 l’initiative et le contre-projet favorisant le système du consentement présumé en matière de don d’organes, une idée généreuse de prime abord, visant à prévenir le manque récurrent d’organes à greffer. La commission de bioéthique (CBCES) propose une troisième voie, celle du système de «déclaration volontaire».
 Le théologien Pierre Bühler, contributeur régulier de la revue Vivre Ensemble, livre une analyse fine de la gestion de la crise sanitaire vis-à-vis des populations de personnes exilées. À la lumière de l'actualité des dernières semaines sur les îles grecques, évoquant le manque de sauvetage en Méditerranée et le maintien des procédures d’asile en Suisse, il interroge les notions d’éthique et de morale. La déontologie est-elle sacrifiée aux diverses finalités politiques?
Le théologien Pierre Bühler, contributeur régulier de la revue Vivre Ensemble, livre une analyse fine de la gestion de la crise sanitaire vis-à-vis des populations de personnes exilées. À la lumière de l'actualité des dernières semaines sur les îles grecques, évoquant le manque de sauvetage en Méditerranée et le maintien des procédures d’asile en Suisse, il interroge les notions d’éthique et de morale. La déontologie est-elle sacrifiée aux diverses finalités politiques?
 Difficile de faire un geste dans le monde numérique sans croiser un appel à la «confiance». Les entreprises du numérique déploient des trésors de rhétorique pour se présenter comme dignes de confiance. Dans cet exercice, il n’est pas toujours facile de dépasser le slogan, tant la confiance ressemble à un mot-valise capable de mettre tout le monde d’accord. Mais en grattant un peu, cette valise apparaît bien légère. Pour repartir sur de bonnes bases, posons la question que personne n’aborde vraiment: qu’est-ce que la confiance?
Difficile de faire un geste dans le monde numérique sans croiser un appel à la «confiance». Les entreprises du numérique déploient des trésors de rhétorique pour se présenter comme dignes de confiance. Dans cet exercice, il n’est pas toujours facile de dépasser le slogan, tant la confiance ressemble à un mot-valise capable de mettre tout le monde d’accord. Mais en grattant un peu, cette valise apparaît bien légère. Pour repartir sur de bonnes bases, posons la question que personne n’aborde vraiment: qu’est-ce que la confiance?
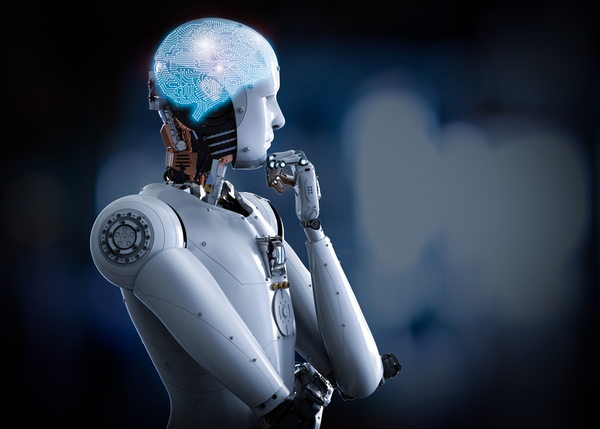 Les changements provoqués par l’intelligence artificielle (IA) affectent la façon dont l’homme perçoit la réalité et la nature humaine elle-même. La recherche en IA doit aujourd’hui s’assurer que cette technologie soit mise au service de la «famille humaine» et pour cela certains critères doivent être pris en compte et fixés par la loi. Tel est le sens de l’Appel de Rome pour une éthique de l’IA, signé au Vatican le 28 février par des experts. L’objectif est de guider toute évolution future du secteur.
Les changements provoqués par l’intelligence artificielle (IA) affectent la façon dont l’homme perçoit la réalité et la nature humaine elle-même. La recherche en IA doit aujourd’hui s’assurer que cette technologie soit mise au service de la «famille humaine» et pour cela certains critères doivent être pris en compte et fixés par la loi. Tel est le sens de l’Appel de Rome pour une éthique de l’IA, signé au Vatican le 28 février par des experts. L’objectif est de guider toute évolution future du secteur.
