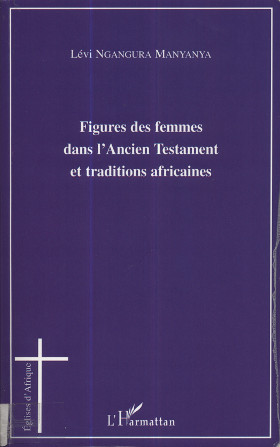 Lévi Ngangura Manyanya, Figures de femmes dans l'Ancien testament et traditions africaines, Paris, Harmatan 2011, 288 p
Lévi Ngangura Manyanya, Figures de femmes dans l'Ancien testament et traditions africaines, Paris, Harmatan 2011, 288 p
Lévi Ngangura Manyanya est pasteur et professeur de théologie. Son nouvel ouvrage retrace divers portraits de femmes dans l'Ancien Testament et relate les péripéties des vies qu'elles ont menées et leur influence. Il y a en effet une présence massive et remarquable des femmes dans la littérature biblique. Pour l'auteur, l'Ancien Testament n'est donc pas seulement une histoire d'hommes qui entretiennent des relations privilégiées avec Dieu. Les femmes y jouent, du début à la fin, un rôle très important. Sans elles, l'histoire du Salut ne se serait pas réalisée.
Ngangura commence par tracer les portraits des matriarches, ces mères de tous les peuples, passionnées et rusées, qui cherchent par tous les moyens à avoir une descendance pour perpétuer l'histoire des clans. Il en répertorie onze : Sara, Hagar et Qeturah (femmes d'Abraham, Gn 16-17 ; 20-23 ; 25,1-6), Rébecca (femme d'Isaac, Gn 24,25-27), Léa, Rachel, Bilha et Zilpa (épouses de Jacob, Gn 29,31-30,24), Asnat (fille de Poti-Phéra, Gn 41,45-50) et enfin les deux filles de Lot (Gn 19,30-38). L'auteur s'intéresse particulièrement à Rébecca, Léa et Rachel, présentées comme des personnages aux multiples facettes. Rébecca, par exemple, n'est pas seulement une femme au foyer qui se comporte bien, mais elle est aussi une mère qui orchestre tout pour ses enfants.
Ngangura analyse ensuite les figures des femmes prophétesses, porte-parole du Seigneur. La manière dont elles interviennent dans la transmission de la parole et la conquête de la sagesse montre que le Seigneur ne s'adresse pas à elles en raison de leur fonction procréatrice, mais parce qu'elles sont capables d'accomplir la mission qui leur a été confiée.
Ainsi des sages-femmes qui rejettent l'ordre cruel de Pharaon de tuer tous les nouveau-nés hébreux, alors qu'aucun personnage masculin n'ose résister ; de Myriam, soeur de Moïse et d'Aaron, qui s'oppose au Pharaon en gardant son frère (ce dernier deviendra le libérateur d'Israël) ; de Déborah, qui fait partie des Juges et dont la principale fonction est de gouverner le peuple d'Israël et de rendre justice ; de Houlda, une prophétesse authentique au jugement responsable, qui a joué un grand rôle dans la tradition juive. On comptera aussi deux femmes influentes dont les noms ne sont pas donnés (2 S 14,1-20 ; 2 S 20,14-22) et Abigayl, prophétesse et médiatrice, qui prédit la fondation de la dynastie éternelle de David et sa victoire plus large sur ses ennemis. Elle fit éviter un affrontement sanglant entre Nabal, son mari, homme riche et brutal de la tribu de Juda, et David qui, après la mort mystérieuse de Nabal, l'épousera.
Droits et intrigues
Une autre partie de l'ouvrage est consacrée aux femmes « hors âges », qui ne se laissent pas décourager, même dans des situations familiales très difficiles, comme les critiques visant leur stérilité, considérée comme une fatalité. Qu'il s'agisse d'Anne (1 S 1), de Ruth (Rt), des filles de Çelophehad (Nb 27,1-11), de la veuve de Sarepta (1 R 17,8-24) ou de la petite israélite qui sauve Naaman, un général syrien (2 R 5,1-19), toutes ont compris qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent intervenir pour les faire valoir. C'est en usant de leurs droits que les filles de Çelophehad réussissent à obtenir de Moïse et de Dieu une propriété foncière, héritage laissé par leur père défunt.
L'auteur étudie aussi l'histoire des intrigantes ou de filles des rois qui ont joué un rôle particulier à la cour royale, jusqu'à changer le point de vue des puissants et même à manipuler la course à la succession au trône. Parmi les plus influentes : Mikal (1 S 19 ; 2 S 6), Abishag (1R 1,1-4), Bethsabée (1R 1,5-53 ; 2 S 11), la reine de Saba (1 R 10), Asthalie (2 R 8,16-19 ; 11,1-21 ; 2 Ch 22, 10-23,21) et Jézabel (1 R 21 et 2 R 9). Le récit de Mikal, fille du très puissant roi Saül et femme de David, montre que l'amour d'une femme pour son mari peut se montrer plus fort que l'attachement à son père. Et s'agissant de la reine de Saba, Ngangura s'étend beaucoup sur les démarches qu'elle a entreprises pour accéder au palais de Salomon, dont elle va tester la sagesse. Sa présence au palais royal peut être vue comme un signe de l'universalisme du Salut.
Tout en sachant que de nombreuses femmes étaient très vaillantes, notre auteur montre que certaines d'entre elles ont subi des violences physiques ou des agressions, souvent causées par l'entourage. Ce qui surprend, c'est la figure des victimes, qui sont parfois très connues : Sara, Rébecca, Hagar, les filles de Lot, Dina (Gn 34), Aksah (Jg 12-15 ; Jos 15,16-17)... Ce sont les maris ou d'autres membres de leurs familles qui sont les auteurs des violences ou qui les livrent aux rois étrangers.[1]
Au-delà des sexes
Le principal thème développé par l'auteur est celui de la relation qui existe entre l'homme et la femme dès leur création. Dieu a créé Adam, un être humain pris dans son acception générale et non pas défini par rapport à son appartenance ethnique, sexuelle ou religieuse. Cet être humain - l'homme et la femme - a été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que l'homme et la femme se doivent un respect mutuel, car leur relation a été voulue très forte par Dieu depuis les origines.
Il faut donc écarter les idées toutes faites sur la répartition de responsabilités en fonction du sexe. Si l'homme et la femme se savent différents, « cette différence ne devrait pas aboutir à une mise en valeur d'un sexe au détriment d'un autre », car tous les deux sont égaux en dignité. Il est par conséquent inadmissible d'exclure les femmes de certaines fonctions au nom des critères sexuels, que ce soit dans l'Eglise ou dans la société en général.
Ngangura insiste sur le fait que Dieu lui-même ne peut pas être réduit à une image de divinité mâle ou femelle. D'ailleurs la Bible présente Dieu avec des traits masculins et féminins. Ainsi le Seigneur apparaît comme le sein maternel ou l'utérus (Ex 34,6 ; Ps 86,15 ; 103 ; Jon 4,2 ; Ne 9,31), comme le père (Dt 32,6) ou la mère d'Israël (Nb 11,12), comme une femme (Es 49,15), etc. De cette manière, « le discours sur Dieu se trouve dans une tension où des traits féminins apparaissent en dialectique avec des traits masculins ».
Il faut donc écarter toute tentative de vouloir renfermer Dieu dans le masculin ou le féminin. Si les Israélites ont parlé d'un Dieu qu'ils prennent pour un père ou un roi, c'est parce que leur société était patriarcale. Mais ce Dieu-là est au-delà de tout ce que les hommes font ou sont.
Ngangura a fait un travail immense, propre à intéresser non seulement des étudiants ou des féministes, mais aussi toute personne ayant envie d'approfondir sa culture biblique. Toutefois, pour lire cet ouvrage, le lecteur doit se munir de sa Bible. Et la lecture devient très vite ennuyeuse pour une personne non avertie. De plus, en dehors de quelques passages superficiels, Ngangura ne fait pas référence aux traditions africaines, pourtant annoncées dans le titre de l'ouvrage. Il n'y a pas un seul chapitre consacré à ce sujet !
Le mérite du livre est principalement de relever, et surtout d'attester, le fondement biblique d'une équité entre l'homme et la femme devant Dieu, depuis la création du monde, en rapport avec les responsabilités qu'ils exercent.

