Il est malheureusement exact que les impacts du réchauffement semblent s’accélérer depuis quelques années, que leur sévérité confirme les prévisions les plus pessimistes et qu’un certain nombre de seuils critiques (tipping points) ont été franchis, tandis que d’autres pourraient l’être dans un avenir plus ou moins proche. Si elle se poursuit, la fonte du pergélisol en Sibérie et dans les fonds de l’océan Arctique libérerait une quantité telle de méthane (actuellement séquestrée dans la terre gelée) que le réchauffement s’envolerait probablement vers des anomalies de température moyenne de +7 ou 8°C en quelques décennies. Du jamais vu pour notre planète depuis plusieurs dizaines de millions d’années.
Entre-temps, la concentration en gaz carbonique de l’atmosphère atteindrait la barre des 1000 ppm avant la fin du siècle (contre 417 en moyenne aujourd’hui), un seuil où il semble que le cerveau humain perde une partie significative de ses facultés. Les plus fortunés d’entre nous parviendront peut-être à survivre et à garder l’esprit clair en s’isolant, leur vie entière, dans des «bulles d’air propre» comme le font déjà certains (très) riches Chinois pour échapper à la pollution de Pékin ou de Shanghai. Quant aux abeilles, il est peu vraisemblable qu’elles parviennent à survivre à un tel traitement dans un contexte où déjà 80% des insectes ont disparu en Europe. Le seul moyen de préserver une agriculture -et donc notre survie- consistera sans doute à contraindre les paysans pauvres à polliniser à la main. C’est déjà le cas dans certaines campagnes chinoises que les abeilles ont désertées.
Il est cependant encore possible, pour un pays comme la France, d’atteindre le plancher de zéro émission carbone nette en 2050, avec des coûts mesurés tant pour le secteur public (environ 2% du PIB français chaque année) que privé (une vingtaine de milliards d’investissements annuels en infrastructures vertes).[1] S’il était atteint au niveau mondial avant 2060, un tel plancher permettrait de ne pas nous envoler très au-dessus du plafond des +2°C sur lequel la communauté internationale s’est engagée en 2015.
Paralysies publiques
Voilà trois décennies que les informations transmises par la communauté scientifique sur les risques vitaux associés au réchauffement climatique sont très claires. Et voilà trois décennies que la plupart de nos pays ne font presque rien pour réduire leurs émissions et encore moins pour s’adapter aux dévastations en cours et à venir. Les inondations qui ravagent le Pakistan étaient en grande partie prévisibles, tout comme les méga-feux qui détruisent les forêts d’Australie et de l’Amazonie ou encore la Californie et, depuis cet été, la France.
On sait d’ores et déjà qu’un tiers au moins du Bangladesh ainsi que la totalité du delta du Mékong seront sous l’eau avant 2050. Les gouvernements de ces pays cherchent désespérément des solutions pour anticiper les vertigineux déplacements de population et les risques de famine que cela va entraîner. En revanche, des régions entières de l’Inde seront soumises quasiment toute l’année à des pics de chaleur et d’humidité mortels pour les humains, tout comme l’essentiel de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique centrale. Quelles dispositions ces États adoptent-ils pour aider leurs populations à s’y préparer? Et en Europe? D’ici 2040, l’Italie, l’Espagne et le Portugal risquent de perdre plus de 40 % de leur accès à l’eau douce. Mais alors que l’Espagne et le Portugal envisagent de construire des usines de désalinisation de l’eau de mer, l’exécutif italien semble ignorer l’enjeu. Heureusement la société civile italienne, particulièrement inventive, organise déjà des communautés locales en charge de gérer l’accès à l’énergie et à l’eau comme à des communs.
Ces initiatives, tardives, restent sans commune mesure avec l’ampleur de l’enjeu. Les besoins de financement en investissements verts sont évalués à 90 mille milliards de dollars d’ici 2035 à l’échelle mondiale,[2] alors même que le Fonds vert des Nations Unies peine à récolter 50 milliards en cinq ans…
Le bunker comme fantasme
J’aperçois quatre raisons à cette paralysie relative. La première tient à ce que l’on peut baptiser le «syndrome du Titanic». Une partie de nos élites économiques continuent de danser sur le pont du navire alors qu’elles ont parfaitement compris que le paquebot va heurter l’iceberg. Convaincues qu’elles auront un accès privilégié au canot de sauvetage, elles s’estiment en sécurité et jugent exorbitant le coût humain et politique des réformes qui permettraient de dévier la course du bateau pour éviter le naufrage.
Ces ultra-riches rêvent absurdement d’un refuge où ils pourront s’abriter des conséquences désastreuses de leur propre désinvolture.[3] Même si, par extraordinaire, certains d’entre eux parvenaient à s’isoler dans l’un de ces bunkers en construction, la disparition de pans entiers de la population les privera des services sans lesquels ils sont incapables de vivre. De ce point de vue, les populations déshéritées, habituées à survivre dans des conditions difficiles, promettent de se montrer beaucoup plus résilientes… En outre, les enfants de ces bunkérisés termineront leur vie sous masque à oxygène ou littéralement idiots.
La concentration des pouvoirs
La deuxième raison de notre paralysie tient au fait que nos sociétés se trouvent à la croisée des chemins en termes d’économie politique des énergies non-fossiles. Deux options s’offrent à nous. L’une, celle que la plupart des militants écologistes appellent de leurs vœux, consiste à réorganiser nos sociétés en vue de distribuer le plus largement possible les sources de production d’énergies renouvelables et le pouvoir de décision politique: en somme, une démocratie participative structurée autour de communs décentralisés. L’Allemagne de la décennie 2010 avait semblé s’engager dans cette direction, si l’on en juge par la multiplication de coopératives de production d’énergie renouvelable qu’ont connue certains Länder. La décentralisation et le partage des ressources énergétiques devaient logiquement être accompagnés par un partage de la décision politique. Depuis, la plupart de ces coopératives ont été privatisées et l’Allemagne a renoué avec la houille…
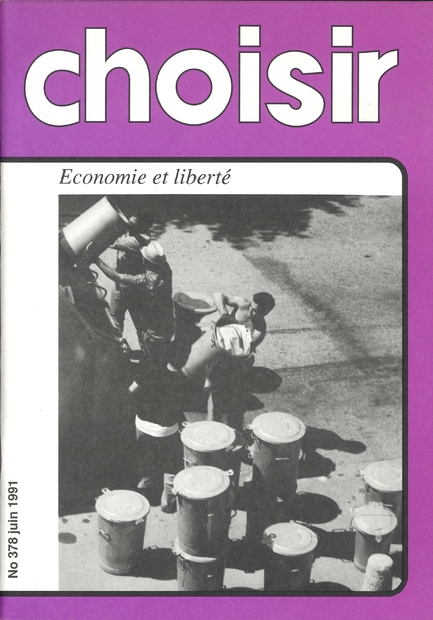 La seconde option, pour faire simple, est celle qu’empruntent la Chine de Xi Jinping et la Russie de Poutine: une alliance autoritaire entre la sphère publique et un secteur privé oligopolistique pour privilégier une concentration des sources de production d’énergie et, partant, des décisions politiques. Cette option s’accommode volontiers de la «solution nucléaire». C’est l’horizon vers lequel les gouvernements Macron tentent d’orienter la France, derrière une rhétorique trompeuse qui n’hésite pas à emprunter le lexique et les promesses de la première option.
La seconde option, pour faire simple, est celle qu’empruntent la Chine de Xi Jinping et la Russie de Poutine: une alliance autoritaire entre la sphère publique et un secteur privé oligopolistique pour privilégier une concentration des sources de production d’énergie et, partant, des décisions politiques. Cette option s’accommode volontiers de la «solution nucléaire». C’est l’horizon vers lequel les gouvernements Macron tentent d’orienter la France, derrière une rhétorique trompeuse qui n’hésite pas à emprunter le lexique et les promesses de la première option.
Nos «élites», selon moi, hésitent entre les deux voies. Certaines d’entre elles cherchent le moyen d’imposer aux peuples la seconde option, préférant gaspiller de précieuses années de lutte contre les crises écologiques plutôt que de courir le risque de perdre le pouvoir en laissant les sociétés civiles s’engager trop vite vers l’option démocratique-décentralisée. Le contrôle anti-démocratique des médias, auquel se livrent leurs propriétaires sur un «marché médiatique» de plus en plus concentré, est de ce point de vue un très mauvais signe: il rend possible les pires manipulations collectives, non seulement la propagande à laquelle se livrent Pékin et Moscou mais encore les mensonges publics de Bolsonaro au Brésil, le délire post-réalité de Trump ou encore la censure de la presse en France.
Les «communs» de demain
L’autoritarisme bureaucratique, en outre, ne peut pas déployer les ressources d’intelligence et de créativité collectives dont nous avons besoin pour relever les défis écologiques. La lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid 19 en a apporté la preuve. Les graves erreurs commises par le régime chinois dans sa politique du zéro-Covid montrent, par analogie, que l’option autoritaire ne permettra pas de relever efficacement les défis écologiques, car elle devra inévitablement arbitrer entre la préservation du pouvoir par les élites et la lutte effective contre les maux qui nous assaillent.
Tout comme pour le climat, la gestion de la crise du coronavirus a révélé un manque criant d’anticipation. À l’exception des États limitrophes de la Chine, la plupart des autres ne l’ont pas prévenue. Tout s’est passé comme s’ils n’avaient rien appris des épisodes pandémiques précédents, y compris du tout premier, le SARS, qui date pourtant de 2003. Le secteur privé, pour sa part, ne s’est guère montré plus efficace, son moteur, le profit, le disqualifiant en grande partie pour apporter des solutions. (Du reste, privatiser la santé -par exemple, en fixant un prix d’accès au vaccin- revient inévitablement à en priver les moins favorisés, lesquels constitueront un terrain de mutation virale idéal, qui rendra inopérants les vaccins avec lesquels les plus riches cherchent à se protéger.)
Autrement dit, le seul moyen de lutter efficacement contre une maladie comme la Covid (ou contre le réchauffement climatique) consiste à traiter la santé (aussi de la Terre) comme un bien commun qui inclut non seulement les humains mais l’ensemble du règne animal.[4] Il s’agit de construire les institutions locales, régionales, nationales et internationales qui vont dans ce sens. À Genève, la Drugs for Neglected Desease Initiative est un excellent exemple d’institution de ce genre. Il en faut d’autres, non seulement pour la santé mais pour le climat, pour les fonds océaniques, la biodiversité, etc.
Paralysie du secteur financier
Le troisième obstacle à la conversion écologique de nos «élites» tient à la paralysie du secteur financier. Les onze premières banques de la zone euro détiennent à elles seules 530 milliards d’euros d’actifs financiers directement liés aux hydrocarbures fossiles (charbon, pétrole, gaz).[5] Ces actifs représentent en moyenne 95% de leurs fonds propres. Si elles ne s’en débarrassent pas, le jour où nos sociétés se décideront enfin à bannir les fossiles, la plupart de ces banques seront en faillite. Elles le savent mais, plutôt que de changer radicalement de business model, et parce que personne ne veut plus leur racheter ces nouveaux actifs «pourris», elles tirent des deux mains sur le frein à main de la décarbonation de nos économies. Quitte à user des moyens de chantage qui leur sont familiers sur les États (incapables de les secourir si elles s’effondrent), sur les banques centrales (dont elles sont les principaux donneurs d’ordre) et sur les multinationales privées (qui dépendent de la sphère financière pour leur propre financement).
Comment sortir de cette impasse? En exigeant que les Banques centrales, replacées sous contrôle parlementaire, rachètent ces actifs «pourris» et compensent leurs pertes par la création monétaire. Cela ne coûterait rien à personne et ne créerait pas d’inflation si les nouvelles marges de manœuvre d’octroi de crédit ainsi libérées pour les banques sont mises à profit pour financer la transition écologique.
Anthropologie relationnelle
Le quatrième obstacle est le plus profond: il concerne l’anthropologie, voire la cosmologie implicite qui habite l’Occident depuis trois siècles. Cet imaginaire se figure que l’humanité est seule au monde à jouir d’une intériorité (l’âme, la conscience ou l’esprit, selon la manière dont on veut l’appeler) et n’entretient aucune relation significative avec le non-humain sinon une physicalité sourde et muette. C’est l’anthropologie de l’Uomo di vitruvio de Léonard de Vinci: l’humanité y est réduite à un homme, un mâle blanc, seul, sans relation avec le féminin, le non-européen ou la «nature», armé uniquement de la géométrie en vue de dominer le monde.
Pour mettre fin à la destruction des biotopes qui nous font vivre et inventer un nouveau rapport au monde, nous devons convertir notre regard, cesser de considérer nos arbres comme les éléments d’un décor somme toute sympathique mais dont il serait possible de se passer. C’est à cette conversion spirituelle qu’appellent les deux encycliques du pape François Laudato si’ et Fratelli tutti ainsi que son exhortation apostolique Querida Amazonia. Elle consiste, pour le dire très vite, à faire l’expérience qu’au commencement de tout se trouve la relation. Avec les proches, le socius de la société à laquelle nous appartenons, les animaux, les forêts, les paysages qui nous entourent, mais aussi nos ancêtres qui veillent sur nous et les générations à venir avec lesquelles nous sommes mystérieusement en communion si nous croyons à ce que les chrétiens nomment la «communion des saints».
De nouvelles analogies
L’Europe, jusqu’au XVIIe siècle, a été «analogiste», ce qui signifie qu’elle considérait le cosmos comme constitué d’entités autonomes reliées entre elles par des relations d’analogie, avec, au sommet, Dieu. La création tout entière était en relation avec lui par une analogie de l’être (analogia entis) dont Thomas d’Aquin et les conciles médiévaux ont fixé la doctrine et que beaucoup de théologiens protestants ont rejetée. Pour tout une série de raisons dont il n’est pas possible de rendre compte ici, il me semble très difficile, sinon impossible, de revenir naïvement à une vision du monde structurée par l’analogie médiévale. En revanche, d’autres types d’analogies, plus horizontales, ouvertes à celles et ceux qui ne se disent pas chrétiens, sont possibles. Nous en faisons l’expérience lorsque nous tentons de nous inspirer d’exemples qui nous précèdent pour faire du neuf.
Un autre genre d’analogie, que le théologien Christoph Theobald sj baptise analogia Regni (l’analogie du Règne de Dieu qui s’approche),[6] fournit peut-être la clef pour comprendre le genre de cosmologie qui peut nous aider à relever les défis qui sont les nôtres: une cosmologie historique de part en part, où nous apprendrons à prendre soin de nos relations avec le vivant, présent, passé et surtout à venir.
[1] Voir 2% pour 2°C, in institut.rousseau.fr, 8 mars 2022.
[2] Chiffre que propose le New Climate Economy Report (2019) et confirmé in Martin et al., Carbon Tax Policies. Impact on Global Warming and the World Economy (à paraître).
[3] Ces «élites» sont majoritairement responsables de la crise climatique: les 10% les plus riches de la planète émettent à eux seuls plus de 40% des émissions. Cf. Gaël Giraud, Composer un Monde en commun. Une théologie politique de l’Anthropocène, Paris, Seuil 2020, 762 p.
[4] L’initiative pionnière One Health de Jakob Zinsstag va dans ce sens. Cf. sous la direction de Jakob Zinsstag, One health, une seule santé. Théorie et pratique des approches intégrées de la santé, Paris, Quæ 2020, 576 p.
[5] Cf. Gaël Giraud et Christian Nicol, Actifs fossiles, les nouveaux subprimes, in institut.rousseau.fr, 10 juin 2021.
[6] Cf. Christoph Theobald, Le courage de penser l'avenir. Études œcuméniques de théologie fondamentale et ecclésiologique, Paris, Cerf 2021, 628 p.

