Ce feu est peut-être l’un des symboles les plus forts, les plus poignants de cette connaissance si chèrement acquise et si vite perdue, de cette science qui, tel l’horizon, ne cesse de reculer au fur et à mesure que nous en approchons les apparentes limites. Originelle, perpétuelle, éternelle fascination que celle du savoir, au point que nous nous sommes donnés le nom d’Homo sapiens sapiens. Celui qui sait qu’il sait… ou peut-être qu’il ne sait pas?
Vous pourriez trouver exagéré ce rapprochement mythologique et symbolique entre le feu et la connaissance; pourtant, force est de reconnaître que le développement récent des sciences et des techniques, ce savoir et ce pouvoir toujours croissants, exerce pareille fascination, j’entends pareils attrait et effroi. Surtout depuis un peu plus d’un demi-siècle, depuis que des savants et des ingénieurs ont testé la première arme atomique, le 16 juillet 1945, et que l’un d’entre eux, Robert Oppenheimer, s’est rappelé un extrait de la Bhagavad-Gita:[2] «Je deviens la Mort, le Destructeur des Mondes.»
Et si les rôles s’étaient inversés? Si les humains, armés à leur tour de glaives flamboyants, étaient parvenus à prendre la place des chérubins? Mais alors, pour garder quel paradis … ou quel enfer? Avant même que s’ouvre l’ère nucléaire, les prophètes n’ont pas manqué pour décrire l’un ou l’autre en des termes qui n’ont rien à envier aux millénarismes du Moyen Âge ni aux utopies des temps plus modernes.
Leurs voix continuent à s’élever pour nous promettre une existence heureuse et illimitée, voire immortelle, une existence «transhumaine», et des terres désormais situées bien au-delà du désert que notre planète risque de devenir, des refuges dans l’espace; ou encore pour mettre au goût des derniers rapports scientifiques les vieux récits eschatologiques et apocalyptiques, et compter à rebours les jours qu’il reste à vivre à notre humanité. De quoi nous fasciner, sans l’ombre d’un doute!
Nous ne devons ni ne pouvons nous voiler les yeux, comme le fait l’Angelus dubiosus de Paul Klee, pour éviter de regarder en face notre possible futur ou pour cacher notre honte d’avoir conduit notre espèce, et toute notre planète avec elle, au bord de ce qui peut prendre les allures d’un précipice. Mais nous ne devons pas pour autant entamer ou, plus exactement, reprendre le procès intenté contre le savoir, surtout si nous sommes croyants, héritiers d’une Église, d’une confession qui n’a pas hésité à établir des tribunaux et parfois à dresser des bûchers pour se débarrasser des aventuriers du savoir qui, bien souvent, remettaient en cause un système autoritaire et dogmatique plutôt que la recherche, toujours tâtonnante, d’un discours sur Dieu qui ne soit pas trop malhabile. Ces procès, ces bûchers étaient, et sont aujourd’hui sous des formes moins violentes, les effets d’une peur qui prend en otage ces vertus que nos Pères dans la foi qualifiaient de théologales: la foi, l’espérance et la charité.
Il y a un temps pour l’espoir
Permettez-moi de rappeler ici le mot de Tristan Bernard à sa femme, le 1er octobre 1943, dans le véhicule de la Gestapo qui les emmenaient au camp de Drancy: «Nous vivions dans la crainte, maintenant nous allons vivre dans l’espoir.» Ces mots empreints d’émotion et de sagesse paraissent faire écho à la célèbre sentence de Qohélet: «Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil.»
Il y a un temps, nécessaire, parfois imposé, pour la peur, pour toutes les formes de peur. Parce que la peur est la maîtresse de nos émotions, de nos besoins vitaux. Parce que la peur s’enracine dans nos savoirs, nos prévisions, notre imaginaire. Parce que la peur est peut-être l’une des plus anciennes compagnes de l’humanité et certainement «la sœur siamoise de l’aventure» (Gérard Guerrier). Parce que, comme l’a défendu le philosophe Hans Jonas, la peur possède une véritable capacité heuristique: elle peut nous faire progresser sur le chemin de la connaissance à acquérir, de l’expérience à accumuler, de la conscience à prendre.
Toutefois, et ici Tristan Bernard montre un extraordinaire mais sage courage, il doit aussi y avoir un temps pour l’espoir. Trop grand est le risque de demeurer emprisonné par la peur dans un présent ou même un passé allongé, répété, au motif du soi-disant C’était mieux auparavant ou bien du C’est toujours mieux que rien…
François Jacob, qui cite le mot de Bernard au terme de son livre La logique du vivant,[3] veut précisément défendre l’idée que la science, dans sa quête incessante de la connaissance, dans sa volonté de sortir de l’ignorance, offre effectivement cette possibilité de passer de la peur à l’espoir. Le chercheur français, prix Nobel de médecine en 1965, n’est ni dupe, ni aveugle: il connaît les limites, voire les défauts de la recherche scientifique; il constate qu’«on n’interroge plus la vie aujourd’hui dans les laboratoires». Il n’en reste pas moins convaincu que le savoir ouvre les portes du futur.
De l’or à raffiner
N’oublions cependant pas les vertus théologales: parce qu’elle est «articulée» à la foi et à la charité, l’espérance est davantage que l’espoir. Elle ne peut se contenter d’ouvrir des portes ; il faut encore qu’y apparaisse la silhouette d’un être humain, d’un être à aimer et auquel croire.
Avons-nous encore besoin d’anges gardes-chiourmes à l’épée flamboyante et au regard fulgurant? L’ombre des victimes d’Hiroshima et de Nagasaki, projetée par le flash nucléaire et inscrite à jamais dans la pierre ou le béton, suffit, je crois, à nous mettre en garde vis-à-vis des dangers associés aux technologies que nous imaginons et dont nous usons. Nous avons plutôt besoin des ailes protectrices, prêtées par la coutume à ces créatures, pour entreprendre et poursuivre le long chemin qui n’évite pas la confrontation avec notre humaine condition, mais ne s’y arrête pas, ne s’y complaît jamais.
L’homme de science, l’homme de foi, l’homme aux semelles de vent qu’était Pierre Teilhard de Chardin en était convaincu: «C’est sans doute une conception chrétienne bien imparfaite que celle qui se donne comme idéal de ‹traverser la vie›, en restant pure. Comme si la vie était une chose mauvaise et dangereuse, et non le chemin de l’être. L’idéal chrétien est sans doute de se mêler profondément à la vie, pour la purifier, et s’y purifier. La vie n’est pas de la boue, mais de l’or à raffiner…» Je ne vois guère d’autre manière d’aborder les enjeux actuels associés au développement scientifique et technique que celle prônée par le savant jésuite: une manière aussi fidèlement chrétienne que profondément humaine.
Il ne faut pas oublier cette posture, cette vision à l’heure où s’amoncellent les promesses transhumanistes … qui n’hésitent pas d’ailleurs à revendiquer le parrainage de Teilhard de Chardin. Le transhumanisme de ce dernier n’appelle en rien à un oubli de l’humain, à une sorte d’in-humanisme; il est bel et bien un transhumanisme: l’idéal chrétien est de se mêler profondément à l’humain; la vie humaine n’est pas de la boue mais de l’or à raffiner... Et lui-même n’a jamais hésité à suivre cette voie.
Avec la foi…
Quel chemin parcouru depuis ce temps mythique où nos ancêtres ont été chassés du jardin d’Éden, autrement dit écartés du stade de l’animal pour entrer, encore malhabiles sur leurs deux jambes, dans le territoire inconnu de la conscience, de l’intelligence, de la raison, du savoir, de la curiosité, de l’imaginaire, dont l’association constitue peut-être, avec les trois vertus théologales, le propre de notre humanité! Quels anges, quel Dieu nous ont donc poussés sur ce périlleux sentier, nous interdisant de rebrousser chemin?
Les embûches ne manquent pas pour nous effrayer, ni les abîmes pour nous fasciner. Les voix ne manquent pas non plus, si nous y prêtons attention, pour nous rassurer: «N’ayez pas peur!» Des voix qui cherchent à endormir notre attention ou bien à nous faire croire que la solution aux problèmes posés par le progrès technologique se trouve dans la technologie elle-même. Des voix, plus rares, qui ne nous cachent rien de ce que nous sommes, du temps qui est le nôtre, mais qui nous invitent à la foi.
L’homme de peu de foi n’échappe pas à la peur: il s’enfuit ou s’enfonce, comme Pierre lorsqu’il tente de marcher sur les eaux pour rejoindre son maître. L’homme de foi ne voit pas des ailes lui pousser aux chevilles, ni la mer s’ouvrir devant lui; mais il trouve en lui l’audace d’accomplir un premier pas, puis un second, de ne pas s’arrêter à l’apparence d’une frontière ou d’une clôture, à l’injonction d’un interdit ou d’un tabou. L’homme de foi n’est aveugle ni sur lui ni sur ses congénères ni sur la réalité qui l’entoure. Mais il voit plus loin que le bout de ses semelles, l’horizon de ses évidences, le voile de ses pleurs, l’épouvantail de ses peurs, le garde-fou de sa prudence. Car, selon l’audacieuse formule de la lettre aux Hébreux, « la foi est une manière de posséder déjà ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas.» L’homme de foi ne croit plus, il n’a plus peur. Il est parvenu au-delà de la croyance: il sait. 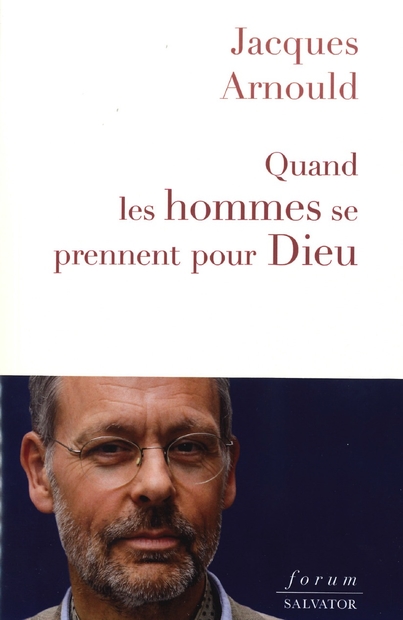
[1] Jacques Arnould, Quand les hommes se prennent pour Dieu, Paris, Salvator 2020, 144 p. Un essai qui questionne la tradition théologique chrétienne au regard du transhumanisme, où l’on retrouve Teilhard de Chardin, Adam et Eve, Jacob, Michel Houellebecq et d’autres.
[2] La Bhagavad-Gita conte l’histoire de Krishna. C’est l’est un des écrits fondamentaux de l’hindouisme (entre le Ve et le IIe siècle av. J.-C.).
[3] François Jacob, La logique du vivant, Paris, Gallimard, 1976, 352 p.


 Dieu aurait-il pu s’en douter? Lorsqu’il décida de bannir l’homme du jardin d’Éden, de l’éloigner de l’arbre de vie pour avoir mangé ses fruits de la connaissance du bien et du mal, il posta devant l’enceinte du paradis des chérubins armés de glaives flamboyants… Comment aurait-il pu se douter que ces flammes exerceraient sur Adam et ses descendants une fascination analogue à celle du savoir et de l’immortalité qui, de l’humble feu de camp des origines jusqu’au feu nucléaire, ne cesserait jamais?
Dieu aurait-il pu s’en douter? Lorsqu’il décida de bannir l’homme du jardin d’Éden, de l’éloigner de l’arbre de vie pour avoir mangé ses fruits de la connaissance du bien et du mal, il posta devant l’enceinte du paradis des chérubins armés de glaives flamboyants… Comment aurait-il pu se douter que ces flammes exerceraient sur Adam et ses descendants une fascination analogue à celle du savoir et de l’immortalité qui, de l’humble feu de camp des origines jusqu’au feu nucléaire, ne cesserait jamais?