Contre le géométrique, l’homogène et l’uniforme, nous avons besoin de rencontrer l’hétérogène et le foisonnant de la nature. Contre le regard empêché butant sur le mur de la chambre, de la classe, du bureau et de la rue, nous avons soif de rencontrer des plans de fuite, du ciel, de l’horizon, de l’échappée belle. Contre l’artefact généralisé et les matières artificielles (béton, plastique, et cristaux liquides) nous avons besoin de rencontrer des matières et des objets en lesquels les quatre éléments et le vivant sont perceptibles à nos sens. (...)
Plans de fuite et d’horizon
Ma sœur aînée vit à Paris, au cinquième étage, avec des vasistas pour éclairer les pièces, sauf la cuisine qui a une fenêtre donnant sur les toits, sur le ciel et sur les lointaines collines boisées de Sèvres. Travail studieux, épluchage de légumes, repas, ou «simplement être là, assise face à la fenêtre», c’est ici qu’elle se pose, se repose, son havre, son moment de grâce quotidien. C’est ici qu’elle se nourrit de plans de fuite, de ciel, de soleil couchant, de collines et d’horizon. Je suis étonné par le nombre de citadins qui me disent leur bonheur (la nécessité même, me dit ma sœur) qu’ils ont de bénéficier d’un logement, modeste souvent, mais où ils sont au dernier étage ou au moins au-dessus des toits: «Si tu savais, on peut voir le soleil se lever, la Garonne, la Seine, ou tout simplement: loin par-dessus les toits.»
La vue est bien notre sens principal, à nous les humains, celui par lequel nous explorons et nous nous situons le plus dans notre vie avec l’autre, semblable ou non. Un visuel sans horizon, sans échappatoire, sans possibilité de nous situer dans le proche, le plus loin, le lointain, les champs là-bas, les forêts, l’horizon, le soleil, le ciel, les étoiles, nous amoindrit et nous atrophie. Dormir à la belle étoile ou dans une chambre d’hôtel, par exemple? Dehors, la nuit, ma vie me semble immense, prête à s’amplifier, se dilater aux dimensions du paysage et de l’espace. Dans une chambre close, elle me semble étroite, étriquée, comme les murs qui m’enferment.
Se projeter. Il me semble y avoir un parallèle profond (corporellement et psychiquement ressenti) entre la possibilité ou non de se projeter visuellement dans l’espace, à quelques centaines de mètres ou de kilomètres, jusqu’à l’horizon, jusqu’au ciel; et la possibilité, ou non, de se projeter dans sa vie, dans la vie, dans le temps et dans l’espoir. Quelle horreur (je pèse mes mots) que d’offrir à l’hospitalisé, au malade de longue durée, au vieillard, au détenu, cet unique et puissant message visuel: mon âme est finie, ma vie est finie, limitée, arrêtée par ce mur, sans possibilité pour moi, à travers mon regard, d’aller vers l’horizon, d’aller vers la vie. (...)
Recoller au réel
Une réalité étrangère à notre sensorialité et à nos dimensions se construit en notre siècle. L’être humain ne me semble pas pouvoir vivre en bonne santé et s’épanouir dans un monde d’artefacts et de virtuel sur lesquels seul notre esprit aurait prise (et encore), que ni notre corps, nos dimensions corporelles, ni nos sens ne pourraient appréhender. Artificialité totale des matières et virtualité totale des sons et des images qui sont offerts à nos sens. Il ne resterait peut-être que, têtus, les odeurs, les couleurs, les formes, les goûts de quelques-uns de nos aliments; bien que dans certains hôpitaux, prisons ou écoles, il y aurait à redire...
 J’écris ces lignes sur une longue table de chêne qui nous suit, mon épouse et moi, depuis quarante ans. On y mange souvent, j’y suis bien pour écrire: contact visuel, contact tactile, charnel même, de la main qui caresse le matériau, la matière bois, et qui devine sous la peau les douces imperfections du travail de l’artisan. Cette matière, le bois, qui pour mes sens transpire la nature, parle à ma vue et à mon toucher. Son origine proche évoque la scierie, son parfum et ses bruits de scie, la route forestière et ses grumes empilées, la forêt et ses arbres, ses chênes précisément. Cette table, un objet manufacturé qui me parle d’hommes, d’un menuisier, de son atelier, de ses outils, de ses bras et de ses mains ; manu-facturé, fait avec des mains humaines. Cette matière et cet objet manufacturé me relient sensoriellement, et ensuite intellectuellement, au monde et aux hommes, y ancrent et y arriment une part de mon équilibre et de mon appartenance au monde.
J’écris ces lignes sur une longue table de chêne qui nous suit, mon épouse et moi, depuis quarante ans. On y mange souvent, j’y suis bien pour écrire: contact visuel, contact tactile, charnel même, de la main qui caresse le matériau, la matière bois, et qui devine sous la peau les douces imperfections du travail de l’artisan. Cette matière, le bois, qui pour mes sens transpire la nature, parle à ma vue et à mon toucher. Son origine proche évoque la scierie, son parfum et ses bruits de scie, la route forestière et ses grumes empilées, la forêt et ses arbres, ses chênes précisément. Cette table, un objet manufacturé qui me parle d’hommes, d’un menuisier, de son atelier, de ses outils, de ses bras et de ses mains ; manu-facturé, fait avec des mains humaines. Cette matière et cet objet manufacturé me relient sensoriellement, et ensuite intellectuellement, au monde et aux hommes, y ancrent et y arriment une part de mon équilibre et de mon appartenance au monde.
Que dire en revanche de la façade de béton ou de verre, des tables et des chaises en acier ou en plastique moulé, des fours à micro-ondes, ou des écrans et claviers inaccessibles à ma connaissance sensorielle et à mes représentations du monde. Je sais, cognitivement parlant, parce qu’on me l’a cognitivement expliqué, que dans cet objet il y a du pétrole, donc des micro-organismes du fond des mers datant de cent ou deux cents millions d’années -puisqu’ils me le disent, cela doit être vrai, mais en rien reliable à mon corps et mes sens-, des gaz rares extraits de je ne sais quoi, des terres rares (qu’est-ce qu’une terre rare?) venues de Chine ou d’Afrique, des minerais lointains ou des roches pas si lointaines. Tout cela a cheminé et s’est rassemblé dans des tuyaux, des tankers, des trains, puis dans des usines à pièces, celles-ci rassemblées dans des usines de montage. Tout cela, à chaque étape, avec des machines, des procédés, des atomes, des cristaux, des molécules, des lois physico-chimiques, des pensées technologiques fragmentées, additionnées, juxtaposées. Quel lien puis-je créer avec ces objets, prodigieusement efficaces certes, mais totalement étrangers à mon être psychocorporel? (...)
Altérité-appartenance
Le besoin, la nécessité de l’autre, de l’altérité pour se construire et pour vivre humain est une évidence pour chacun. Nul ne peut même survivre, semble-t-il, organiquement, sans le rapport à I’autre ou, à la limite, à l’espoir d’un rapport à l’autre. Dans la fiction, Robinson est sauvé par la présence de vendredi; dans la terrible réalité, Ishi, le dernier Indien sauvage d’Amérique du Nord, [Théodora Kroeber, Ischi, Paris, coll. Terre humaine, Plon 1968, 360 p.] maintenant seul au monde à la mort de sa sœur, refuse cette solitude absolue et rejoint coûte que coûte d’autres humains, n’importe lesquels mais des humains. Philosophes, sociologues et psychologues nous montrent, dans un deuxième temps, qu’un rapport à l’autre étrange, à l’autre lointain, s’il est vécu dans la sécurité et non dans la défensive, est source d’épanouissement, d’ouverture, de bien-être et de bien vivre. Nous avons, semble-t-il, ce même besoin d’altérité pour notre survie équilibrée et pour notre épanouissement serein avec l’autre naturel, la nature. Nous posons ce postulat que nous ne pouvons pas vivre psychiquement ni vivre pleinement notre humanité sans un rapport à l’autre naturel, sans ce que nous n’avons pas fait. (...) Nous avons besoin de l’autre non-humain (animal, végétal, ruisseau, montagnes et cosmos) que nous n’avons pas fait, qui n’est pas nous, pour nous sentir à notre juste place, pour nous sentir pleinement nous-mêmes, à la fois autres, radicalement humains, différents, et appartenant aussi à l’animal, au vivant et au cosmos. Nous avons besoin de cette nature à un premier niveau, direct, pragmatique, et aussi à un niveau plus conceptuel, plus philosophique. Au premier niveau, c’est le besoin de voir, toucher, baigner dans la nature, les coccinelles, les arbres, les fleurs ou les moutons. Par ailleurs, nous avons aussi besoin de la nature au niveau de la pensée. L’idée est de savoir qu’il existe quelque part un autre, différent, puissant, qui nous est à la fois étranger et semblable dans cette origine commune que nous avons avec les animaux, les plantes, le cosmos. C’est, je suppose, mon besoin d’éléphants et de baleines que je ne verrai jamais; mon besoin que vivent parmi nous quelques ours et quelques loups, malgré les réelles contradictions qu’ils posent; c’est mon ardent désir qu’existent quelques morceaux de forêt amazonienne, d’Antarctique, de forêts primaires européennes non violées, non envahies par l’humanité.
 Dans son roman visionnaire Les Racines du ciel, (Paris, Gallimard 1956) Romain Gary explique comment, pour Morel, le héros, les éléphants sont une part indéniable de sa liberté et de son humanité. En effet, Morel et ses codétenus, dans un camp de concentration nazi, sont sauvés par les éléphants. C’est d’imaginer un troupeau d’éléphants, déboulant sur le camp, piétinant dans un nuage de poussière clôtures, prison, barbelés, miradors, gardiens et mitrailleuses, qui leur permet de sauver leur liberté intérieure, leur humanité, leur vie !
Dans son roman visionnaire Les Racines du ciel, (Paris, Gallimard 1956) Romain Gary explique comment, pour Morel, le héros, les éléphants sont une part indéniable de sa liberté et de son humanité. En effet, Morel et ses codétenus, dans un camp de concentration nazi, sont sauvés par les éléphants. C’est d’imaginer un troupeau d’éléphants, déboulant sur le camp, piétinant dans un nuage de poussière clôtures, prison, barbelés, miradors, gardiens et mitrailleuses, qui leur permet de sauver leur liberté intérieure, leur humanité, leur vie !
Retrouvez un autre récit, plus littéraire, de Louis Espinassous dans le choisir de juillet: une poétique description de randonnées automnales dans les Pyrénées et la forêt landaise, occasion privilégie de rencontre avec le sauvage. Ainsi qu'un inédit de l'écrivain valaisan Jérôme Meizoz, Immensément, sur ces maisons de retraite qui se transformemt parfois en... petites boîtes... Pour commander ce numéro, . Fr. 13,50 (+ port).


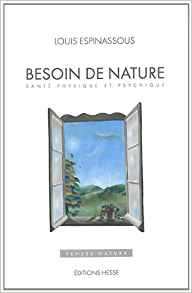 « Petites boîtes, boîtes, boîtes,
« Petites boîtes, boîtes, boîtes,