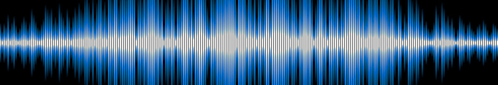
Patrick Bittar
Le grand miracle
 Le dessin animé Le grand miracle raconte la matinée extraordinaire de trois adultes dans une ville mexicaine. Débordée par ses obligations professionnelles, une jeune veuve peine à élever son garçon de 9 ans. Un chauffeur de bus apprend au cours d’un trajet que son enfant est atteint d’une maladie grave. Se sentant une charge pour son entourage, une vieille bourgeoise sort en douce de chez elle, au grand dam de ses domestiques qui s’inquiètent de trouver la porte de sa chambre close. Chacun de ces trois personnages est mystérieusement conduit vers une église par trois adolescents, qui vont s’avérer être leurs anges gardiens et leur ouvrir les yeux sur les réalités invisibles accompagnant le rituel de la sainte messe. Les trois adultes repartiront bouleversés.
Le dessin animé Le grand miracle raconte la matinée extraordinaire de trois adultes dans une ville mexicaine. Débordée par ses obligations professionnelles, une jeune veuve peine à élever son garçon de 9 ans. Un chauffeur de bus apprend au cours d’un trajet que son enfant est atteint d’une maladie grave. Se sentant une charge pour son entourage, une vieille bourgeoise sort en douce de chez elle, au grand dam de ses domestiques qui s’inquiètent de trouver la porte de sa chambre close. Chacun de ces trois personnages est mystérieusement conduit vers une église par trois adolescents, qui vont s’avérer être leurs anges gardiens et leur ouvrir les yeux sur les réalités invisibles accompagnant le rituel de la sainte messe. Les trois adultes repartiront bouleversés.
L'épreuve du Silence, de Martin Scorsese
 Bien avant sa sortie dans les salles obscures de Suisse (le 8 février), Silence, de Martin Scorsese, a déjà fait beaucoup parler de lui.
Bien avant sa sortie dans les salles obscures de Suisse (le 8 février), Silence, de Martin Scorsese, a déjà fait beaucoup parler de lui.
Le film a été projeté en avant-première au Vatican, le 29 novembre 2016, devant plus de 300 jésuites. La Compagnie de Jésus, de fait, attendait avec impatience cette nouvelle adaptation cinématographique (45 après celle de Masahiro Shinoda) du roman historique du japonais catholique Shusaku Endu sur la vie du missionnaire portugais jésuite Sebastien Rodrigues. Qui plus est, par un renommé réalisateur américain. Car le film et le livre posent des questions de fond autour de la foi et du martyre.
Des films chrétiens
Risen, de Kevin Reynolds
Le fils de Joseph, d’Eugène Green
En Judée, en l’an 33, une centurie romaine menée par Clavius, un tribun militaire, vainc un groupe de rebelles hébreux entraîné par un certain Barrabas. A peine revenu à Jérusalem, Clavius est convoqué par Ponce Pilate : le préfet l’envoie surveiller le déroulement, au-delà des remparts, de la crucifixion d’un Nazaréen nommé Yeshua.
Au delà de l'histoire
Soleil de plomb, de Dalibor Matanic
Midnight Special, de Jeff Nichols
Un jeune couple d’amoureux folâtre au bord d'un lac paradisiaque de la campagne yougoslave, sous un soleil radieux. Jelena et Ivan ont prévu de partir tenter leur chance à Zagreb le lendemain. Mais pendant qu’ils s’ébattent, des troupes prennent position dans les bourgades environnantes, et des barrages de miliciens armés s’installent sur les routes qui relient les villages serbes et croates. Nous sommes en 1991, et c’est le début du premier - le plus tendu, le plus tragique - des trois volets de Soleil de plomb.
Il est une foi
Pour la deuxième édition d’Il est une foi, l’Eglise catholique romaine - Genève (ECR) a donné rendez-vous en avril passé à la population autour d’un riche programme : « 16 films, des débats et des belles occasions de rencontre ».
Gérald Morin, qui fut pendant six ans l’assistant de Fellini, a été le directeur artistique de la manifestation. Il explique les choix de cette édition, présentée sous le titre de Trouble.
