La Suisse romande compte un nouveau romancier. Valaisan d’origine et Genevois d’adoption, Philip Taramarcaz, médecin allergologue, a édité au printemps 2020 un roman à la qualité d’écriture certaine. Comme des Mohicans relate les moult rebondissements de l’émancipation de Séraphin, un adolescent de Fully, novice à l’hospice du Simplon. Mû par un instinct de survie très sûr, il choisit de fuir les lieux pour se lancer sur les chemins du Val d’Anniviers, jusqu’à Genève.
Philip Taramarcaz: «Ce qui m’intéressait, c’était de suivre l’itinéraire d’un jeune homme qui traverse son terroir sans s’y ancrer, au rythme d’une rivière. Le Valais, avec toutes ses vallées latérales qui aboutissent sur l’axe central du Rhône, était tout indiqué pour cette métaphore. J’ai une certaine nostalgie pour la région, à travers tout ce que j’ai entendu de mes grands-parents et de mon père. Je connais géographiquement et émotionnellement tous les lieux que je décris. Je les ai investigués historiquement pour les retranscrire, avec le plus de justesse possible, au XIXe siècle. La demeure familiale de Fully, par exemple, est inspirée de celle de mes grands-parents. Je me sens aussi des accointances avec la congrégation du Grand-Saint-Bernard, omniprésente dans mon récit.»
Votre livre, comme le titre l’indique, est aussi un joli clin d’œil à la littérature américaine pour la jeunesse du XIXe siècle.
«En fait, c’est la lecture du Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper, trouvé à l’hospice, qui donne à Séraphin le goût de la liberté. Il faut savoir que Cooper est vraiment passé par le col du Simplon en 1830. Je me suis aussi inspiré des héros rebelles de Mark Twain. Séraphin et son ami Guérin, un enfant naturel, ce sont un peu les Tom Sawyer et Huckleberry Finn du Valais. Il y a d’ailleurs à la fin du roman une rencontre entre Twain et Guérin sur un bateau à roues à aubes descendant le Mississipi, un autre fleuve mythique.»
Pour revenir au Valais, les contraintes religieuses qui empoisonnent la vie de Séraphin et d’autres dans votre récit ont longtemps été lourdes dans le canton. Vous ont-elles pesé?
«Pas personnellement, mais je les ai senties à travers les générations précédentes, dont je me fais ici un peu le porte-parole. Le XIXe siècle, ce n’est que quatre générations en arrière. Lorsque nous étions enfants, nos grands-parents pouvaient nous relater des souvenirs tenus de leurs grands-parents. C’est presque une voie directe et pourtant c’est un autre monde!»
Votre roman évoque avec pudeur, par petites touches, la question des abus sexuels dans l’Église et les ravages qu’ils causent sur leurs victimes. Gabriel, un des personnages, en meurt d’ailleurs. Pourquoi ce sujet?
«Au cours de mes années de pratique de la médecine, j’ai été très impressionné par le nombre de gens qui ont été victimes d’abus. Certains ont des troubles fonctionnels qui ressemblent à des maladies physiques, mais qui sont des symptômes liés à des syndromes de stress post-traumatique. J’ai voulu intégrer cette réalité dans le livre, mais la faire passer avec légèreté car cela reste fondamentalement un roman d’aventure. Je voulais aussi montrer différents chemins de résilience. Séraphin a un fort instinct de préservation, ce qui lui permet de choisir sa destinée; Gabriel, plus soumis à l’autorité, ne trouve l’évasion que dans le sacrifice. Je précise que je n’ai pas choisi les chanoines du Simplon en raison d’une quelconque similitude avec l’histoire contée, mais parce que je voulais que mon récit se passe en Valais.»
La médecine d’ailleurs est l’un des fils conducteurs du récit, ou plutôt les apothicaires et guérisseurs.
«Oui, l’histoire des élixirs me passionne. Elle est plurimillénaire puisqu’elle commence avec Mithridate.[1] Et mon arrière-arrière-grand-père de Martigny était lui-même un rebouteux. Certains de ses livres sont restés entre les mains de mon père, dont une traduction en français de De occulta philosophia de Cornelius Agrippa, un manuscrit précieux du XVIIe siècle. Ce livre m’a toujours fasciné car il contient la liste des rebouteux à qui il a été transmis; celle-ci s’arrête sur le nom de mon aïeul. L’intégrer dans le roman, c’est un peu le faire revivre. L’ouvrage a failli être exposé en 2010 à la Fondation Bodmer dans le cadre de La médecine ancienne – du corps aux étoiles, mais finalement le commissaire a trouvé une édition plus ancienne.»
Deux autres écrits non édités font partie de votre escarcelle. Pensez-vous les retravailler?
«C’est une possibilité. De fait, cela fait 19 ans que j’écris par petites touches. Mon premier roman relate la vraie histoire d’un missionnaire méthodiste, envoyé en Australie au XIXe siècle pour christianiser les Aborigènes. Le deuxième est un polar qui se passe à Genève mais qui a aussi un fond aborigène. Cela dit j’ai plein d’autres projets! Ça bouillonne dans ma tête.»
[1] Mithridate VI, roi du Pont (134-63 av. J.-C.), avait élaboré une potion à base de dizaines de plantes pour se prémunir des poisons.


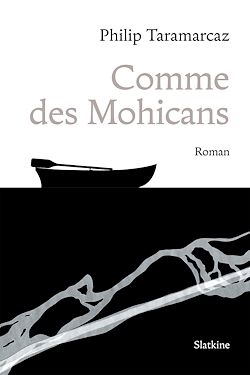 Quête de liberté pour le héros et enquête sur ses propres origines pour l’auteur, Comme des Mohicans est un roman initiatique et d’aventure, entrecoupé d’expressions patoisantes, qui a pour cadre le Valais de la fin du XIXe siècle. Une terre soumise au carcan de l’Église et pétrie de lourdes conventions sociales et familiales, mais sur laquelle fleurissent herboristes et contrebandiers, comme autant d’ouvertures sur l’horizon.
Quête de liberté pour le héros et enquête sur ses propres origines pour l’auteur, Comme des Mohicans est un roman initiatique et d’aventure, entrecoupé d’expressions patoisantes, qui a pour cadre le Valais de la fin du XIXe siècle. Une terre soumise au carcan de l’Église et pétrie de lourdes conventions sociales et familiales, mais sur laquelle fleurissent herboristes et contrebandiers, comme autant d’ouvertures sur l’horizon.