Lydie Bordenave est rédactrice sur toutlevin.com et tient le blog Les P’tea Potes, dédié aux découvertes autour de Bordeaux. Elle a publié en 2019 son premier roman, C’est simple, ma vie est compliquée (éditions Vents salés) suivi de deux romans en auto-édition.
«Si je n’avais pas écrit, je serais devenue une incurable de l’alcool. C’est un état pratique d’être perdu sans plus pouvoir écrire... C’est là qu’on boit. Du moment qu’on est perdu et qu’on n’a plus rien à écrire, à perdre, on écrit», disait Marguerite Duras dans Écrire. Par cette pirouette ironique, la célèbre autrice du roman L’amant décrit son addiction à l’alcool autant qu’à son travail d’écriture.
La frontière est mince chez elle entre le besoin viscéral d’écrire et celui de consommer des litres de vin pour atteindre cet état grisant qui l’entraîne vers ses côtés les plus sombres, les plus profonds et les plus inavouables. Dans une interview donnée à Bernard Pivot en 1984, elle se confie sur ce point: «L’alcool a été fait pour supporter le vide de l’univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l’espace, leur silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur. L’alcool ne console en rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l’individu, il ne remplace pas le manque de Dieu. Il ne console pas l’homme. C’est le contraire, l’alcool conforte l’homme dans sa folie, il le transporte dans les régions souveraines où il est maître de sa destinée.»
La chimère du pauvre
Bien avant elle, en 1857, Baudelaire décrit le vin comme un exhausteur de vie, une façon d’échapper à son rang social. «Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.» Dans son recueil Les Fleurs du mal, cinq poèmes composent la section «vin»: Le vin du solitaire, L’âme du vin, Le vin des chiffonniers (décrivant le bonheur des ouvriers de s’enivrer après leur dur labeur), Le vin de l’assassin (où il parle d’un homme ayant tué sa femme pour pouvoir boire sans reproche et où il dénonce ainsi l’abus d’alcool et ses effets dramatiques) et Le vin des amants.
Dans les années 1870, époque des poètes maudits comme on les nomme, Rimbaud et Verlaine ont recours à la fée verte, surnom chimérique de l’absinthe, pour accoucher de leurs plus beaux poèmes pendant leur relation amoureuse tumultueuse. Quelques années plus tard, en 1912, Apollinaire consacre même un recueil aux breuvages euphorisants, Alcools. Il y trouve une forme d’ivresse universelle, comme une énergie collective pour célébrer la vie: «Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie / Ta vie que tu bois comme une eau de vie.»
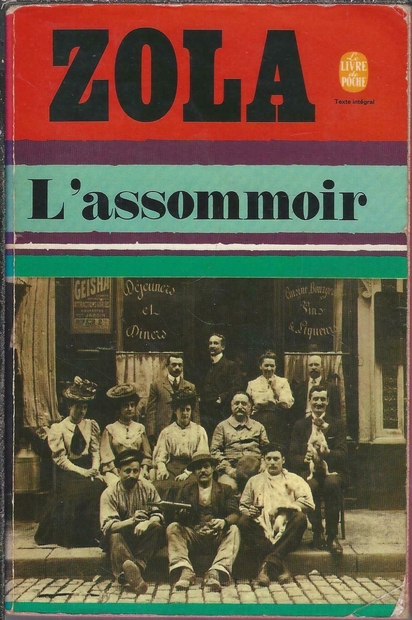 Si certains auteurs savent se griser sans tomber dans les travers de la mort lente de l’alcoolisme, il apparaît néanmoins que la descente aux enfers soit souvent sans retour. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que le rapport à l’alcool est souvent un sujet de roman. En 1877, Émile Zola, dans L’assommoir, évoque la boisson comme le seul antidépresseur qui procure une illusion de plaisir, sinon de bonheur, le seul moyen de supporter sa condition sociale, de «se coller un peu de paradis dans la peau», pour reprendre une image de l’écrivain Alphonse Allais, lui-même alcoolique; mais il parle aussi de la déchéance et de la violence provoquées par la surconsommation d’alcool.
Si certains auteurs savent se griser sans tomber dans les travers de la mort lente de l’alcoolisme, il apparaît néanmoins que la descente aux enfers soit souvent sans retour. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que le rapport à l’alcool est souvent un sujet de roman. En 1877, Émile Zola, dans L’assommoir, évoque la boisson comme le seul antidépresseur qui procure une illusion de plaisir, sinon de bonheur, le seul moyen de supporter sa condition sociale, de «se coller un peu de paradis dans la peau», pour reprendre une image de l’écrivain Alphonse Allais, lui-même alcoolique; mais il parle aussi de la déchéance et de la violence provoquées par la surconsommation d’alcool.
Outre sur les écrivains eux-mêmes et sur leurs personnages, quels effets l’alcool a-t-il sur leur inspiration et leur écriture? Un bon écrivain doit-il imbiber son gosier avant de tremper sa plume dans l’encrier? L’alcool les rend-ils plus humains, plus honnêtes avec leurs lecteurs en offrant la vérité sans filtre, en allant chercher dans cette partie de génie qui semble ne se montrer qu’après plusieurs verres bien chargés? Ne serait-ce pas plutôt leurs blessures, leur sensibilité, leurs peurs qui les poussent à écrire avec tant de précisions et à boire avec tant de conviction?
Certains soulignent qu’ils ne peuvent pas consommer d’alcool pendant leur session d’écriture car ils ont besoin de garder une maîtrise de la plume, une lucidité des mots. Ainsi de Joseph Kessel qui, dans Les alcooliques anonymes, raconte: «Je n’ai jamais eu peur de l’alcool. On naît alcoolique, on ne devient pas alcoolique. L’instinct de conservation m’a toujours arrêté à temps. D’ailleurs, je n’ai jamais travaillé en buvant. Et j’ai beaucoup travaillé.» Tout comme Ernest Hemingway, qui arrêtait toujours de boire durant les périodes où il écrivait mais qui rattrapait sérieusement le temps perdu une fois son roman achevé!
Pendant ces semaines d’intense travail, son ami Hotchner le décrit au régime sec -pas plus d’un litre de blanc à table et seulement trois whiskies le soir- soucieux de ne pas mélanger travail et plaisir. D’après son ami, c’est l’obtention en 1954 du prix Nobel de littérature qui plongea Hemingway dans une consommation excessive. Ce dernier était en effet persuadé que l’attribution de cette récompense entraînerait obligatoirement le tarissement de son génie et la fin de son travail. Comme si de penser qu’il ne pourrait plus écrire le condamnait désormais à ne plus faire que boire. On peut également parler de son rival stylistique William Faulkner, qui reçut le Nobel de littérature cinq ans avant Hemingway. La vie du romancier a tout autant été marquée par l’alcoolisme, malgré de nombreuses cures.
Des malades
On notera aussi une forme d’autodestruction commune à des écrivains ayant vécu des drames ou de trop forts bouleversements pour des êtres dotés d’une grande sensibilité : l’écriture comme thérapie parfois, la boisson comme médicament illusoire la plupart du temps. L’auteur de Croc-Blanc, Jack London, lutte contre une terrible dépression qu’il essaie de guérir entre alcool et travail acharné (il écrit 1000 mots par jour, chaque jour). En 1913, dans Le cabaret de la dernière chance, roman autobiographique, il décrit la déchéance qui entraîne la mort lorsque l’on succombe à l’appel de la boisson plus qu’à celui de la forêt, et en particulier, dans son cas, du whisky.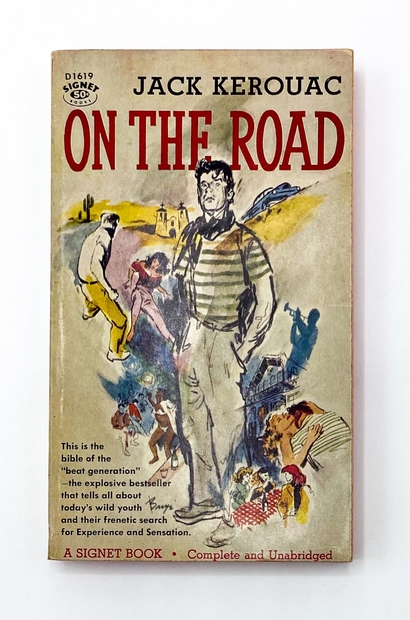
Autre Jack, mais même constatation, Jack Kerouac, l’auteur du roman Sur la route (1957), sera accablé par la notoriété et celle-ci le poussera à boire chaque jour davantage (près d’un litre de whisky quotidien à en croire son entourage). Authentique fou furieux, suicidaire, il trouva dans la boisson ce besoin de solitude, cette «tristesse paisible» à laquelle il aspirait et dont il mourra. «L’alcool est une drogue douce», disait-il. Dans Visions de Cody, Jack Kerouac démontre également l’importance de l’alcool pour maintenir le rythme de cette écriture vive qui l’avait rendu célèbre.
Charles Bukowski dira pour sa part: «L’alcool m’a mis dans des situations que je n’aurais jamais connues sans lui: des lits, des prisons, des bagarres et des longues nuits insensées. Durant toutes mes années de clochard et de banal ouvrier, l’alcool a été la seule chose me permettant de me sentir mieux. Ça m’a sorti du piège rance et boueux. Les Grecs n’appelaient pas le vin ‹le sang des dieux› pour rien.» Il ajoute en 1984 pour parler du rapport que les écrivains ont avec l’alcool: «Je ne pense pas que l’alcool détruise les écrivains. Je pense qu’ils sont détruits par l’autosatisfaction, leur enflure d’ego. Ils manquent d’endurance pour la simple et bonne raison qu’ils ont eu très peu de choses à endurer –ils ont du souffle, à leur début. »
Des heures plus heureuses
Mais écrire entraîne-t-il forcément la dérive de l’addiction à l’alcool ou aux drogues? L’ivresse est-elle véritablement nécessaire pour devenir un auteur de génie, un écrivain à succès? En d’autres mots, la mode des écorchés vifs n’a-t-elle pas créé un mythe, une légende autour de l’écriture du romancier torturé par ses démons?
Loin de l’ivresse maladive, Colette préfère savourer et s’émerveiller en bonne épicurienne des couleurs, des senteurs et des subtilités de chaque cru. «Je me vante d’avoir grandi, mûri, vieilli dans la familiarité du vin; à le tutoyer dès l’enfance, on perd l’esprit d’intempérance et de gloutonnerie; on acquiert, on forme son goût personnel.» Elle devient même viticultrice une bonne partie de sa vie, tout en se faisant l’ambassadrice des vins de Bourgogne.
Ils sont plusieurs comme elle à apprécier la dégustation de grands crus qui leur offre tout un univers sensoriel et leur permet de vivre des moments conviviaux leur inspirant des écrits plus denses et plus intenses. Ou à condamner l’alcoolisme, via la description de personnages s’y adonnant, perdus et fatigués. C’est ainsi que François Mauriac, dans le Sagouin, fait plonger Paule dans l’alcool et décrit le malaise d’une société. L’auteur possède un vignoble au château Malagar, mais préfère décrire les vignes du Bordelais que s’enivrer. Il ne niera pas pour autant le conflit intérieur des auteurs: «Toute douleur, toute passion engraisse l’œuvre, gonfle le poème. Et parce que le poète est déchiré, il est aussi pardonné.»
Dans les romans de Raymond Queneau, de Georges Perec et même chez Marguerite Duras, la consommation d’alcool est rarement solitaire: elle se fait dans des lieux publics, qui sont aussi ceux où se construit la vie sociale. L’alcool alors favorise l’expression d’une sociabilité heureuse, voire hédoniste, et tisse les liens relationnels entre des personnages qui se retrouvent au café, entre amis, en soirée. La boisson délie les langues, est signe de convivialité, d’appartenance à une classe.
Le point de bascule
À quel moment alors boire devient-il, chez les écrivains ou leurs personnages, un moyen de s’anesthésier face à des problèmes plus profonds? Un acte échappatoire qui constitue, dans ses excès, l’épiphénomène d’une souffrance existentielle? Chez Simenon, le commissaire Maigret va boire un verre dans un bistrot ou dans un bar, entre deux visites chez un suspect. Un petit verre par-ci, un grand verre par-là, tantôt à la hâte et en toute innocence, tantôt par nécessité, par dépit, par refuge, par réconfort, par consolation ou par addiction. Un besoin de s’accorder un petit plaisir pour supporter le quotidien, une volonté de s’embrumer l’esprit pour oublier ses soucis ou une dépendance qui cache une plus profonde dépression?
De fait, le rapport à la boisson définit la «personnalité profonde, individuelle et sociale» de bien des personnages … et de leurs créateurs qui, pour se sauver des autres, se perdent parfois eux-mêmes. Car si écrire reste l’exutoire des auteurs de génie qui marquent leur époque, la plume salvatrice à laquelle ils s’accrochent est parfois trop légère pour porter le poids de leurs souffrances. Pour garder le cap sur l’océan agité de leur mélancolie, la bouteille à la mer devient alors leur fidèle mais funeste compagne de voyage, comme un phare allumé par des naufrageurs.

