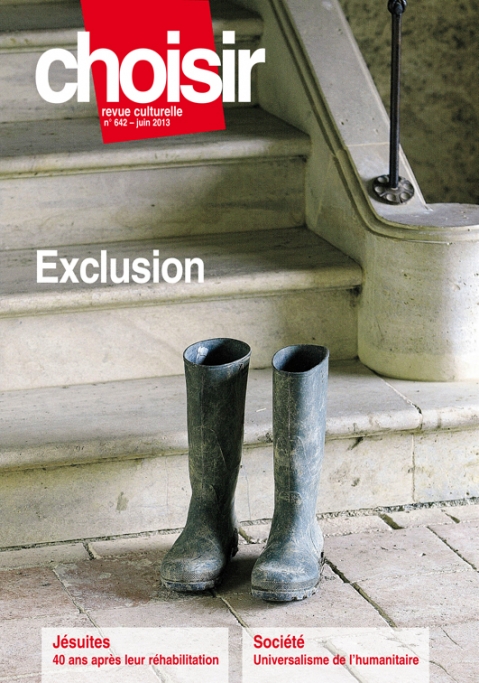Pauvreté, chômage, suicide, drogues... Le sommaire de ce numéro égraine un chapelet de misères, de situations de précarité ou de violence. Qu’on ne s’y méprenne pas, si la réalité n’est pas masquée, elle ne se veut pas pour autant écrasante. Au fil des articles, on se rend compte du nombre de gens qui se sont impliqués pour soulager leurs semblables, et des progrès réalisés sur le plan humanitaire en l’espace de deux siècles. Le XIXe siècle vit naître la Croix-Rouge ;[1] le XXe siècle fut, certes, celui de massacres innommables,[2] mais aussi celui des luttes pour les droits humains, sociaux et syndicaux. Quelles avancées éthiques nous réserve le XXIe siècle ? Qu’inventeront nos enfants ? Car si l’Occident a fait des bonds en avant inouïs sur le plan humanitaire et social, ces acquis doivent constamment être protégés et adaptés aux changements. Oui, la guerre contre la drogue a échoué. Oui, l’appauvrissement des classes moyennes est une réalité et le nombre de sans-abri, de mendiants, de chômeurs est en croissance. Oui, les solutions politiques s’avèrent souvent décevantes dans la pratique. A lire Olivier Guéniat,[3] membre de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, on se dit que tout est à ré-inventer à chaque fois ! Affronter les échecs, chercher des pistes d’évolution reste un devoir citoyen qui interpelle chacun d’entre nous.
 Timothy Snyders, Terres de sang. L’Europe entre Hitler, et Staline, Paris, Gallimard 2012, 720 p.
Timothy Snyders, Terres de sang. L’Europe entre Hitler, et Staline, Paris, Gallimard 2012, 720 p.
Il y a trois genres de livres : ceux qui nous font dresser les cheveux sur la tête, ceux qui nous font pleurer, ceux qui nous éclairent. Ces trois genres convergent dans l’extraordinaire ouvrage de Timothy Snyders, Bloodlands (2010), dont la traduction en français est parue récemment.
Nos cheveux se dressent sur la tête en raison des chiffres solides que donne cet auteur sur les massacres qui ont eu lieu de 1933 à 1945, entre Varsovie et Moscou, Kiev et Leningrad : 14 millions de morts dans la population civile et parmi les prisonniers de guerre, sans compter les victimes de la Deuxième Guerre mondiale.
La Fédération romande des socialistes chrétiens dit “non” à la modification de la Loi sur l’asile
RedactionNotre pays n’accueille qu’une toute petite partie des 43 millions de réfugiés du monde. Sensible au sort des personnes contraintes de quitter leur pays et refusant qu’elles soient indistinctement soupçonnées d’être des criminels ou des profiteurs, la Fédération romande des socialistes chrétiens (FRSC) ne peut accepter que la Suisse durcisse les conditions d’accueil des réfugiés et se soustraie à son devoir d’humanité.
Nous déplorons en particulier que la Suisse refuse de reconnaître l'objection de conscience comme droit humain. De nombreux Suisses ont subi la prison dans notre pays pour avoir réclamé ce droit que nous espérions désormais ancré dans nos mœurs.
Ne souhaitant pas que la Suisse doive, dans quelques décennies, s’excuser une nouvelle fois d’avoir fermé ses portes, la FRSC appelle fermement à voter contre la modification de la Loi sur l’Asile.
(com.)
Le pape François, comme ses deux prédécesseurs, n'a aucune expérience en matière de diplomatie internationale. Par le passé, de nombreux papes, tels Pie XII, Jean XXIII et Paul VI, étaient issus du corps diplomatique du Saint Siège. Ayant passé de nombreuses années au service du Vatican en tant que diplomates, ces papes étaient à l'aise dans le rôle d'hommes d'Etat habitués à la diplomatie. Au moment de leur accession au pontificat, ils connaissaient déjà la position du Saint Siège sur les questions internationales, et s'ils souhaitaient la modifier, ils le faisaient en toute connaissance de cause.
Un jésuite accuse le président Yudhoyono d’intolérance religieuse
RedactionLe Président indonésien, Susilo Bambang Yudhoyono, est, de facto, complice et artisan du climat d’intolérance religieuse et de la violence à l’encontre des minorités présente en Indonésie. Cette forte dénonciation a été lancée publiquement par le Père Franz Magnis-Suseno s.j., professeur de philosophie à Djakarta.
Le prêtre, qui est également un collaborateur de la revue internationale Oasis, a rédigé une lettre ouverte à l’Appeal of Conscience Foundation (ACF), prestigieux institut ayant son siège à New York, lorsqu’il a appris que la fondation en question entendait récompenser le président Yudhoyono « pour ses mérites dans le domaine de la tolérance religieuse ». « C’est une honte, écrit-il, qui discrédite une institution ayant des intentions morales ». Le Père Magnis-Suseno demande : « Ne connaissez-vous pas les difficultés croissantes des chrétiens pour obtenir les permis nécessaires à l’ouverture de lieux de prière, le nombre croissant d’églises fermées de force, l’augmentation des règlements rendant le culte plus difficile pour les minorités et donc la croissance de l’intolérance à la base ? »
Il rappelle « des attitudes honteuses et très dangereuses de la part de groupes religieux intransigeants envers ce qu’il est convenu d’appeler des groupes déviants, comme les membres d’Ahmadiyahoe ou les communautés chiites, alors que le gouvernement de Susilo Bambang Yudhoyono n’a rien fait ou dit pour les protéger. (...) Des centaines de personnes - au cours des années de la présidence de Yudhoyono - ont été chassées de leurs maisons et vivent encore misérablement dans des lieux tels que des gymnases. » Des fidèles ahmadis et chiites ont été tués « sur la seule base de motifs religieux » et le président Susilo Bambang Yudhoyono, en huit ans et demi de gouvernement, « n’a jamais parlé, pas même une fois, au peuple indonésien du respect des minorités, évitant honteusement toute responsabilité concernant la violence croissante ».
Franz Magnis-Suseno se déclare « pantois devant tant d’hypocrisie » et met en garde contre tout soutien, même indirect, fourni à ceux « qui veulent purifier l’Indonésie de tout ce qu’ils considèrent comme hérésie et paganisme ».
(fides/réd.)
Holy Motors, de Leos Carax, est diffusé sur Canal+ Cinéma, le 24 mai à 22h20 et le 25 mai à 2h05, ainsi que sur Canal+, le 28 mai à 1h35.
Les films de Leos Carax suscitent en France des réactions soit très hostiles soit hystériquement dithyrambiques. Treize ans après Pola X, son dernier long-métrage, le cinéaste français maudit des années 80 nous offre dans Holy Motors le meilleur de lui-même. « Je continue comme j’avais commencé : pour la beauté du geste », dit son alter ego dans le film (Denis Lavant, son acteur fétiche). Et c’est effectivement ce qu’il y a de plus fascinant dans ce film (et de plus rare dans le cinéma français actuel) : la beauté du geste cinématographique.
Faust, le film d'Alexandre Sokourov, passe en première diffusion sur Ciné + Club, ce 22 mai à 20h45.
Rediffusion : le 27 mai à 8h25, le 28 mai à 16h50, le 29 mai à 0h10 et le 31 mai à 15h55.
Le Russe Alexandre Sokourovest sans doute le plus important cinéaste contemporain. Après Moloch, Taurus et Le Soleil, Faust a été conçu comme le dernier volet d’une tétralogie sur les dictateurs (Hitler, Lénine et Hirohito). Le personnage de cet opus, qui tient plus cette fois de la fiction que de l’histoire (un docteur Faustus aurait existé au XVIe siècle), permet à Sokourov de réaliser comme une synthèse de ses méditations précédentes sur le pouvoir et la corruption. Le cinéaste y conserve néanmoins l’angle personnel, intime qui caractérise son approche des « monstres » de l’histoire du XXe siècle. Comme il l’a dit à Venise, où le film a remporté le Lion d’or à la Mostra : « Faust n’est pas une légende, ni un mythe, ce n’est qu’un être humain. »