Ce livre a pour but de mettre en lumière la présence des images religieuses (icônes, peintures, enluminures) dans ces Églises, et «d’en souligner les dimensions non seulement iconologique, mais aussi théologique et christologique». En effet, elles n’ont été que peu touchées, en règle générale, par la crise iconoclaste, ou Querelle des images, qui a secoué le monde byzantin aux VIIIe et IXe siècles.
Pour en savoir plus sur la querelle historique autour des images saintes et sur la théologie qui les accompagne, lire Images liturgiques ou images religieuses, de Michel Quenot, et Représenter l'irreprésentable, de Geneviève Nevejan.
Christine Chaillot présente donc des éléments historiques, des témoignages d’auteurs anciens, des réflexions de théologiens orthodoxes contemporains sur la théologie et la place des images dans trois traditions que l’auteure connaît de longue date et sur lesquelles elle a publié plusieurs ouvrages: l’Église orthodoxe syriaque d’Antioche, l’Église arménienne, la tradition copte d’Égypte et celle de l’Église éthiopienne.

Mais l’auteure insiste sur le fait que, partout, le rôle fondamental de l’icône est à la fois pédagogique et spirituel, visant à renforcer la foi des fidèles et appuyer leur prière. Parfois miraculeuse, elle ne doit cependant jamais être adorée, mais être vénérée parce que sa matérialité renvoie à ce qu’elle représente pour les croyants.
Un ouvrage de référence
Le grand intérêt de ce petit volume, qui n’a pas l’ambition d’être exhaustif, réside dans la foule de renseignements qu’il contient et les pistes qu’il suggère pour d’autres recherches. Aux nombreuses indications bibliographiques figurant dans les notes s’ajoutent des informations qui proviennent d’entretiens avec des interlocuteurs locaux ou appartenant à ces différentes traditions.
Une dernière partie offre des textes tirés des diverses liturgies de consécration des icônes, par ailleurs peu accessibles aux non-spécialistes. Cet ouvrage sera apprécié par celles et ceux qui souhaitent entreprendre des recherches systématiques sur le sujet. Ajoutons qu’il complète à certains égards le catalogue de la grande exposition sur les chrétiens d’Orient, présentée récemment à Paris, à l'Institut du monde arabe (voir l'article à ce sujet de Geneviève Nevejan, Christianisme oriental).


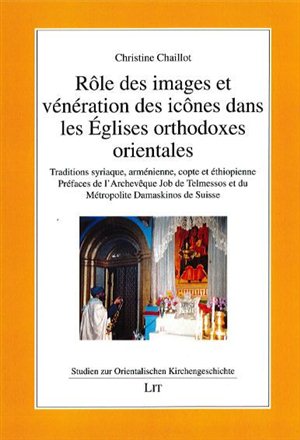 Cet ouvrage s’inscrit dans le contexte du dialogue entre Églises orthodoxes chalcédoniennes et Églises orientales non chalcédoniennes (ou pré-chalcédoniennes). L’auteure, spécialiste de l’orthodoxie orientale et très impliquée elle-même dans ce dialogue, a ajouté une postface à cette reprise de son livre paru une première fois en 1993.
Cet ouvrage s’inscrit dans le contexte du dialogue entre Églises orthodoxes chalcédoniennes et Églises orientales non chalcédoniennes (ou pré-chalcédoniennes). L’auteure, spécialiste de l’orthodoxie orientale et très impliquée elle-même dans ce dialogue, a ajouté une postface à cette reprise de son livre paru une première fois en 1993.