On raconte que Louis XIV, pour financer les guerres qu’il aimait tant, était obligé de pressurer d’impôts le peuple de France. La pression était d’autant plus forte que les fermiers généraux (chargés de collecter l’impôt) confisquaient, pour leur cassette privée, le plus gros de la recette. À quoi s’ajoutait ce fait que la noblesse -étant supposée payer «l’impôt du sang» en allant guerroyer, ou ayant acheté quelque charge honorifique- ne payait pas d’impôt, pas plus que le haut clergé. Effet induit: le poids des impôts pesait sur… la conscience du Roi Soleil! Celui-ci s’en ouvrit à son confesseur jésuite qui, après avoir pris l’avis de théologiens en Sorbonne, répondit que le scrupule royal n’avait pas lieu d’être… puisque le royaume était la propriété personnelle du Roi!
Cette parabole historique rassemble tous les ingrédients de l’injustice fiscale.La démocratie raconte une autre histoire. En témoigne l'ouvrage étasunien signé Emmanuel Saez et Gabriel Zucman -Le triomphe de l’injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie- récemment traduit en français (1). Pour les auteurs, comme pour moi, le consentement à l’impôt est le fondement de la démocratie. Le corollaire en est obvie: l’injustice fiscale devrait être étrangère à la démocratie. Cette visée s’appuie sur l’histoire parlementaire d’Angleterre, où le premier privilège du Parlement fut, contre les prétentions abusives du roi, de voter l’impôt. Ce principe s’imposa ensuite dans tous les pays démocratiques.
Problèmes posés par l’égalité
Qui dit démocratie dit égalité. D’où deux problèmes. Le premier tient à l’éthique publique; car on ne peut pas isoler les prélèvements de la dépense qui les conditionnent, puisque toute décision démocratique visant la dépense publique est «pour le peuple». Il faut donc prélever au prorata des dépenses nécessaires. Malheureusement, la dépense publique «nécessaire» est impossible à évaluer objectivement, car les besoins sont variables entre citoyens, et pour le même citoyen, au cours de sa vie. Sans parler de l’impossible balance entre les générations. Je pense aux infrastructures de communications, à la recherche -dont les retombées ne sont pas calculables-, à l’instruction et à toutes ces dépenses improductives -mais non pas inutiles- qui permettent d’espérer un meilleur avenir.
Le second problème -quasiment mathématique celui-là- tient l’égalité des prélèvements obligatoires au regard du montant des revenus et des patrimoines. L’écart constaté entre les revenus et entre les patrimoines est, depuis une quarantaine d’années, fortement croissant, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans la quasi-totalité des pays de la planète, tout particulièrement dans les pays en développement. Aux États-Unis, les 1% les plus riches possédaient 10% de la richesse nationale en 1970, aujourd’hui ils en possèdent 20%. Pire encore, en se concentrant sur les prélèvements que l’on peut juger avec les outils théoriques et empiriques dont disposent des économistes, les auteurs de l’étude précitée montrent que:
Les citoyens américains les plus riches paient proportionnellement moins d’impôts que ceux des classes moyennes.
Le diagnostic
Emmanuel Saez et Gabriel Zucman ne cherchent pas la cause de cette injustice. Dans leur livre, il n’est question ni d’exploitation du prolétariat, ni d’idéologie, ni de mondialisation du capital, ni de corruption, ni de stratégie monétaire et financière. Pour eux, tout semble se résumer dans la formule: l’occasion fait le larron. L’occasion, c’est la réglementation lacunaire. Le larron, c’est la firme multinationale et le spéculateur milliardaire qui cachent profits et patrimoines dans les paradis fiscaux ou qui jouent habilement avec la législation pour optimiser (c’est à dire finalement diminuer) leurs charges fiscales; ce que seuls les plus riches sont capables de faire.
De la mondialisation, les auteurs ne retiennent que la concurrence fiscale, prétexte aux baisses des prélèvements tant sur les sociétés que sur les personnes physiques. Mais, contrairement au nationalisme des divers populismes, il ne leur apparaît pas que la mondialisation soit un obstacle insurmontable. L’échange automatique d’informations administratives sur non-résidents ouvre la voie. La circulaire Fatca, bien connue des banquiers suisses, en fut le prototype. Toutes les banques qui travaillent, directement ou indirectement, avec les États-Unis doivent, sous peine de sanctions étasuniennes, faire remplir à tous leurs clients étrangers un formulaire indiquant les éventuels intérêts américains détenus par chacun d’eux. Pour le reste, les accords de double imposition éviteraient les distorsions les plus graves.
La plaie des paradis fiscaux
Comme le récent texte romain sur les questions économiques et financières (2), Emmanuel Saez et Gabriel Zucman prennent pour cible les «paradis fiscaux», sans trop d’ailleurs distinguer entre les paradis fiscaux aux taxes légères ou inexistantes, les centres off-shore qui facilitent les transactions avec l’étranger, et les territoires non coopératifs qui mettent des obstacles à l’entraide judiciaire internationale. (C’est dommage, car ces catégories -quoique souvent présentes toutes les trois dans un même pays- procèdent de logiques différentes qui appellent des stratégies de luttes différentes.) Le point aveugle de cette condamnation quasi-unanime est l’obstacle auquel se heurtent les accords internationaux capables de résoudre ce problème.
Non seulement la plupart de ces paradis ont été créé par des pays ayant pignon sur rue (notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis) lors de la décolonisation ou pour faciliter le développement de leurs champions nationaux à l’étranger, mais, plus encore, ces paradis sont utilisés par de nombreux pays pour payer les basses œuvres de leurs barbouzes, quand ce n’est pas pour rémunérer les fauteurs de déstabilisation politique dans les pays étrangers.
Chemin faisant, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman épinglent des situations qui font consensus. Ils se méfient de la TVA, car pour un même taux elle pèse proportionnellement davantage sur les populations les plus pauvres qui dépensent une plus grande part de leurs revenus. Avec la même logique, ils dénoncent les assurances-santé privées, qualifiées d’«impôt régressif».
Le remède pour les États-Unis
Condition de la démocratie, l’égalité fiscale se fera, selon nos auteurs, par le prélèvement progressif, donc à des taux croissants, jusqu’à 65% pour les plus hauts revenus. Selon leurs calculs, ce taux optimal ne serait peut-être pas le plus égalitaire, mais serait celui qui rapporterait le plus aux Caisses publiques. Très inférieur au maximum observé outre Atlantique dans les années trente, ce taux ne serait que très légèrement supérieur à celui qui régnait aux États-Unis dans la décennie d’après la dernière Guerre Mondiale.
Ce prélèvement à taux progressif serait appliqué à la somme des revenus directs, revenus du travail, revenus du capital, revenus fonciers, auxquels s’ajouteraient -comme en Suisse- les revenus virtuels des logements occupés par leur propriétaire. C’est ce que les auteurs appellent l’impôt sur le revenu national.
La logique aurait voulu qu’ils élargissent l’assiette de cet impôt (ce sur quoi l’impôt est assis) aux revenus virtuels des meubles meublant, des œuvres d’art et des bijoux appartenant aux contribuables. En effet, dans la logique de la société capitaliste, il serait d’évaluer en argent tous les plaisirs. La jouissance du bureau Louis XVI sur lequel j’écris cet article ou le plaisir de regarder le tableau de Manessier pendu dans mon salon se mesure, dans une économie monétarisée, au revenu dont je me prive en ne les vendant pas pour placer l’argent. Si ces objets ne m’apportaient pas autant de gratification que les valeurs mobilières déposées à la banque, je les vendrais pour investir en Bourse.
Pour des raisons pratiques -notamment la variation constante du prix de ces objets- nos auteurs ne vont pas aussi loin. Ils suggèrent quelque chose de moins satisfaisant pour l’esprit: un impôt progressif sur le patrimoine (de 2% à 5% par an selon le montant des avoirs nets de l’assujetti), assorti d’une forte taxation des héritages.
Problème d’optimisation fiscale
Plus problématique est leur diatribe contre l’optimisation fiscale. Emmanuel Saez et Gabriel Zucman estiment que les officines juridiques travaillant dans ce domaine au profit des entreprises multinationales ou des grosses fortunes «ne produisent rien», puisqu’elles ne font que déplacer, au dépend de l’État, des sommes qui restent à l’abri dans le patrimoine des plus riches. Ils parlent même de «cambriolage» (sic). Le mot n’est pas à sa place. Car, de deux choses l’une. Soit il y a illégalité du fait d’une rétention indue de ce qui revient à l’État et, dans un tel cas, il y a évasion fiscale ou fraude, qui relève d’une sanction administrative ou pénale; soit il y a application judicieuse de la loi. Ce dernier cas est d’ailleurs évoqué dès les premières lignes de l’introduction du livre. Dans un débat télévisé de 2016, Donald Trump a paradoxalement triomphé face à sa challenger Hillary Clinton -pourtant intellectuellement mieux armée et mieux préparée- qui lui reprochait de ne pas payer d’impôt. «That make me smart» (ça prouve que je suis malin), répondit le candidat qui, par ce mot cynique, s’est mis dans la poche tous les contribuables lassés des tracasseries des gabelous américains.
Ce genre de problème est difficile à résoudre. Soit on fait appel, comme en France, à la notion d’abus de droit -il faut alors que l’administration fiscale prouve que le montage financier a eu pour seul objectif de tromper le fisc- soit on fait la toilette du mille-feuilles fiscal pour le simplifier et en supprimer les ambiguïtés. Cela n’est possible que, accords internationaux aidant, si l’État abandonne l’ambition de courir plusieurs lièvres fiscaux à la fois: outre l’équité, la rentabilité des prélèvements, l’efficacité des services fiscaux, la politique régionale ou sectoriel que l’on veut favoriser par des allègements pour attirer les investissements.
Pas de baguette internationale
L’injustice fiscale des États-Unis n’est évidemment pas une exception. Toute démocratie appelle la justice fiscale. C’est d’ailleurs l’argument de vente de la traduction française de cet ouvrage. En conviendra tout lecteur soucieux du bien commun ou désireux d’éloigner les dangers populistes. Cependant, je ne crois pas que doive s’imposer partout la démocratie conçue par les Étasuniens -la meilleure que l’on puisse se «payer», disent les facétieux. «Choix rationnel du citoyen bien informé», prétendent les auteurs. Ils oublient les contradictions culturelles, politiques et sociales de la vie publique. Comme si l’on pouvait accéder, les mains propres, au bien commun!
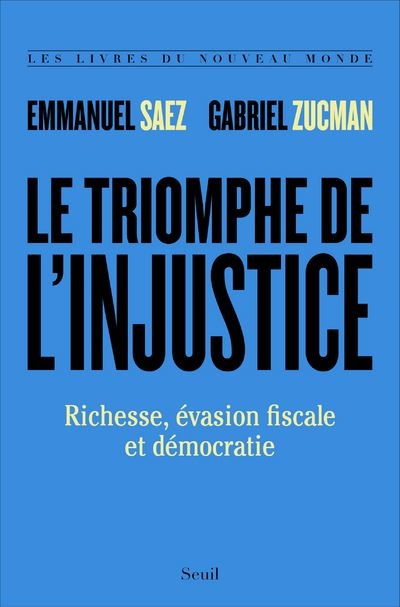
1. Emmanuel SAEZ et Gabriel ZUCMAN, Le triomphe de l’injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie, Paris, Seuil 2020, 296 p.
2. Œconomicæ & Pecuniariæ Quæstiones, Congrégation pour la doctrine de la foi et Dicastère pour un développement humain intégral, Rome 17 mai 2018.


 Le candidat démocrate pour la présidentielle américaine du 3 novembre, Joe Biden, a intégré dans son programme une augmentation de la fiscalité sur les hauts revenus. Une mesure qui répondrait aux importantes baisses d'impôts concédées par Donald Trump aux plus riches, dans la droite ligne du mouvement amorcé par Donald Reagan en 1981. Pour des questions pragmatiques, deux économistes français de l'Université de Berkeley, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, ont remis en question ce système fiscal. Leur livre a eu un certain retentissement aux États-Unis et a été traduit en français ce printemps. L'économiste jésuite Étienne Perrot y revient.
Le candidat démocrate pour la présidentielle américaine du 3 novembre, Joe Biden, a intégré dans son programme une augmentation de la fiscalité sur les hauts revenus. Une mesure qui répondrait aux importantes baisses d'impôts concédées par Donald Trump aux plus riches, dans la droite ligne du mouvement amorcé par Donald Reagan en 1981. Pour des questions pragmatiques, deux économistes français de l'Université de Berkeley, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, ont remis en question ce système fiscal. Leur livre a eu un certain retentissement aux États-Unis et a été traduit en français ce printemps. L'économiste jésuite Étienne Perrot y revient.