La République des Philippines fut créée en 1946, quand les Etats-Unis décidèrent d’accorder à leur colonie son indépendance. Il y eut beaucoup d’exaltation populaire, et des hommes et des femmes politiques affichèrent la volonté de reformer le pays et de mettre en place un Etat respectueux des droits humains et sociaux. Hélas, la classe politique s’est vite montrée incapable de combattre la corruption et de défendre les intérêts du peuple face aux vautours de la finance internationale.
De façon diachronique, l’auteur analyse les rapports entre l’Eglise et le pouvoir séculier dans cette région insulaire. Instrument de consolidation du pouvoir colonisateur, le catholicisme introduit par les Espagnols est devenu un élément unificateur de régions éloignées les unes des autres et de groupes de populations disparates, aux coutumes et parlers différents. Grâce au clergé indigène, qui a émergé en dépit de la résistance initiale de la hiérarchie catholique, l’Eglise a pu jouer le rôle, à certains moments, d’un levier de progrès, et apporter un soutien aux mouvements de résistance, favorisant par exemple le départ du dictateur Marcos et l’accession au pouvoir de Corazon Aquino.
L’auteur ne cache pas pour autant son désaccord avec le positionnement de la Conférence des évêques catholiques des Philippines sur la question du contrôle des naissances, qui mine les efforts étatiques en vue d’enrayer l’augmentation de la population pour garantir de meilleures conditions de vie à tous.
Le Père de Charentenay est un chercheur aux formations polyvalentes (théologie, sociologie, sciences politiques) et aux expériences professionnelles variées. Après avoir présidé les Facultés jésuites de Paris, il a passé six ans au service du Bureau européen des jésuites, puis est devenu rédacteur en chef du mensuel Etudes. Ses connaissances profondes lui permettent d’éclairer son sujet sous des angles divers et nous valent un instrument de travail précieux.

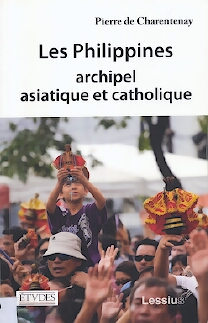 Pierre de Charentenay
Pierre de Charentenay
Les Philippines. Archipel asiatique et catholique
Namur-Paris, Lessius 2015, 190 p.
Le jésuite Pierre de Charentenay trace six siècles d’histoire de l’ensemble insulaire situé au sud-ouest de la Chine que les navigateurs ibériques avaient appelé Philippines, en l’honneur du prince héritier et futur roi Philippe II d’Espagne. L’auteur a beaucoup d’affection pour ce pays - où il a résidé en 2013 - et pour ses habitants, dont il loue le caractère travailleur, conciliant, accueillant et créatif. Doués pour produire des « cultures hybrides », les Philippins ont su équilibrer leurs valeurs locales et traditionnelles avec les apports des colonisateurs successifs espagnol et américain.
Grâce à un rythme de narration animé et une information riche et documentée, l’auteur nous fait partager son amour pour ces îles. La culture et l’histoire du pays sont aussi envoûtantes que les événements survenus lors des dernières décennies sont tragiques.
