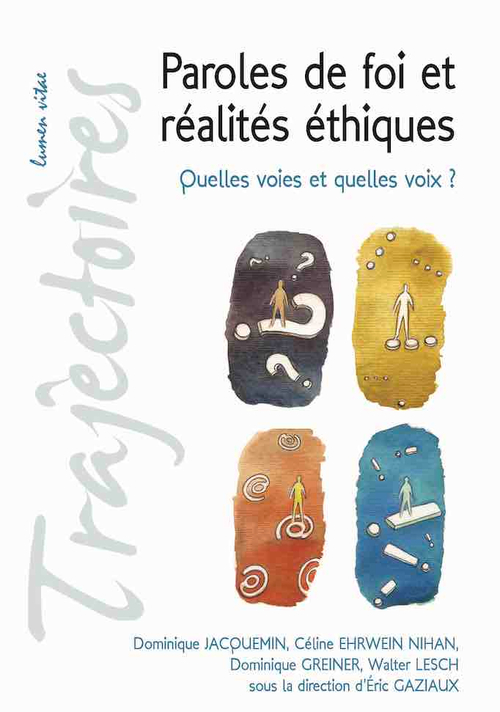Le ton professoral et les références philosophiques (Hannah Arendt, Nathalie Sarthou-Lajus, Cornélius Castoriadis…) s’appliquent à des situations très actuelles: la législation et la pratique de l’euthanasie en Belgique, qui ouvre un immense champ de réflexion sur la notion de transgression; les implications de la théorie du «genre» qui prend acte du décalage possible entre la différence physiologique des sexes et l’appréhension par l’individu de son identité sexuée; l’impossible fondement politique d’une morale universelle; l’hégémonie de l’économie dans notre société où la polysémie (pour ne pas dire la cacophonie) de l’éthique est chahutée par la mondialisation financière.
Finalement, peut-on encore parler d’Une éthique d’inspiration théologique? Les contributions rassemblées dans cet ouvrage induisent une réponse négative. D’ailleurs, un certain flou conceptuel y conduit. Surtout si l’on confond ce qu’il convient de distinguer: d’une part l’éthique qui, faisant face à des dilemmes et appelant de nécessaires compromis, est la mise en œuvre du discernement personnel guidé par la conscience; d’autre part la morale, qui rassemble les règles « universelles » qu’impose chaque société pour que ses membres vivent ensemble sans trop de violence.