«Une frange […] large de gens [sont] fondamentalement payés à ne rien faire», s’étonnait David Graeber dans un petit article publié en 2013 dans le magazine militant Strike. Il relevait, dans son article intitulé «On the Phenomenon of Bullshit Jobs», une proportion grandissante de cadres et employés administratifs se sentant occupés à des tâches absurdes, inutiles, voire nuisibles pour la société. Cinq ans plus tard, cet éminent professeur à la London School of Economics publie Bullshit jobs, la version longue de l’article devenu viral sur Internet quelques années plus tôt.
«Une des nanas du service pub est arrivée devant moi et a balancé des milliers de trombones sur mon bureau en me demandant de les classer par couleur. J'ai cru qu'elle plaisantait, mais non. Je me suis exécutée, pour me rendre compte un peu plus tard qu'elle continuait à les utiliser sans prêter la moindre attention à leur couleur.» L’article a succès a permis à l’anthropologue et économiste de récolter un nombre impressionnant de témoignages similaires à celui-ci. Souvent cocasses, parfois affligeants, les exemples glanés par David Graeber lui ont permis d'affiner sa définition du «job à la con», tout en traçant les contours d’un phénomène qui tend à se répandre.
Une définition toute subjective de l’inutilité
En contradiction flagrante avec une économie de marché se voulant efficiente, le monde du travail décrit par Bullshit jobs relève plus de la féodalité managériale. Les salariés sont progressivement remplacés par des machines, mais maintenus occupés grâce à des tâches prétextes dans l’unique but de les garder prêts à consommer. Le travail perçu comme une souffrance forge le caractère et «autorise» l’employé à s’offrir ce qui lui fait plaisir une fois la partie pénible de sa journée achevée. Pourtant, la plus grande partie de la démonstration de l’auteur repose sur les témoignages collectés suite à la parution de son premier article. Nous somme donc moins dans une définition de ce qu’est l’inutilité que dans le sentiment qu’en ont les salariés.
David Graeber le confesse d’ailleurs au détour d’un paragraphe que le lecteur pourrait manquer s’il n’est pas attentif. «Mon objectif n’est pas tant d’établir une théorie de l’utilité sociale ou de la valeur sociale que de comprendre les retombées psychologiques, sociales et politiques du fait que tant d’entre nous travaillent avec la croyance intime que leur job n’a aucune utilité sociale ou valeur sociale.»
Tentons une autre approche peut-être plus positive de ces bullshit jobs. Considérés comme inutiles, voire nuisibles à l’épanouissement des salariés, ces «boulots à la con» reflètent peut-être une impossibilité à nommer des tâches de plus en plus transversales, où le savoir se déploie bien au-delà de la compétence technique décrite sur le papier et qui dépasse souvent la spécialisation du travail pour se focaliser sur l’humain dans son entier.


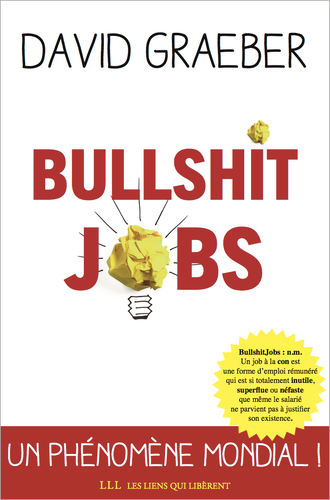 Larbins, rafistoleurs ou encore cocheurs de cases sont autant de termes fleuris pour définir les «jobs à la con» qui se sont multiplié de manière exponentielle ces dernières années. Cette typologie peut prêter à sourire, mais loin de se réjouir d'être payés à ne rien faire, ces employés ont en commun de considérer que leur travail n’a aucun sens.
Larbins, rafistoleurs ou encore cocheurs de cases sont autant de termes fleuris pour définir les «jobs à la con» qui se sont multiplié de manière exponentielle ces dernières années. Cette typologie peut prêter à sourire, mais loin de se réjouir d'être payés à ne rien faire, ces employés ont en commun de considérer que leur travail n’a aucun sens.