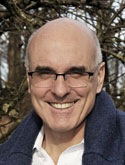Multiples ont été les commentaires des exercices spirituels à travers l'histoire. Celui que François Marty nous propose a l'originalité de nous faire entrer au coeur des exercices, tant il est vrai que « ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme mais de sentir et de goûter les choses intérieurement». En effet, l'auteur lit le texte ignatien en s'attachant à comprendre ce qui en fait une de ses spécificités. Dans une première partie, il explore le parcours proposé par le texte en dégageant bien le rôle des sens et de l'imagination qui est propre à chacun : « Quand il s'agit de sentir et goûter, nul ne peut le faire à ma place, c'est à chacun de prendre en charge cette expérience. Ainsi en va-t-il du chemin spirituel, car il n'y a pas de modèle standard pour l'écoute du Maître intérieur. »[1] La première semaine (comment appliquer nos sens à ce qui est repoussant comme l'enfer ?) se distingue des trois semaines suivantes où « réfléchir en soi-même » s'entend au sens du reflet. Cette expression signale la dimension contemplative. Suivant Jésus-Christ, le retraitant, métamorphosé par la rencontre de Dieu, en réfléchit la gloire car « c'est quand on se tourne vers le Seigneur que le voile tombe » (2 Co 3,16). La contemplation évangélique s'inaugure puisque appel est fait d'emblée au regard et à l'écoute. Si la bonne nouvelle n'est pas absente de la première semaine, c'est bien parce que la croix, sans le chemin qui y conduit,[2] y est plantée. Elle est pardon offert pour tout ce qui, en l'humanité, se met du côté de la mort. La méditation - discours parcourant causes et effets - va aider le retraitant, à la lumière de la croix, à prendre conscience de ce qui le sépare du salut. L'imagination n'en est bien sûr pas exclue, elle qui, comme le dit l'auteur, « est plus enfouie dans le sujet, aux racines de la jonction de l'âme et du corps, racine qui n'est vivante que dérobée au regard, enfouie ».[3] Proche de la mémoire, elle taille dans le donné des sens du corps, ouvrant ainsi un champ où elle bascule « de trésor du passé à [celui] d'une attente prévoyante, dont la plus haute fonction est de permettre l'imprévu »[4] que l'Esprit saint fera germer.
Se laisser toucher
L'analyse que fait l'auteur des trois dernières semaines mériterait à elle seule un long exposé. Elle montre comment le sentir est transformé par la fréquentation des scènes évangéliques. En effet, alors que dans l'histoire les exercices spirituels ont souvent été interprétés dans une ligne volontariste, l'auteur démontre combien le retraitant est invité à se laisser affecter par le récit évangélique. Ainsi, en deuxième semaine, en cette interruption du récit que constitue l'appel du Roi, il est proposé que « ceux qui voudront s'affecter (se querran afectar) et se distinguer davantage en tout service de leur Roi éternel et Seigneur universel? feront des offrandes de plus grande importance » (ES, 97,1-2). « S'affecter », c'est se laisser toucher. La sensibilité, cette faculté du vivant, est engagée puisqu'elle est touchée par ce qui est extérieur. En effet, c'est bien par l'appel d'une personne, altérité irréductible, qu'il s'agit de se laisser toucher évitant ainsi de sombrer dans le subjectivisme du sentiment. « Travaillant » par les affects le désir profond, les exercices spirituels sont une voie qui permet de sortir de l'étroitesse volontariste et assure la stabilité d'un choix fondé sur Dieu. La transformation du sentir est donc bien le fruit de la contemplation évangélique « qui ne saurait être évangélique si elle ne parvenait pas peu à peu à évangéliser la sensibilité elle-même ».[5]
Le sensible
Dans une deuxième partie, F. Marty cherche à rendre compte de l'actualité des exercices spirituels dans un monde marqué par l'abstraction technique qui a ouvert les portes à la mondialisation. En ces lieux, la sensibilité a de la peine à faire valoir ses droits. Que l'on pense au phénomène d'Internet où l'on est instantanément à Paris, Pékin et New York et où l'on est virtuellement présent partout. En ce monde virtuel, espace et temps sont abolis. Or l'homme s'inscrit justement, par les racines mobiles que sont ses sens, dans un espace et un temps. Le sensible est sa demeure sans être sa prison. L'auteur met bien en perspective, par la linguistique et l'anthropologie psychanalytique, combien l'homme est un corps signifiant, corps sensible et réel. L'émergence de la sensibilité - qui signale le vivant et permet le langage - est prise en compte par l'imagination qui, délivrant la sensation de l'éphémère, la donne à la mémoire du retraitant. Pan de la mémoire ouvert sur l'avenir, elle lui permet de laisser son histoire être rejointe et touchée par celle de Dieu. C'est dire combien les sens du corps et de l'imagination sont médiations pour la contemplation évangélique. L'application des sens proposée en fin de journée le confirme bien. L'enjeu étant de voir, dans la tradition des sens spirituels, l'invisible de Dieu dans la visibilité de Jésus qui nous est donnée dans le corps des Ecritures. Réfléchissant sur les chances et les risques de notre époque (la mondialisation, le multimédia, l'écologie, l'interreligieux) ce livre étonnant montre bien la complexité, la richesse et le caractère personnalisant des exercices. Il propose une lecture originale et stimulante qui démontre la pertinence du parcours ignatien dans un monde où l'homme est d'autant plus happé par l'instantanéité du plaisir qu'il est déconnecté de sa sensibilité. Si Dieu divinise ce que l'homme humanise, les exercices sont une voie royale pour aller à Dieu.
1 - François Marty, Sentir et goûter, p. 11.
2 - A la différence de la troisième semaine où le retraitant est invité à contempler « le chemin de la passion du Christ » et où l'on passe de la honte et la confusion portant « sur soi-même » de la première semaine, à une confusion douloureuse « pour ce qu'un autre va souffrir ».


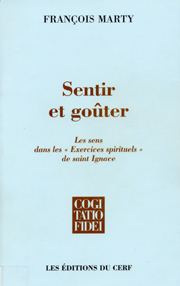 François Marty, Sentir et goûter. Les sens dans les « Exercices spirituels » de saint Ignace, Cogitatio Fidei (241), Cerf, Paris 2005, 320 p.
François Marty, Sentir et goûter. Les sens dans les « Exercices spirituels » de saint Ignace, Cogitatio Fidei (241), Cerf, Paris 2005, 320 p.