Se connaître soi-même est la plus difficile des choses. Un conte indien raconte l’histoire d’une biche musquée qui avait perçu, dès la naissance, un parfum qui l’avait fascinée. Dès qu’elle eut conquis son indépendance, elle partit à la recherche de cette odeur merveilleuse, promesse de plénitude et d’épanouissement. Elle en percevait par moment les effluves et se précipitait dans sa direction mais, à peine arrivée, le vent tournait et la faisait disparaître.
Elle parcourut ainsi des pays et des continents, jusqu’à ce que, fatiguée, désespérée, croyant sa recherche vaine, elle se jeta du haut d’une falaise. Dans sa chute, sa glande à musc se déchira, libérant le parfum. C’est ainsi que la biche de l’Himalaya apprit, au moment de sa mort, que ce qu’elle avait cherché partout au dehors était caché au fond d’elle.
Cette histoire rejoint le récit de l’enfant prodigue chez saint Luc (15,11-32). Un riche propriétaire avait deux fils. Le cadet réclamant sa part d’héritage quitte la maison, mène une vie déréglée et en paie durement les conséquences. À bout de forces, se souvenant de la situation heureuse qui était celle de son enfance, il prend le chemin du retour. À sa grande surprise, le père l’accueille sans reproches. Mieux, il organise une fête et tue le veau gras. S’en-suit la colère de l’aîné, resté au travail dans le domaine paternel, qui s’estime injustement traité. Le père lui fait remarquer qu’il dispose de tout à la maison mais qu’il ne semble pas avoir su en profiter. Il est, quant à lui, tout à la joie d’avoir retrouvé son cadet et convie tout le monde au festin. L’allégresse est générale, sauf pour l’aîné.
La joie de la retrouvaille
La leçon de ce récit est double. Le cadet n’a pensé qu’à s’emparer de l’héritage. Il n’en a pas profité puis-qu’il l’a dilapidé. Au fond, il était jaloux de la richesse paternelle. Il l’a saisie comme le ferait un voleur, sans accorder la moindre attention au lien filial. Quand il revient, affamé, il songe simplement à rejoindre la condition des serviteurs du domaine qui profitent du logement et du couvert. Il espère obtenir la bienveillance du maître et ne pas être rejeté. Or le patriarche ne mentionne ni les dépenses ni l’immoralité, seul compte pour lui le lien. Et voilà que celui-ci est restauré: le fils perdu est retrouvé. 
C’est un thème récurrent de l’Évangile, la retrouvaille apporte plus de joie que la paisible possession. Ainsi de la femme qui a perdu une pièce de monnaie ou du berger sa brebis. Ce que nous enseigne la parabole, c’est que nous négligeons la valeur de ce que nous possédons sans effort. Nous n’en prenons conscience qu’après l’avoir perdu.
Mais la vraie dramatique du récit se trouve dans la situation de l’aîné, l’héritier désigné du domaine. Pas plus que le cadet, il ne reconnaît la bonté du père. Il travaille, et sans doute le fait-il énergiquement, mais avec une mentalité de mercenaire, d’un ouvrier supérieur. Il n’a pas compris que l’amour du père importe plus que la propriété. Il ne s’est pas reconnu comme le fils aîné et préféré. D’où sa rage de voir l’ingrat et coupable cadet être chaleureusement accueilli dans les bras du père.
L’aîné boude. Il ne veut pas participer à la fête malgré l’exhortation paternelle. La musique et les chants lui vrillent les oreilles, il remâche sa rancune. Sera-t-il capable de s’en extraire? De se tourner vers la vie, vers la réconciliation et la joie? La parabole ne le dit pas, mais nous renvoie la question.
J’ai accompagné bien des personnes au bord de la mort. Bienheureuses celles qui, en fin de vie, se sont retrouvées dans la position du cadet. Et dure la condition de celles qui se sont volontairement retirées de la fête, enfermées dans leur jalousie.
Sisyphe en quête de sens
Les deux récits (le conte et la parabole) nous le disent: il est bon de partir pour se retrouver. Les philosophes de l’Antiquité avaient un faible pour la pensée cyclique: toute existence revient au point de départ. Ils observaient beaucoup le ciel et les astres, l’admirable régularité du mouvement des étoiles, ainsi que la vie sur terre, avec ses changements de saisons, de climat, la mort des plantes et des animaux, la variation de nos humeurs, le délabrement de nos corps et de notre santé, la fragilité des organisations sociales.
Notre monde n’est que destruction ou reconstruction, rien n’est stable. Le sage qui observait les réalités célestes en concluait que tout n’est qu’illusion. Au-dessus, très loin, très haut, les sphères divines tournaient selon un rythme impassible et irréversible. Ne nous laissons pas émouvoir par le fugace, recommandait-il. Tout est écrit, ordonné, décidé. Conservons notre paix intérieure, car le cosmos vit selon sa logique et sa beauté, insensible à nos émotions et à nos terreurs passagères. Regardons les vagues battre le rivage. Elles viennent avec force, s’épuisent à remonter la grève, puis, après une hésitation, se retirent en douceur. Aussitôt, nullement découragée, la suivante reprend l’assaut. Depuis des millénaires, la mer éprouve la résistance des côtes et ne s’en détourne jamais. Les plantes manifestent la même patiente obstination. Elles poussent, fleurissent, donnent des fruits, des graines, puis abandonnent le terrain à leur postérité. Depuis des siècles, un vieux chêne relâche chaque hiver des milliers de glands et laisse aux écureuils le soin de les disperser. En toute sérénité. La vie sur terre n’est que recommencement. Combien de terribles catastrophes n’ont-elles pas failli détruire toutes les espèces animales?
Nos propres ancêtres ont frôlé plusieurs fois l’extinction. La laborieuse espèce humaine sème, bêche, récolte, engrange, année après année. Elle reconstruit ses demeures après les tempêtes, les incendies, les guerres. Engendre des enfants après les épidémies. Elle a l’espérance chevillée au corps. Et conserve en secret, au fond du cœur, le souvenir de toutes ces peines. Je soupçonne les plantes et les animaux de sauvegarder obscurément la mémoire de l’immense souffrance du vivant. Mais je sais que l’homme la garde vive jusque dans la moelle de ses os.
La plénitude chrétienne
Qu’en fait-il? Ce qu’il y a de terrible dans la condition humaine, c’est la conscience. D’où cette question, que chaque homme doit résoudre individuellement: cela en vaut-il la peine? Platon pensait que la connaissance était le rappel d’une chose déjà connue. De fait, quand nous faisons une découverte vraiment profonde, nous avons souvent l’impression de l’avoir, d’une manière ou d’une autre, toujours sue. Le présent rejoint alors le passé et donne un sentiment d’unité englobant.
L’expérience spirituelle est proche de l’ajustement optique, quand le réglage des jumelles fait passer une image du flou au net. La mise au point spirituelle évacue des visions troublées et contradictoires, pour faire apparaître une icône parfaitement claire et limpide. Il en résulte une satisfaction profonde, que l’on peut appeler béatitude. Le sens et l’image, l’icône et le logos, s’interpénètrent et provoquent une unification bienheureuse.
La plénitude chrétienne, le Plérôme, n’est donc pas un simple retour en arrière, une nouvelle étape dans le recommencement perpétuel, c’est un achèvement ultime. Elle reprend toute l’histoire et la transforme en plénitude.
Le chevrotin de l’Himalaya ne pouvait que constater sa méconnaissance en mourant. Le frère aîné, lui, peut maintenant choisir librement son destin. S’il prend le chemin de la réconciliation, il peut trouver la paix et entrer dans la fête. S’il tourne le dos, il s’en va vers la solitude et le malheur.


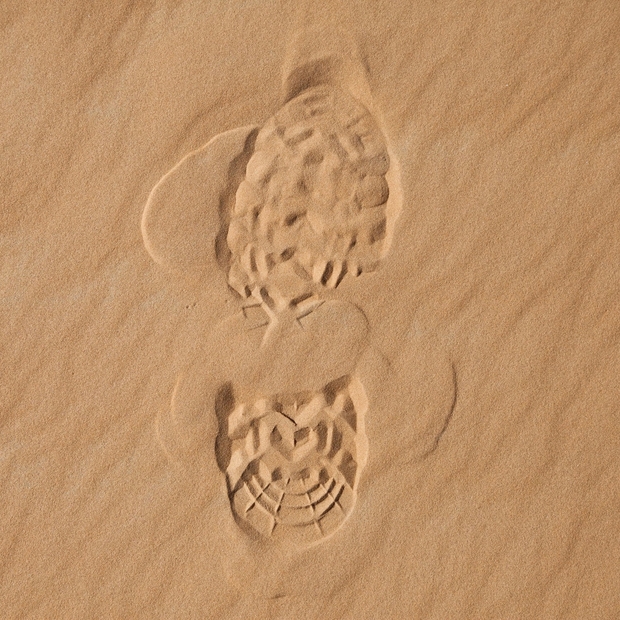 Le mythe de Sisyphe illustre l’absurde de l’éternel recommencement des cycles terrestres. Ainsi en est-il du venir et du partir. Comment trouver du sens dans notre monde? L’espérance chrétienne propose une rupture, l’offre d’un nouveau départ et une réconciliation finale. La parabole du fils prodigue nous y invite.
Le mythe de Sisyphe illustre l’absurde de l’éternel recommencement des cycles terrestres. Ainsi en est-il du venir et du partir. Comment trouver du sens dans notre monde? L’espérance chrétienne propose une rupture, l’offre d’un nouveau départ et une réconciliation finale. La parabole du fils prodigue nous y invite. 