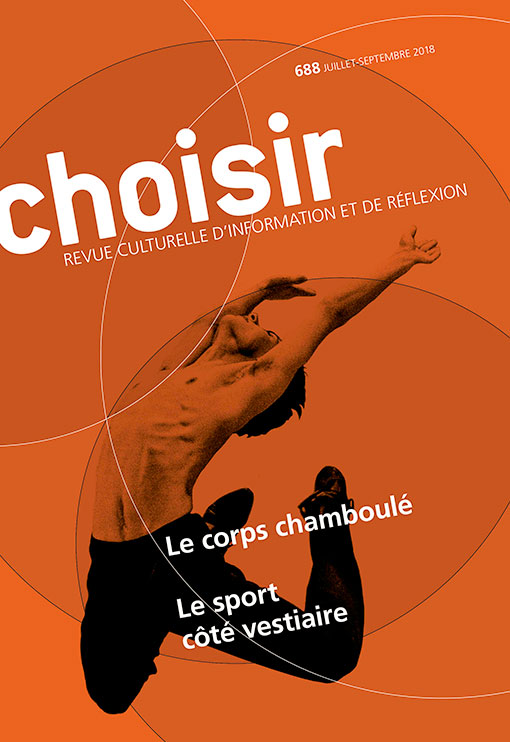Sous la direction de
Odile Hardy
Le Transhumanisme
Homo novus ou fin de l’homme ?
Les Plans-sur-Bex, Parole et Silence 2017, 174 p.
Ce livre présente les actes d’un colloque qui s’est tenu en octobre 2015. Il contient six contributions, les unes cherchant à définir le transhumanisme, les autres l’évaluant du point de vue chrétien. Ainsi l’homme nouveau, est-il de l’humain en continuité ou de la machine en rupture? Le christianisme parle moins de l’homme augmenté que de l’homme transfiguré, souligne Jean-Marc Moschetta, l’un des contributeurs. Et Jean-Michel Maldamé, dans La foi au défi du transhumanisme: le corps humain entre désir et réalité, met en évidence que le transhumanisme ne voit le corps qu’au prisme de la performance, comme une extension du projet eugéniste : corriger et prolonger la vie dans une perspective hédoniste. Il n’est plus question de finitude dans le transhumanisme ; nous sommes dans une projection nostalgique qui va du pareil au même. Le post-humanisme cherche à dépasser la condition humaine et à faire émerger une nouvelle humanité. Le corps y est considéré comme une machine.
 Rares sont les croyances qui se prêtent à autant de fantasmes que les religions africaines. Loin des clichés, c’est à une exploration de l’orthodoxie des grandes religions monothéistes jusqu’aux pratiques magiques que nous convie Afrique. Les religions de l’extase, dernier opus du MEG, le musée d’ethnographie de Genève.
Rares sont les croyances qui se prêtent à autant de fantasmes que les religions africaines. Loin des clichés, c’est à une exploration de l’orthodoxie des grandes religions monothéistes jusqu’aux pratiques magiques que nous convie Afrique. Les religions de l’extase, dernier opus du MEG, le musée d’ethnographie de Genève.
Geneviève Nevejan s’est entretenue avec Boris Wastiau, commissaire et directeur du MEG depuis 2009, anthropologue, africaniste et professeur d’Histoire et anthropologie des religions à la Faculté des lettres de l’Université de Genève.
 En l'espace de deux mois, cette année, sont sortis trois films américains et deux films français traitant du christianisme.[1] De quel phénomène étrange ces vaguelettes venues d’outre-Atlantique et de l’aval rhodanien sont-elles le signe? Sont-elles nées d’une faille laissée béante par le mouvement de déchristianisation accélérée de nos sociétés occidentales? En tous cas, elles n’ont pas la même forme selon leur origine.
En l'espace de deux mois, cette année, sont sortis trois films américains et deux films français traitant du christianisme.[1] De quel phénomène étrange ces vaguelettes venues d’outre-Atlantique et de l’aval rhodanien sont-elles le signe? Sont-elles nées d’une faille laissée béante par le mouvement de déchristianisation accélérée de nos sociétés occidentales? En tous cas, elles n’ont pas la même forme selon leur origine.
Patrick Bittar, Paris, réalisateur de films
Elle savait bien sûr que dans moins d’un mois, 28 jours exactement, elle aurait atteint l’âge fatidique de la retraite - 64 ans maintenant, comme pour toutes les femmes travaillant à Genève. Elle se réjouissait de ce temps qui s’étendait à perte de vue devant elle, comme une plaine légèrement caressée par un vent venu du sud.
Danielle Meynet, Genève, Ecrivain
 Au niveau des Jeux olympiques, la Suisse n’est pas en reste: Jeux d’hiver en 1928 et en 1948, JO de la Jeunesse d’hiver à Lausanne en 2020. Mais le vent tournerait-il? Les Valaisans ont refusé, le 10 juin dernier, la candidature de Sion 2026 par 54 % des voix. Ses défenseurs assuraient que ces JO seraient porteurs d’un engagement profitable pour l’économie des régions concernées. Que valent vraiment les études d’impact des évènements sportifs? La réponse d’un spécialiste.
Au niveau des Jeux olympiques, la Suisse n’est pas en reste: Jeux d’hiver en 1928 et en 1948, JO de la Jeunesse d’hiver à Lausanne en 2020. Mais le vent tournerait-il? Les Valaisans ont refusé, le 10 juin dernier, la candidature de Sion 2026 par 54 % des voix. Ses défenseurs assuraient que ces JO seraient porteurs d’un engagement profitable pour l’économie des régions concernées. Que valent vraiment les études d’impact des évènements sportifs? La réponse d’un spécialiste.
Ancien cadre du Comité international olympique (1982-1987), Jean-Loup Chappelet a lancé en 1995 le premier cours de politique et management du sport en Suisse. Il a été directeur de l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) de 2003 à 2012.
Entraîneurs et athlètes
Roberta Antonini Philippe et Ophélia Dysli-Jeanneret «Un seul acte, mais deux désirs qui se rencontrent.»[1] Depuis une cinquantaine d’années, la psychologie du sport s’intéresse aux relations particulières dans le sport de compétition entre l’athlète et l’entraîneur qui partagent le même idéal: la performance.
«Un seul acte, mais deux désirs qui se rencontrent.»[1] Depuis une cinquantaine d’années, la psychologie du sport s’intéresse aux relations particulières dans le sport de compétition entre l’athlète et l’entraîneur qui partagent le même idéal: la performance.
R. Antonini Philippe est docteur en psychologie du sport et maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des sciences du sport de Lausanne; O. Dysli-Jeanneret est cheffe du Service des sports d’Yverdon depuis 2016. Les deux femmes ont travaillé à la Haute école fédérale du sport de Macolin.
 Le sport moderne a été inventé par et pour les hommes à la fin du XIXe siècle. Les femmes ont dû conquérir le droit de pratiquer une activité sportive. Aujourd’hui encore, les infrastructures ou l’offre d’activités sportives par le biais des clubs bénéficient en majorité aux hommes (pour 70 % à Genève).[1] Alors, le sport serait-il un des derniers remparts de la ségrégation entre les sexes? Une mixité repensée serait bienvenue. La Ville de Genève empoigne la question.
Le sport moderne a été inventé par et pour les hommes à la fin du XIXe siècle. Les femmes ont dû conquérir le droit de pratiquer une activité sportive. Aujourd’hui encore, les infrastructures ou l’offre d’activités sportives par le biais des clubs bénéficient en majorité aux hommes (pour 70 % à Genève).[1] Alors, le sport serait-il un des derniers remparts de la ségrégation entre les sexes? Une mixité repensée serait bienvenue. La Ville de Genève empoigne la question.
Béatrice Graf Lateo, Genéve, journaliste
 Sorti en 2017, le documentaire L’étranger, de Kenneth Michiels, relate le parcours du Sénégalais Moussa Cissokho, tout juste débarqué en Belgique, et des enfants de l’équipe de football multiculturelle du BX Brussels dont il devient coach. Mais ce n’est pas à une histoire de compétition sportive que nous sommes conviés. Se déploie sous nos yeux une quête complexe d’intégration à plusieurs tiroirs, autour de la force unificatrice du football, d’un important travail social, et du courage de chaque protagoniste, adulte ou enfant.
Sorti en 2017, le documentaire L’étranger, de Kenneth Michiels, relate le parcours du Sénégalais Moussa Cissokho, tout juste débarqué en Belgique, et des enfants de l’équipe de football multiculturelle du BX Brussels dont il devient coach. Mais ce n’est pas à une histoire de compétition sportive que nous sommes conviés. Se déploie sous nos yeux une quête complexe d’intégration à plusieurs tiroirs, autour de la force unificatrice du football, d’un important travail social, et du courage de chaque protagoniste, adulte ou enfant.
 Tandis que Tokyo se prépare à vivre des Jeux olympiques "tristes", marqués par la pandémie, posons un regard positif sur le sport à la suite des derniers papes qui y voient un moyen de renforcer l'épanouissement personnel et la paix entre les peuples. Issue du désir exprès du pape Jean-Paul II, passionné de sport, la section Église et Sport du Saint-Siège s’efforce depuis 2004 de promouvoir une culture positive de rencontre et de développement humain, ancrée dans les valeurs chrétiennes. Elle porte une attention particulière aux jeunes et à leurs entraîneurs.
Tandis que Tokyo se prépare à vivre des Jeux olympiques "tristes", marqués par la pandémie, posons un regard positif sur le sport à la suite des derniers papes qui y voient un moyen de renforcer l'épanouissement personnel et la paix entre les peuples. Issue du désir exprès du pape Jean-Paul II, passionné de sport, la section Église et Sport du Saint-Siège s’efforce depuis 2004 de promouvoir une culture positive de rencontre et de développement humain, ancrée dans les valeurs chrétiennes. Elle porte une attention particulière aux jeunes et à leurs entraîneurs.