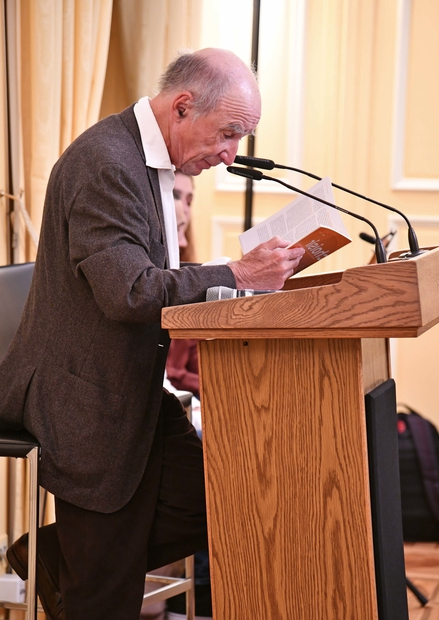 En novembre 2019, choisir fêtait ses 60 ans dans l'espace feutré de la Société de lecture de Genève. L'occasion pour une dizaine d'écrivains de lire à haute voix l'un de leurs textes édités dans la revue devant une assemblée d'invités heureux et conquis. À l'image de Gérard Joulié qui a lu la présente chronique Lettre à un jeune poète qui n'a encore rien publié, parue in choisir n°684 juillet-août-septembre 2017, consacrée à la nuit. Enregistrée en live, nous vous proposons de l'écouter ci-dessous:
En novembre 2019, choisir fêtait ses 60 ans dans l'espace feutré de la Société de lecture de Genève. L'occasion pour une dizaine d'écrivains de lire à haute voix l'un de leurs textes édités dans la revue devant une assemblée d'invités heureux et conquis. À l'image de Gérard Joulié qui a lu la présente chronique Lettre à un jeune poète qui n'a encore rien publié, parue in choisir n°684 juillet-août-septembre 2017, consacrée à la nuit. Enregistrée en live, nous vous proposons de l'écouter ci-dessous:
De la nature source d’inquiétude et d’inspiration métaphysique pour l’homme, à la nature exploitée qui se retourne contre celui qui cherche à la dompter, en passant par la nature porteuse de joie, le thème inspire penseurs et poètes. Petite balade suggestive.
François Berger est membre de la Société européenne de culture et a écrit plusieurs recueils de poésie ainsi que des romans. Dernier en date, Les pavillons de Salomon (Lausanne, L’Âge d’Homme 2013, 280 p.), qui traite de l’amnésie et de la mémoire sur fond de lutte de pouvoir à l’OMS.
Début juin, je suis parti pour l’été, berger, marcher avec quelques quatre cents brebis à travers les rocs et les herbes. J’ai laissé derrière moi, « en bas », mon hiver d’écriture, un livre en cours, suspendu jusqu’aux neiges à venir. Trois prochaines saisons à marcher, une à écrire. Chemin d’encre sur le papier.
Louis Espinassous est aussi romancier, accompagnateur en montagne, éducateur nature et berger-fromager dans les Pyrénées. Il est l’auteur notamment de Besoin de nature. Santé physique et psychique, (Saint-Claude-de-Diray, Hesse 2014, 240 p.), dont ce texte est tiré avec l'aimable autorisation de l'auteur et de l'éditeur.
Robert Zhao Renhui est un photographe singapourien et un ancien militant pour la défense des animaux. Il consacre sa carrière artistique à l’étude de la relation de l’humanité avec la nature et à la nostalgie qu’elle éprouve pour le monde sauvage.
Holly Roussel Perret-Gentil est une commissaire indépendante et ancienne collaboratrice au Musée de l'Élysée.
Depuis toujours, l’un des outils de prédilection pour envisager la relation complexe que l’homme nourrit avec la nature a été l’art. Avant que les activistes écologistes investissent la rue, avant même que des éthiciens tels William Cronon (The Trouble with Wilderness, 1996) ou Robert Elliot (Faking Nature, 1997) soulignent la valeur du «monde sauvage» et les conséquences de l’extinction anthropique, les artistes se sont emparés du sujet, explorant dans leurs œuvres le sublime du paysage naturel et l’essence de la création comme élément échappant à tout contrôle humain.
 Tout un chacun s’accorde pour dire que, pour vivre mieux et plus éthique, nous devons consommer local, préserver la nature, favoriser le bien-être des animaux... mais qu’en est-il de celui des agriculteurs? Le pasteur Schütz répond à la détresse de ceux d’entre eux qui ne trouvent plus leur place dans une société qui leur demande toujours plus et leur redonne toujours moins
Tout un chacun s’accorde pour dire que, pour vivre mieux et plus éthique, nous devons consommer local, préserver la nature, favoriser le bien-être des animaux... mais qu’en est-il de celui des agriculteurs? Le pasteur Schütz répond à la détresse de ceux d’entre eux qui ne trouvent plus leur place dans une société qui leur demande toujours plus et leur redonne toujours moins
Ancien agriculteur, Pierre-André Schütz[1] est aumônier depuis octobre 2015. Il a été mandaté par le Service d’agriculture et de viticulture du canton de Vaud (SAVI) pour mettre sur pied un programme de sensibilisation visant, notamment, à faciliter la détection des personnes en proie à des difficultés. Il vient de recevoir le prix de la Fondation Agrisano pour son engagement altruiste.
La biodiversité en parcs. Une interview de Daniel Cherix
Écrit par Lucienne Bittar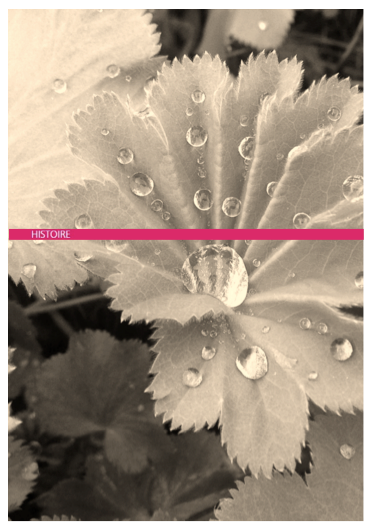 La création de réserves naturelles a bonne presse en Suisse. Ainsi un nouveau parc périurbain pourrait voir le jour en 2020 dans la forêt du Jorat (canton de Vaud). Mais ces îlots de verdure ne s’apparentent-ils pas finalement à des musées de la biodiversité ou à des luna-park «bio» pour citadins stressés? Réponse avec Daniel Cherix.
La création de réserves naturelles a bonne presse en Suisse. Ainsi un nouveau parc périurbain pourrait voir le jour en 2020 dans la forêt du Jorat (canton de Vaud). Mais ces îlots de verdure ne s’apparentent-ils pas finalement à des musées de la biodiversité ou à des luna-park «bio» pour citadins stressés? Réponse avec Daniel Cherix.
Professeur honoraire au Département d’écologie et d’évolution de l’Université de Lausanne, Daniel Cherix a été conservateur du Musée de Zoologie du Palais de Rumine. Il est chroniqueur à la RTS pour Monsieur jardinier et le président de la Commission de recherche du Parc naturel périurbain du massif du Jorat.
On s’échine à leur trouver des noms, des noms doux, sans arêtes, qui ne blessent pas le cœur, qui voilent ce qui s’y joue: La Paix du Soir, Soleil couchant, Mon repos, Mont-Calme, tous ces noms en forment un seul, les visiteurs le sentent, leurs visages se crispent à l’entrée comme pour une mauvaise plaisanterie.
Écrivain valaisan, Jérôme Meizoz est l’auteur de publications scientifiques, ainsi que d’œuvres de fiction ou poétiques. Il a collaboré à l’édition critique des romans de C. F. Ramuz dans la Bibliothèque de la Pléiade.
 Le mythe contemporain du risque 0, issu de la peur de la mort et du désir de la contrôler, prend des accents apocalyptiques sur le plan collectif où les catastrophes naturelles agissent comme des aiguillons. Ces légitimes inquiétudes appellent à une meilleure acceptation du risque.
Le mythe contemporain du risque 0, issu de la peur de la mort et du désir de la contrôler, prend des accents apocalyptiques sur le plan collectif où les catastrophes naturelles agissent comme des aiguillons. Ces légitimes inquiétudes appellent à une meilleure acceptation du risque.
Chercheur au Centre François Viète d’histoire des sciences et des techniques, Frédéric Le Blay est spécialiste des savoirs et des sciences de l’Antiquité. Depuis fin 2015, il dirige le programme international ATLANTYS, qui porte sur l’imaginaire de la fin du monde et l’expérience de la catastrophe (atlantys.hypotheses.org).
Le cerveau sous pressions. Un entretien avec Etienne Kœchlin
Écrit par Céline Fossati Comment réagit notre cerveau dans des conditions climatiques extrêmes? Quelles modifications structurelles et cognitives[1] sont induites par une exposition prolongée à une chaleur intense frôlant les 50 degrés ou un froid mordant de -50 degrés? Pour répondre à cette question, le neurobiologiste Etienne Kœchlin, fondateur et le directeur du Laboratoire de neurosciences cognitives de l’INSREM rattaché à l’École normale supérieure (ENS), s’est associé à l’explorateur Christian Clot.
Comment réagit notre cerveau dans des conditions climatiques extrêmes? Quelles modifications structurelles et cognitives[1] sont induites par une exposition prolongée à une chaleur intense frôlant les 50 degrés ou un froid mordant de -50 degrés? Pour répondre à cette question, le neurobiologiste Etienne Kœchlin, fondateur et le directeur du Laboratoire de neurosciences cognitives de l’INSREM rattaché à l’École normale supérieure (ENS), s’est associé à l’explorateur Christian Clot.
Tous deux sont franco-suisses et tous deux ont le goût de l’aventure, pour ne pas dire de l’exploit. Christian Clot est un sportif aguerri, explorateur par passion et par métier. C’est à lui que revient l’idée d’origine de l’étude (voir encadré). Le professeur Etienne Kœchlin est un neurobiologiste réputé, féru de montagne et de voile, qui mène l’étude scientifique permettant de mettre en évidence les modifications de notre cerveau exposé à des environnements climatiques aussi inhabituels.
 En novembre 2019, choisir fêtait ses 60 ans dans l'espace feutré de la Société de lecture de Genève. L'occasion pour une dizaine d'écrivains de venir lire à haute voix l'un de leurs textes édités dans la revue devant une assemblée d'invités heureux et conquis. À l'image d'Eugène qui a lu la présente chronique Fous, mais pas cinglés, parue in choisir n°684 juillet-août-septembre 2017, consacrée aux extrêmes. Enregistrée en live, nous vous proposons de l'écouter ci-dessous:
En novembre 2019, choisir fêtait ses 60 ans dans l'espace feutré de la Société de lecture de Genève. L'occasion pour une dizaine d'écrivains de venir lire à haute voix l'un de leurs textes édités dans la revue devant une assemblée d'invités heureux et conquis. À l'image d'Eugène qui a lu la présente chronique Fous, mais pas cinglés, parue in choisir n°684 juillet-août-septembre 2017, consacrée aux extrêmes. Enregistrée en live, nous vous proposons de l'écouter ci-dessous: