 Difficile de faire un geste dans le monde numérique sans croiser un appel à la «confiance». Les entreprises du numérique déploient des trésors de rhétorique pour se présenter comme dignes de confiance. Dans cet exercice, il n’est pas toujours facile de dépasser le slogan, tant la confiance ressemble à un mot-valise capable de mettre tout le monde d’accord. Mais en grattant un peu, cette valise apparaît bien légère. Pour repartir sur de bonnes bases, posons la question que personne n’aborde vraiment: qu’est-ce que la confiance?
Difficile de faire un geste dans le monde numérique sans croiser un appel à la «confiance». Les entreprises du numérique déploient des trésors de rhétorique pour se présenter comme dignes de confiance. Dans cet exercice, il n’est pas toujours facile de dépasser le slogan, tant la confiance ressemble à un mot-valise capable de mettre tout le monde d’accord. Mais en grattant un peu, cette valise apparaît bien légère. Pour repartir sur de bonnes bases, posons la question que personne n’aborde vraiment: qu’est-ce que la confiance?
C’est le nom de l’algorithme super puissant de nouvelle génération mis au point en Suisse par des chercheurs des Universités de Genève et de Lausanne, ainsi que du SIB, pour faciliter l’interprétation des Big Data du génome qui ne cessent de prendre de l’ampleur. Cet outil devrait se révéler très utile pour l’étude de la génétique des populations et pour la médecine de précision.
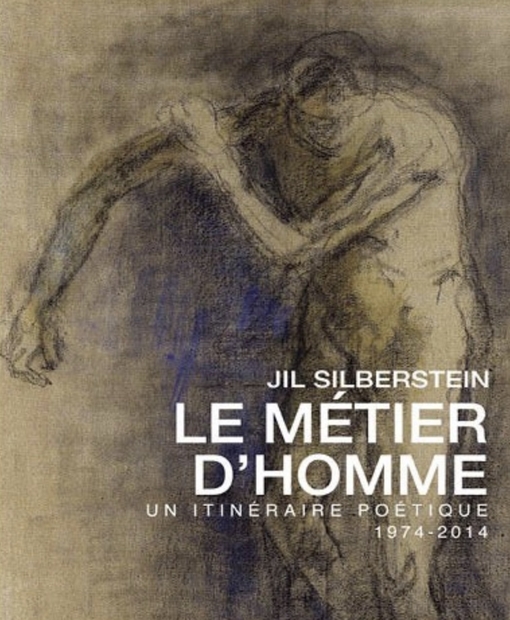 Le lecteur ne trouvera pas ici de ces petits haïkus de rien du tout qui ont la consistance d’un nuage disparu aussitôt qu’apparu, mais le flot tumultueux d’une vie passée au filtre de la poésie, le chant d’un samouraï résonnant du cliquetis des épées comme dans un roman de Stevenson ou de Chesterton et suintant et saignant des blessures inguérissables de l’immortelle enfance, ce bloc indestructible émergeant de la mer du néant rouvertes et limées par le couteau du vers.
Le lecteur ne trouvera pas ici de ces petits haïkus de rien du tout qui ont la consistance d’un nuage disparu aussitôt qu’apparu, mais le flot tumultueux d’une vie passée au filtre de la poésie, le chant d’un samouraï résonnant du cliquetis des épées comme dans un roman de Stevenson ou de Chesterton et suintant et saignant des blessures inguérissables de l’immortelle enfance, ce bloc indestructible émergeant de la mer du néant rouvertes et limées par le couteau du vers.
 Quand j’avais 9 ans, je n’avais pas droit à une histoire avant de m’endormir. Ma mère me mettait au lit, éteignait la lumière et retournait au salon regarder la télévision. Couché sous la couverture, j’entendais quelqu’un marcher dans le noir. Un son mat et bref. Une démarche lente. Déterminée. Le plus effrayant, c’est qu’il ne marchait pas sur le tapis. Il ne cheminait pas dans ma chambre. Non! C’était dans mon oreiller. Qui pouvait bien avancer avec une telle détermination? Une telle colère froide? J’étais terrifié. Et plus j’avais peur, plus le sadique accélérait. Qu’avait-il dans la main? Avec quel couteau comptait-il me faire mal? Je me tournais et me retournais dans mon lit. Mais rien à faire: il marchait vers moi.
Quand j’avais 9 ans, je n’avais pas droit à une histoire avant de m’endormir. Ma mère me mettait au lit, éteignait la lumière et retournait au salon regarder la télévision. Couché sous la couverture, j’entendais quelqu’un marcher dans le noir. Un son mat et bref. Une démarche lente. Déterminée. Le plus effrayant, c’est qu’il ne marchait pas sur le tapis. Il ne cheminait pas dans ma chambre. Non! C’était dans mon oreiller. Qui pouvait bien avancer avec une telle détermination? Une telle colère froide? J’étais terrifié. Et plus j’avais peur, plus le sadique accélérait. Qu’avait-il dans la main? Avec quel couteau comptait-il me faire mal? Je me tournais et me retournais dans mon lit. Mais rien à faire: il marchait vers moi.
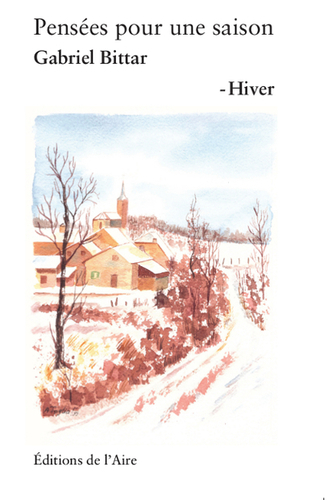 En couverture du livre Pensées pour une saison - Hiver, l’aquarelle de l’artiste suisse Alice Foglia (1924-2018) ouvre le chemin. Après 17 ans dans le bush australien, Gabriel et Jacqueline Bittar sont revenus prendre leur retraite en Suisse. Gabriel, qui aime vivre caché, veut aussi partager avec d’autres ce qui l’a animé chaque jour et qu’il a noté au fil du temps, «au contact étroit de la nature profonde» et avec ses chats qui lui ont donné «des leçons de vie». C’est une sorte de journal, remanié, réorganisé, des libres propos en toute liberté pour prendre du recul et essayer de comprendre le monde. Quatre tomes sont prévus, un par saison, et le deuxième, Printemps, vient de sortir.
En couverture du livre Pensées pour une saison - Hiver, l’aquarelle de l’artiste suisse Alice Foglia (1924-2018) ouvre le chemin. Après 17 ans dans le bush australien, Gabriel et Jacqueline Bittar sont revenus prendre leur retraite en Suisse. Gabriel, qui aime vivre caché, veut aussi partager avec d’autres ce qui l’a animé chaque jour et qu’il a noté au fil du temps, «au contact étroit de la nature profonde» et avec ses chats qui lui ont donné «des leçons de vie». C’est une sorte de journal, remanié, réorganisé, des libres propos en toute liberté pour prendre du recul et essayer de comprendre le monde. Quatre tomes sont prévus, un par saison, et le deuxième, Printemps, vient de sortir.
 La série Chernobyl raconte l’histoire de la catastrophe survenue la nuit du 26 avril 1986 en Ukraine: l’explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire Vladimir I Lénine. Elle est actuellement diffusée sur la RTS et mérite le détour. La mise en récit de Craig Mazin, le créateur de la série, porte sur des sujets qui dépassent l’évènement lui-même: la question de notre rapport à la vérité, les mensonges d’État, la mise en valeur de héros inconnus, la folie d’un monde technologique soi-disant sous-contrôle. Elle répond avec brio à ces deux questions: comment cela s’est-il passé? comment cela a-t-il pu se passer?
La série Chernobyl raconte l’histoire de la catastrophe survenue la nuit du 26 avril 1986 en Ukraine: l’explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire Vladimir I Lénine. Elle est actuellement diffusée sur la RTS et mérite le détour. La mise en récit de Craig Mazin, le créateur de la série, porte sur des sujets qui dépassent l’évènement lui-même: la question de notre rapport à la vérité, les mensonges d’État, la mise en valeur de héros inconnus, la folie d’un monde technologique soi-disant sous-contrôle. Elle répond avec brio à ces deux questions: comment cela s’est-il passé? comment cela a-t-il pu se passer?
 Ainsi soient-elles est un film-documentaire (2019) d’un homme, jeune, sur des femmes, âgées et féministes, les sœurs auxiliatrices du Québec. Sa justesse de ton prouve que quand une personne sait se mettre à l’écoute, au service, il peut capter l’essentiel, même quand celui-ci se situe à des années lumière de sa propre vie.
Ainsi soient-elles est un film-documentaire (2019) d’un homme, jeune, sur des femmes, âgées et féministes, les sœurs auxiliatrices du Québec. Sa justesse de ton prouve que quand une personne sait se mettre à l’écoute, au service, il peut capter l’essentiel, même quand celui-ci se situe à des années lumière de sa propre vie.
C’est en sillonnant le Québec que le français Maxime Faure, 30 ans, rencontre les sœurs auxiliatrices du Québec. Cette congrégation religieuse féminine a été fondée à Paris en 1856, et est aujourd’hui implantée dans 22 pays. Ses constitutions sont rédigées selon celles de la Compagnie de Jésus.
 L'affaire de Jean Vanier est vécue avec douleur par les membres des communautés de l'Arche et par de nombreux catholiques. Elle pose des questions fondamentales en Église, dont celle-ci: comment garder son individualité, sa liberté, tout en s'inscrivant dans la tradition et en se permettant l'admiration? En faisant preuve de discernement pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. En ne transformant pas en icônes les grands témoins de la chrétienté, dont les catholiques, si malmenés aujourd'hui tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église, ont tant besoin.
L'affaire de Jean Vanier est vécue avec douleur par les membres des communautés de l'Arche et par de nombreux catholiques. Elle pose des questions fondamentales en Église, dont celle-ci: comment garder son individualité, sa liberté, tout en s'inscrivant dans la tradition et en se permettant l'admiration? En faisant preuve de discernement pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. En ne transformant pas en icônes les grands témoins de la chrétienté, dont les catholiques, si malmenés aujourd'hui tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église, ont tant besoin.
 contrastwerkstatt / Adobe StockSur quels indices notre mémoire s’appuie-t-elle pour rattacher une situation actuelle à une situation passée? Contrairement à ce qu’expliquait jusqu’à aujourd'hui la littérature existante sur le sujet, ce serait les ressemblances de structure et de fond (le cœur de la situation) qui guideraient les évocations en mémoire, et non les ressemblances de surface (par exemple la thématique générale, le lieu ou les protagonistes). C'est ce qu'annonce avoir démontré des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), en collaboration avec le CY Cergy Paris Université en France. Une étude qui pourrait s'avérer utile en pédagogie.
contrastwerkstatt / Adobe StockSur quels indices notre mémoire s’appuie-t-elle pour rattacher une situation actuelle à une situation passée? Contrairement à ce qu’expliquait jusqu’à aujourd'hui la littérature existante sur le sujet, ce serait les ressemblances de structure et de fond (le cœur de la situation) qui guideraient les évocations en mémoire, et non les ressemblances de surface (par exemple la thématique générale, le lieu ou les protagonistes). C'est ce qu'annonce avoir démontré des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), en collaboration avec le CY Cergy Paris Université en France. Une étude qui pourrait s'avérer utile en pédagogie.
À la recherche de la Source qui donne sens à nos vies
On s’enrichit d’autant plus des expériences spirituelles des autres qu’on demeure profondément des chercheurs. Quand nous acceptons d’endurer le vide que creusent en nous le retrait des autres et le sentiment d’absence de Vis à vis, nous parvenons à lâcher nos dieux imaginaires et à nous approcher de cette Source intarissable qu’on appelle traditionnellement Dieu.
• Date : samedi 7 mars 2020
• Heures : 14h à 17h
• Lieu : centre paroissial de Romainmôtier
• Animatrice : Lytta Basset, philosophe et théologienne, formatrice en accompagnement spirituel
Découvez-ci dessous l'interview de Lytta Basset, par Céline Fossati, réalisé pour la revue choisir et son dossier Coach, maître ou accompagnateur: sommaire de notre numéro 689.