
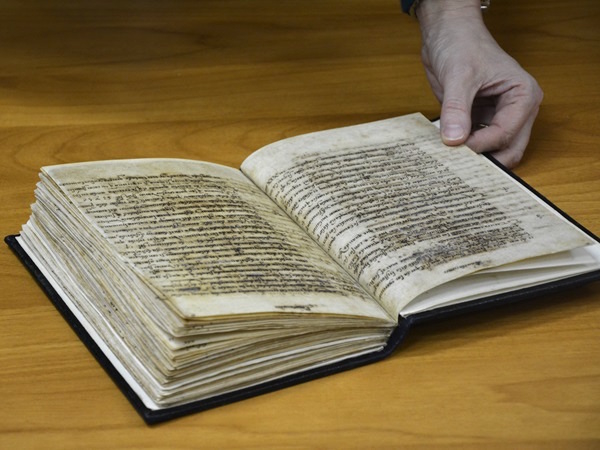
Le jésuite Dominique Salin est professeur honoraire au Centre Sèvres, à Paris. Il est un spécialiste de la spiritualité au XVIIe siècle français. Il s’intéresse particulièrement au discours mystique, poétique, et à sa tension avec le discours théologique. Il a écrit à ce sujet, L’expérience spirituelle et son langage. Leçons sur la tradition chrétienne (Paris, Facultés jésuites 2015, 156 p.).
 À plus de mille kilomètres du Caire et à deux heures de route d’Assouan, en plein désert, se dresse le village de Samaha, nom qui signifie tolérance en arabe. À l’instar des amazones, ces guerrières de la mythologie grecque, une centaine de femmes vivent dans ce lieu dont les hommes sont bannis. Mais toute ressemblance avec le mythe s’arrête là.
À plus de mille kilomètres du Caire et à deux heures de route d’Assouan, en plein désert, se dresse le village de Samaha, nom qui signifie tolérance en arabe. À l’instar des amazones, ces guerrières de la mythologie grecque, une centaine de femmes vivent dans ce lieu dont les hommes sont bannis. Mais toute ressemblance avec le mythe s’arrête là.
Eleonora Vio, Milan, journaliste, Nawart Press
 Les Bambassi, © Giacomo SiniDans la ville de Bushehr, au bord du Golf persique, la vie s’écoule sans heurts et le passé esclavagiste de la région ne fait pas plus de vagues. Ce dernier a teinté durablement la culture locale, ses traditions musicales comme ses danses folkloriques, voire les visages des habitants. Les photographies qui suivent cette esquisse d’un moment de vie sont du reporter italien Giacomo Sini, qui a déjà publié un portfolio dans choisir sur les Yézidis du Kurdistan irakien.
Les Bambassi, © Giacomo SiniDans la ville de Bushehr, au bord du Golf persique, la vie s’écoule sans heurts et le passé esclavagiste de la région ne fait pas plus de vagues. Ce dernier a teinté durablement la culture locale, ses traditions musicales comme ses danses folkloriques, voire les visages des habitants. Les photographies qui suivent cette esquisse d’un moment de vie sont du reporter italien Giacomo Sini, qui a déjà publié un portfolio dans choisir sur les Yézidis du Kurdistan irakien.
Monir Ghaedi, journaliste
 Depuis que j’écris des chroniques pour choisir, je n’ai jamais réussi à les rendre à temps. Parfois, j’attends que le délai soit dépassé pour commencer ! Parfois, il faut que je reçoive un mail inquiet de la rédaction pour m’y mettre enfin. Et j’invente des excuses grotesques, telles que: «Je me suis fait embaucher chez Securitas.» Du coup, pour cette chronique qui doit aborder la question des coachs personnels, je me suis adressé … à un coach personnel.
Depuis que j’écris des chroniques pour choisir, je n’ai jamais réussi à les rendre à temps. Parfois, j’attends que le délai soit dépassé pour commencer ! Parfois, il faut que je reçoive un mail inquiet de la rédaction pour m’y mettre enfin. Et j’invente des excuses grotesques, telles que: «Je me suis fait embaucher chez Securitas.» Du coup, pour cette chronique qui doit aborder la question des coachs personnels, je me suis adressé … à un coach personnel.
Eugène Meiltz, de son nom de baptême, est un écrivain vaudois, parolier et animateur d’ateliers d’écriture. Son dernier roman, Ganda, vient de paraître (Genève, Slatkine 2018, 172 p.) et est recensé sur www.choisir.ch.
 L’accompagnement spirituel a pour but d’approfondir la relation personnelle à Dieu ou, comme dirait saint Ignace de Loyola, de mettre l’âme en contact avec son Créateur. Recréer ou restaurer cette relation quand elle a été détruite, comme c’est souvent le cas chez des personnes qui ont subi une transgression de leur intégrité sexuelle, est particulièrement important et délicat.
L’accompagnement spirituel a pour but d’approfondir la relation personnelle à Dieu ou, comme dirait saint Ignace de Loyola, de mettre l’âme en contact avec son Créateur. Recréer ou restaurer cette relation quand elle a été détruite, comme c’est souvent le cas chez des personnes qui ont subi une transgression de leur intégrité sexuelle, est particulièrement important et délicat.
Ancien directeur du Centre spirituel et de formation Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne, Beat Altenbach sj fait partie du groupe d’experts «Abus sexuels dans le contexte ecclésial» de la Conférence des évêques suisses.
 J’ai aujourd’hui 50 ans et suis paraplégique (ainsi qu’amputé de mes deux jambes en-dessous des genoux) depuis plus de 30 ans suite à un accident. Avec trois copains, nous avions eu la très mauvaise idée d’escalader l’échelle d’un wagon-citerne pour prendre un peu de hauteur. Les 15' 000 volts de l’arc électrique m’ont projeté au sol sur lequel je me suis fracassé la colonne vertébrale.
J’ai aujourd’hui 50 ans et suis paraplégique (ainsi qu’amputé de mes deux jambes en-dessous des genoux) depuis plus de 30 ans suite à un accident. Avec trois copains, nous avions eu la très mauvaise idée d’escalader l’échelle d’un wagon-citerne pour prendre un peu de hauteur. Les 15' 000 volts de l’arc électrique m’ont projeté au sol sur lequel je me suis fracassé la colonne vertébrale.
Marc Glaisen, paraplégique, psychologue-psychothérapeute
Entraîneurs et athlètes
Roberta Antonini Philippe et Ophélia Dysli-Jeanneret «Un seul acte, mais deux désirs qui se rencontrent.»[1] Depuis une cinquantaine d’années, la psychologie du sport s’intéresse aux relations particulières dans le sport de compétition entre l’athlète et l’entraîneur qui partagent le même idéal: la performance.
«Un seul acte, mais deux désirs qui se rencontrent.»[1] Depuis une cinquantaine d’années, la psychologie du sport s’intéresse aux relations particulières dans le sport de compétition entre l’athlète et l’entraîneur qui partagent le même idéal: la performance.
R. Antonini Philippe est docteur en psychologie du sport et maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des sciences du sport de Lausanne; O. Dysli-Jeanneret est cheffe du Service des sports d’Yverdon depuis 2016. Les deux femmes ont travaillé à la Haute école fédérale du sport de Macolin.
 Le sport moderne a été inventé par et pour les hommes à la fin du XIXe siècle. Les femmes ont dû conquérir le droit de pratiquer une activité sportive. Aujourd’hui encore, les infrastructures ou l’offre d’activités sportives par le biais des clubs bénéficient en majorité aux hommes (pour 70 % à Genève).[1] Alors, le sport serait-il un des derniers remparts de la ségrégation entre les sexes? Une mixité repensée serait bienvenue. La Ville de Genève empoigne la question.
Le sport moderne a été inventé par et pour les hommes à la fin du XIXe siècle. Les femmes ont dû conquérir le droit de pratiquer une activité sportive. Aujourd’hui encore, les infrastructures ou l’offre d’activités sportives par le biais des clubs bénéficient en majorité aux hommes (pour 70 % à Genève).[1] Alors, le sport serait-il un des derniers remparts de la ségrégation entre les sexes? Une mixité repensée serait bienvenue. La Ville de Genève empoigne la question.
Béatrice Graf Lateo, Genéve, journaliste
Plus...
Avec la gestation pour autrui, on atteint un niveau extrême de séparation entre la sexualité et la reproduction, une dissociation que permettent les avancées des techno-sciences et, du point de vue socio-culturel, la révolution sexuelle. La réalisation du désir d’une sexualité exempte du danger de reproduction induit la possibilité opposée: celle de la reproduction sans sexualité, par la fécondation in vitro ou même par la location d’un utérus (interdit en Suisse). Beaucoup de souffrances en découlent.
Lucetta Scaraffia est directrice de Femmes Église Monde, le supplément féminin de L’Osservatore Romano. Dernier ouvrage: La fin de la mère, Paris, Salvator 2018, 160 p.
 Le 2 avril 2014, la Haute cour australienne reconnaissait, en première mondiale, qu’une personne peut être ni de sexe masculin ni de sexe féminin et autorisait son enregistrement dans le système d’État civil comme étant d’un genre «non spécifique». L’Allemagne, en première européenne, lui a emboîté le pas en novembre 2017, tandis que la France et la Suisse s’y refusent. L’idée demande réflexion [1].
Le 2 avril 2014, la Haute cour australienne reconnaissait, en première mondiale, qu’une personne peut être ni de sexe masculin ni de sexe féminin et autorisait son enregistrement dans le système d’État civil comme étant d’un genre «non spécifique». L’Allemagne, en première européenne, lui a emboîté le pas en novembre 2017, tandis que la France et la Suisse s’y refusent. L’idée demande réflexion [1].
Alberto Bondolfi a été membre de la Commission nationale d’éthique en Suisse durant douze ans. Il a participé à la réflexion autour des problèmes auxquels sont confrontées les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles mixtes ou sans appartenance claires à l’un des deux sexes.
 Le tatouage est à la mode. Mais quelle signification revêt-il aujourd’hui et diffère-t-elle de celle de ses origines? Est-il acte d’affirmation de soi, d’esthétisation de son corps ou sacrilège? Le sociologue David Le Breton décrypte nos écritures corporelles.
Le tatouage est à la mode. Mais quelle signification revêt-il aujourd’hui et diffère-t-elle de celle de ses origines? Est-il acte d’affirmation de soi, d’esthétisation de son corps ou sacrilège? Le sociologue David Le Breton décrypte nos écritures corporelles.
Professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Cultures et sociétés en Europe, David Le Breton est spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain. Il est l’auteur, notamment, de L’adieu au corps (2013) et La peau et la trace (2003), publiés aux Éditions Métailié.
 © P. EmonetUne étude des Universités de Genève et Zurich montre que les décisions autour de la fin de vie diffèrent fortement selon les régions de Suisse. Elles sont modelées tant par un cadre législatif commun que par le contexte culturel propre à chacune des trois régions linguistiques de Suisse. Ces résultats ont été publiés par la revue BMC Medicine. Selon les chercheurs, ils sont importants car ils aident à fonder sur des faits le débat autour de la fin de vie.
© P. EmonetUne étude des Universités de Genève et Zurich montre que les décisions autour de la fin de vie diffèrent fortement selon les régions de Suisse. Elles sont modelées tant par un cadre législatif commun que par le contexte culturel propre à chacune des trois régions linguistiques de Suisse. Ces résultats ont été publiés par la revue BMC Medicine. Selon les chercheurs, ils sont importants car ils aident à fonder sur des faits le débat autour de la fin de vie.
