
Religions
 L'empereur Dèce ordonnant l'emmurement des Sept dormants. D'après un manuscrit du XIVe siècle. © DPOn trouve aujourd'hui une dizaine de sites, tant chrétiens que musulmans, du Maghreb à la Chine, qui s'enorgueillissent d'une grotte des Sept dormants ou des Gens de la caverne.
L'empereur Dèce ordonnant l'emmurement des Sept dormants. D'après un manuscrit du XIVe siècle. © DPOn trouve aujourd'hui une dizaine de sites, tant chrétiens que musulmans, du Maghreb à la Chine, qui s'enorgueillissent d'une grotte des Sept dormants ou des Gens de la caverne.
Une légende à redécouvrir en ce mois de novembre 2018, à l'occasion de la semaine des religions.
 Journal de la RTS, capture d'écran, 27.10.18Le discours de l’unité du peuple juif face à l’antisémitisme, prononcé suite à l’attaque de samedi dans une synagogue de Pittsburgh, ne suffit pas à masquer les profondes divergences entre juifs américains et gouvernement israélien. Les larmes n’ont pas fait oublier les divisions. Dimanche, dans une interview à un journal orthodoxe israélien, le grand-rabbin ashkénaze d’Israël David Lau refusait de qualifier de «synagogue» le lieu de prière où a eu lieu l’attaque de Pittsburgh. La raison? Les juifs qui s’y réunissent forment une congrégation non-orthodoxe. (Voir l'article ci-dessous d'Aline Jacottet.)
Journal de la RTS, capture d'écran, 27.10.18Le discours de l’unité du peuple juif face à l’antisémitisme, prononcé suite à l’attaque de samedi dans une synagogue de Pittsburgh, ne suffit pas à masquer les profondes divergences entre juifs américains et gouvernement israélien. Les larmes n’ont pas fait oublier les divisions. Dimanche, dans une interview à un journal orthodoxe israélien, le grand-rabbin ashkénaze d’Israël David Lau refusait de qualifier de «synagogue» le lieu de prière où a eu lieu l’attaque de Pittsburgh. La raison? Les juifs qui s’y réunissent forment une congrégation non-orthodoxe. (Voir l'article ci-dessous d'Aline Jacottet.)
Les réseaux sociaux se sont aussi agités contre le vice-président américain Mike Pence. Son tort: avoir invité le rabbin Loren Jacobs à prier pour les victimes alors qu’il est un juif messianique, un “Juif pour Jésus”, explique de son côté Jacques Berset, de cath.ch. (À lire plus bas.)
 Philippe HaddadLe rabbin parisien Philippe Haddad, écrivain et conférencier, est engagé dans le dialogue interreligieux, qui relève, selon lui, d’une démarche spirituelle et éthique. Dans son dernier ouvrage publié à compte d'auteur, "Fraternité ou la révolution du pardon", il montre combien ce thème de la fraternité est central et fondateur dans la Torah et dans la vie quotidienne. Il parle de la rivalité et de la jalousie au sein de la fratrie, mais aussi de la possibilité d’entamer une prise de conscience et de choisir le pardon. Son cheminement biblique, mais aussi évangélique, nous invite à constituer la fraternité universelle comme projet de société: un idéal à bâtir. Interview.
Philippe HaddadLe rabbin parisien Philippe Haddad, écrivain et conférencier, est engagé dans le dialogue interreligieux, qui relève, selon lui, d’une démarche spirituelle et éthique. Dans son dernier ouvrage publié à compte d'auteur, "Fraternité ou la révolution du pardon", il montre combien ce thème de la fraternité est central et fondateur dans la Torah et dans la vie quotidienne. Il parle de la rivalité et de la jalousie au sein de la fratrie, mais aussi de la possibilité d’entamer une prise de conscience et de choisir le pardon. Son cheminement biblique, mais aussi évangélique, nous invite à constituer la fraternité universelle comme projet de société: un idéal à bâtir. Interview.

Bernard Senécal vit en Corée du Sud depuis plus de trente ans et est devenu un maître Sŏn. Il y dirige la communauté interreligieuse et internationale du Champ de Pierre au Bout du Chemin. Il est professeur de bouddhisme à l'Université jésuite Sogang et anime des retraites ou des sessions un peu partout dans le monde, notamment au domaine Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne.

Cheikh Bentounes a participé en 1986 aux Rencontres interreligieuses d’Assise (Italie). Président d’honneur de l’Association internationale soufie Alâwiyya (AISA), il est l’initiateur du premier Congrès international féminin pour une culture de Paix (Oran/Mostaganem, 2014). S’en est suivie l’adoption par l’ONU d’une Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébrée pour la première fois le 16 mai 2018.
Société des Amis
Sally Alderson, Bridget et Edouard Dommen, Karen Taylor L’importance de l’égalité pour les quakers saute aux yeux dès qu’on les voit assis pour le culte, en cercle ou en carré. Aucun célébrant ne sert d’intermédiaire avec la divinité; les quakers croient que Dieu est présent en chacun. Dès lors, comment accepter une quelconque inégalité entre les sexes? Démonstration en quatre portraits d’activistes.
L’importance de l’égalité pour les quakers saute aux yeux dès qu’on les voit assis pour le culte, en cercle ou en carré. Aucun célébrant ne sert d’intermédiaire avec la divinité; les quakers croient que Dieu est présent en chacun. Dès lors, comment accepter une quelconque inégalité entre les sexes? Démonstration en quatre portraits d’activistes.
Sally Alderson, Bridget et Edouard Dommen, Karen Taylor, Genève, quakers
 Dans un texte inédit publié par la version allemande de la revue de théologie Communio de juillet-août 2018, le pape émérite Benoît XVI déclare que la théorie selon laquelle l’Église aurait pris la place d’Israël dans l’alliance avec Dieu -la théologie de la substitution- n’a «jamais existé en tant que telle». «L’alliance» entre Dieu et le peuple juif n'a «jamais» été «révoquée». Le judaïsme, insiste-t-il, n’est pas une religion «comme les autres». Il occupe une position «spéciale», que l’Église doit reconnaître. «Des réflexions qui ont été critiquées par des théologiens chrétiens comme par des autorités juives, car elles semblent remettre en question le fondement du dialogue judéo-chrétien qui s’est développé depuis le concile Vatican II», commente le provincial des jésuites de Suisse Christian Rustishauser sj.
Dans un texte inédit publié par la version allemande de la revue de théologie Communio de juillet-août 2018, le pape émérite Benoît XVI déclare que la théorie selon laquelle l’Église aurait pris la place d’Israël dans l’alliance avec Dieu -la théologie de la substitution- n’a «jamais existé en tant que telle». «L’alliance» entre Dieu et le peuple juif n'a «jamais» été «révoquée». Le judaïsme, insiste-t-il, n’est pas une religion «comme les autres». Il occupe une position «spéciale», que l’Église doit reconnaître. «Des réflexions qui ont été critiquées par des théologiens chrétiens comme par des autorités juives, car elles semblent remettre en question le fondement du dialogue judéo-chrétien qui s’est développé depuis le concile Vatican II», commente le provincial des jésuites de Suisse Christian Rustishauser sj.
 La circoncision est perpétuée par les juifs avec énormément de respect. Elle signe l’alliance entre Dieu et Abraham (Brit Mila en hébreu). Pourtant, dans un livre récent,[1] Ran Kasher, un juif athée, examine sans tabou les effets de cette tradition qu’il réfute, créant la polémique. L’auteur a consacré presque vingt ans de sa vie à étudier la question. Il en a fait une mission personnelle.
La circoncision est perpétuée par les juifs avec énormément de respect. Elle signe l’alliance entre Dieu et Abraham (Brit Mila en hébreu). Pourtant, dans un livre récent,[1] Ran Kasher, un juif athée, examine sans tabou les effets de cette tradition qu’il réfute, créant la polémique. L’auteur a consacré presque vingt ans de sa vie à étudier la question. Il en a fait une mission personnelle.
Liz Hiller, Genève, journaliste
Plus...
 Notre monde actuel ne durera pas. Prendra-t-il fin brutalement ou tout en douceur grâce à une évolution des consciences? Les scénarios catastrophistes ou optimistes tendance Nouvel Âge ne manquent pas. Signeraient-ils le retour des mouvements millénaristes? Petit tour de piste pour y voir plus clair.
Notre monde actuel ne durera pas. Prendra-t-il fin brutalement ou tout en douceur grâce à une évolution des consciences? Les scénarios catastrophistes ou optimistes tendance Nouvel Âge ne manquent pas. Signeraient-ils le retour des mouvements millénaristes? Petit tour de piste pour y voir plus clair.
Jean-François Mayer étudie depuis de longues années les mouvements religieux dans le monde contemporain. Il dirige le site Religioscope (www.religion.info). Auteur d’une dizaine de livres et de nombreux articles (voir www.mayer.info), il a publié plusieurs textes à propos des attentes millénaristes autour du 21 décembre 2012.
 La présence des musulmans en Europe est une source d’inquiétude. D’aucuns craignent de se faire « coloniser » et de perdre leur identité. La réalité des chiffres est moins alarmante, et sur le plan culturel, un mouvement inverse s’observe : l’installation en Europe fournit aux musulmans la possibilité de discuter de leur foi en toute liberté. Un nouveau modèle pour le monde islamique pourrait émerger.
La présence des musulmans en Europe est une source d’inquiétude. D’aucuns craignent de se faire « coloniser » et de perdre leur identité. La réalité des chiffres est moins alarmante, et sur le plan culturel, un mouvement inverse s’observe : l’installation en Europe fournit aux musulmans la possibilité de discuter de leur foi en toute liberté. Un nouveau modèle pour le monde islamique pourrait émerger.
Les recherches de Yasemine El-Menouar portent sur la perception des musulmans en Europe. Elle dirige le projet international Religionsmonitor, de la Fondation Bertelsmann, pour lequel 14 000 personnes de 13 pays ont été interviewées. Cette étude analyse les interactions entre la religion, les valeurs et la cohésion dans la société.
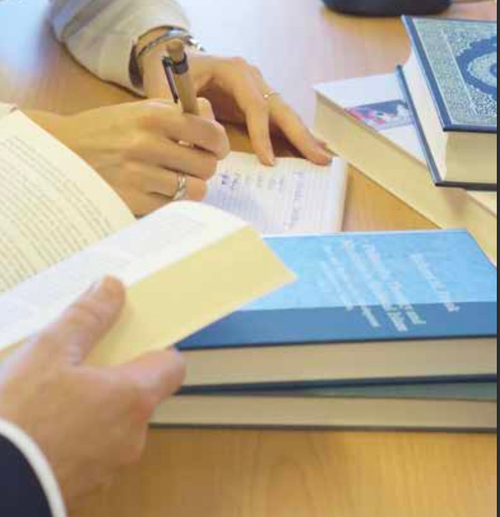 Les Universités de Fribourg et de Genève ont décidé ces deux dernières années de proposer des formations pour les imams. À Genève, une formation en français et instruction civique suisse a été mise sur pied pour les imams. À Fribourg, un Centre suisse islam et société a été inauguré en 2016. Mais tout oppose leur cursus de formation: vision, conception, contenu. Les principaux intéressés ne s’y retrouvent pas forcément.
Les Universités de Fribourg et de Genève ont décidé ces deux dernières années de proposer des formations pour les imams. À Genève, une formation en français et instruction civique suisse a été mise sur pied pour les imams. À Fribourg, un Centre suisse islam et société a été inauguré en 2016. Mais tout oppose leur cursus de formation: vision, conception, contenu. Les principaux intéressés ne s’y retrouvent pas forcément.
François Dermange, professeur d’éthique à l’Université de Genève (UNIGE), tient à être clair: le cursus proposé par son institution dès septembre 2017 n’a en rien été dicté par les responsables de communautés musulmanes. Pourtant, ce sont elles qui ont approché le Bureau de l’intégration pour recevoir de l’aide, lequel a contacté l’Université pour organiser des cours.
 Amen en hébreuDans la tradition hébraïque, chaque lettre est un voile qu’il faut soulever avec délicatesse pour voir apparaître son mystère. Formée à l’étude de la Torah et du Talmud auprès de plusieurs rabbins à Paris, Rivka Crémisi enseigne la symbolique des lettres hébraïques dans l’étude du texte biblique en hébreu. Conférencière, auteure du livre Splendeur des lettres, splendeur de l’être (éd. Dangles), elle soulève quelques bouts de voile pour choisir.
Amen en hébreuDans la tradition hébraïque, chaque lettre est un voile qu’il faut soulever avec délicatesse pour voir apparaître son mystère. Formée à l’étude de la Torah et du Talmud auprès de plusieurs rabbins à Paris, Rivka Crémisi enseigne la symbolique des lettres hébraïques dans l’étude du texte biblique en hébreu. Conférencière, auteure du livre Splendeur des lettres, splendeur de l’être (éd. Dangles), elle soulève quelques bouts de voile pour choisir.
La Kabbale nous explique qu’un mot hébreu est une boîte à bijoux; il faut l’ouvrir avec attention pour découvrir sa beauté faite de mystères à priori insondables. Ainsi, la compréhension symbolique du mot hébreu nous permet de passer du voilé au dévoilement.
