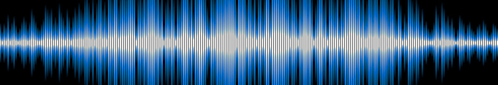
Libres propos
Depuis la mise en ligne en 2013 de notre "nouveau" site, des abonné·es et des internautes nous ont écrit. Découvrez ci-dessous leurs propos...
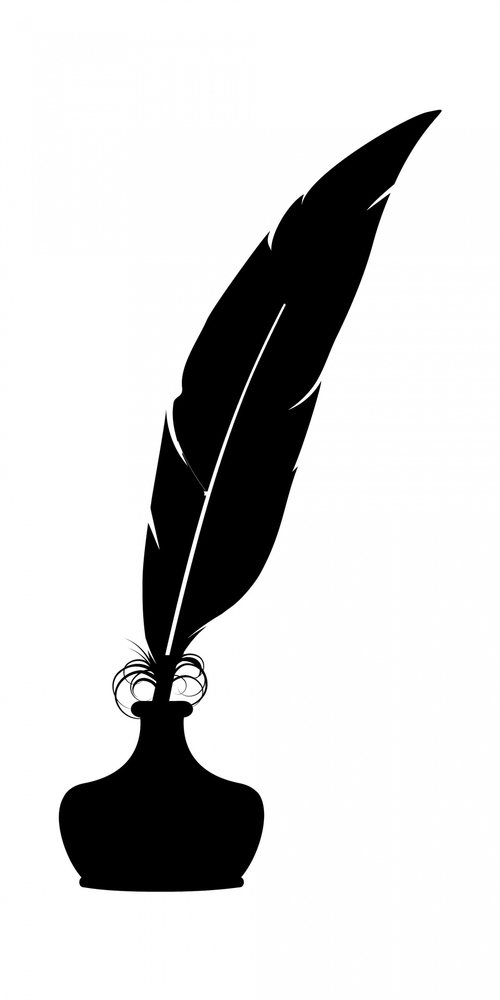 J'aimerais réagir à l'article de Céline Zufferey, intitulé Écrivain, un métier. La fin du poète maudit, qui a paru dans le n°687 de choisir. L'écrivain y défend l'idée que l'écriture littéraire est un métier que l'on peut apprendre. Elle a suivi une formation en création littéraire. «Les retours de mes collègues et de mes mentors m'ont amenée à situer mon écriture, à la préciser et à l'affirmer», écrit-elle. Cette formation a aussi permis que son écriture «progresse plus rapidement.»
J'aimerais réagir à l'article de Céline Zufferey, intitulé Écrivain, un métier. La fin du poète maudit, qui a paru dans le n°687 de choisir. L'écrivain y défend l'idée que l'écriture littéraire est un métier que l'on peut apprendre. Elle a suivi une formation en création littéraire. «Les retours de mes collègues et de mes mentors m'ont amenée à situer mon écriture, à la préciser et à l'affirmer», écrit-elle. Cette formation a aussi permis que son écriture «progresse plus rapidement.»
Je ne mets pas en cause que l'on puisse faire des expériences positives en échangeant avec d'autres écrivains, par exemple en sein d'un atelier d'écriture. Personnellement, je ne suis pas convaincu du bien fondé de la méthode, mais j'admets que chacun doit suivre la voie qui lui convient. Par contre, je me trouve en désaccord total avec Mme Zufferey quand elle se livre à la démystification de l'écrivain. Pour faire cela, elle remonte au XIXe siècle et s'en prend à ce qu'elle appelle «le mythe de l'écrivain maudit», à savoir le poète démuni et marginal, l'éternel incompris qui souffre de son génie méconnu. Elle écrit qu'il y avait alors deux catégories d'écrivain, ceux qui se conforment au goût du public et ceux qui poursuivent la logique de l'art pour l'art. C'est une vision assez simpliste. La réalité est beaucoup plus complexe. Mme Zufferey semble croire que la morale et les vertus sont les caractéristiques d'une classe et qu'au XIXe on était incapable de juger de la qualité d'un texte littéraire indépendamment de la précarité supposée ou vraie de son auteur.
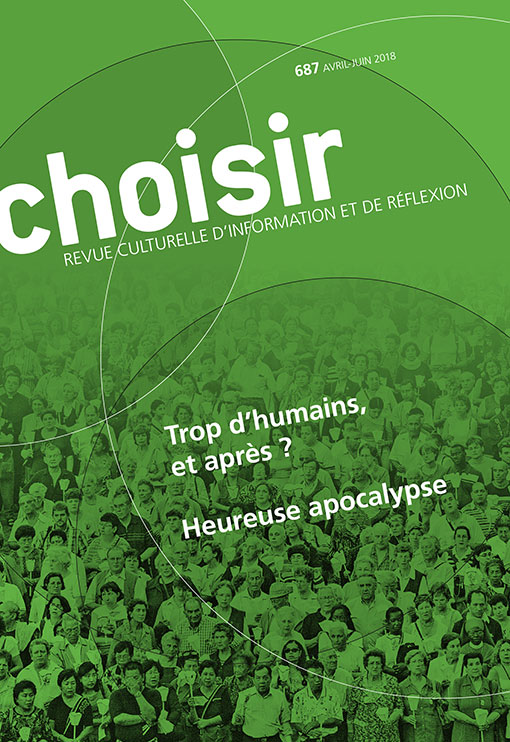 Le début de l’article «Musulmans en Europe» (in choisir n° 687, avril-juin 2018, pp. 20-24), avec les statistiques, m’a intéressé. Mais une fois les chiffres donnés, leur interprétation m’a soufflé: «Si l’on tient compte de tous ces facteurs, les indications ont claires. Elles montrent que la situation démographique de la population musulmane -de manière analogue à sa situation socio-économique- se rapprochent des conditions existantes dans les pays européens concernés.» Ah bon? Je ne vois pas du tout en quoi. Les chiffres montrent bien que leur proportion augmente (en Seine-Saint-Denis, le prénom le plus donné est Mohammed), qu’ils sont plus jeunes que les autres habitants et font davantage d’enfants. Sur le côté socio-économique d’ailleurs, rien n’est dit dans l’article. Et d’adopter ensuite l’inévitable position victimaire (islamophobie, rejet, etc) des musulmans. Position soi-disant étayée par un sondage Ipsos qui souligne la surestimation par les personnes interrogées de la proportion de la population musulmane dans leur pays.
Le début de l’article «Musulmans en Europe» (in choisir n° 687, avril-juin 2018, pp. 20-24), avec les statistiques, m’a intéressé. Mais une fois les chiffres donnés, leur interprétation m’a soufflé: «Si l’on tient compte de tous ces facteurs, les indications ont claires. Elles montrent que la situation démographique de la population musulmane -de manière analogue à sa situation socio-économique- se rapprochent des conditions existantes dans les pays européens concernés.» Ah bon? Je ne vois pas du tout en quoi. Les chiffres montrent bien que leur proportion augmente (en Seine-Saint-Denis, le prénom le plus donné est Mohammed), qu’ils sont plus jeunes que les autres habitants et font davantage d’enfants. Sur le côté socio-économique d’ailleurs, rien n’est dit dans l’article. Et d’adopter ensuite l’inévitable position victimaire (islamophobie, rejet, etc) des musulmans. Position soi-disant étayée par un sondage Ipsos qui souligne la surestimation par les personnes interrogées de la proportion de la population musulmane dans leur pays.
J'ai lu avec intérêt la critique du film Jésus, l'enquête de votre chroniqueur cinéma Patrick Bittar. Ses propos sont justes, c'est un très bon compte-rendu, mais il n'a pas remarqué la perspective évangélique américaine: lecture littérale de la Bible, born again, individualiste et même un côté échappatoire de la foi. La jeune femme prétend vivre quelque chose de merveilleux, mais cela n'implique pas pour elle un retour vers l'autre, mais simplement un effort pour amener son mari dans son monde merveilleux. Rien à voir avec la solidarité, la coresponsabilité face au cosmos donc, à mon avis, pas grand chose à voir avec le Christ.
En tout cas, le film a le mérite de susciter le débat.
J'ai beaucoup apprécié l'article de Daniel Marguerat, Jésus, un insurgé millénariste?, qui démontre combien Jésus, par son enseignement, se séparait des Zélotes. Même l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), par certaines de ses récentes décisions, semble favoriser ce renversement des valeurs en voulant "faire autrement" au mépris de la Tradition. Or cette Tradition est une notion catholique qu'elle ne reconnait hélas pas au même niveau que l’Écriture, ce qui lui éviterait cependant des dérives sans lendemains... Il y a aussi des Zélotes parmi nos Autorités ecclésiastiques. Puissions-nous en être préservés! Ce sont mes vœux pour 2017.
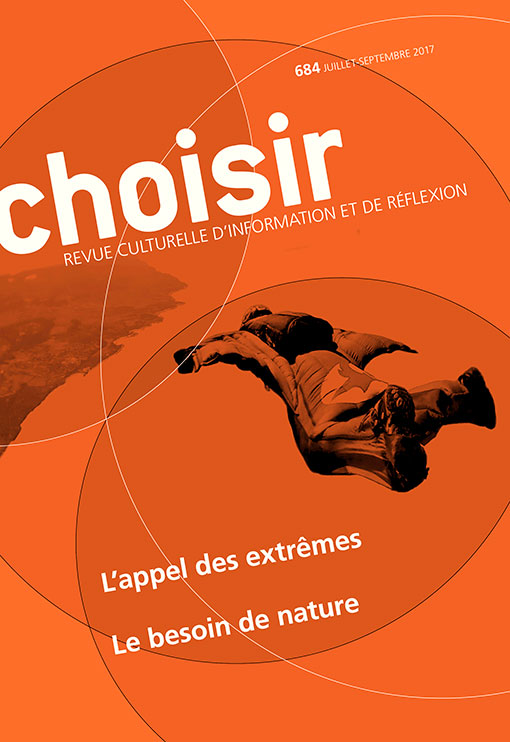 Dans son article De Malraux à Houellebecq (choisir n°684), M. Jean-Louis Loubet de Bayle nous présente une excellente synthèse de différents courants de pensée par rapport à André Malraux et son analyse de la civilisation moderne. J’aimerais juste exprimer un désaccord partiel concernant les deux points suivants: la précarité et le nihilisme.
Dans son article De Malraux à Houellebecq (choisir n°684), M. Jean-Louis Loubet de Bayle nous présente une excellente synthèse de différents courants de pensée par rapport à André Malraux et son analyse de la civilisation moderne. J’aimerais juste exprimer un désaccord partiel concernant les deux points suivants: la précarité et le nihilisme.
L’idée selon laquelle, dans les sociétés traditionnelles, la vie des hommes et des sociétés était dominée par la précarité, qui absorbait une grande partie de leur énergie et de leur faculté de réflexion, me semble fausse. C’est l’inverse qui est vrai. Vivre dans la précarité et l’insécurité, vivre constamment à proximité de la mort, faisait que l’homme restait en alerte. Les inquiétudes de son existence l’approchaient de Dieu dont qu’il restait proche. C’est dans les moments de crise, de guerre et de détresse que les églises se remplissent. Il n’y a rien de pire pour la réflexion que l’absence d’inquiétude propre à l’opulence consumériste. Comme la foi, la réflexion se nourrit de l’inquiétude.
Mesdames et Messieurs les rédactrices et rédacteurs,
Ce numéro de choisir sur les migrations ne me convainc pas. Tous vos auteurs vont dans le même sens, celui d’une hospitalité chrétienne orientée, conduisant à une ouverture sans frein de l’immigration africaine et musulmane dans notre Europe judéo-chrétienne. Ce mondialisme, voulu, ou alors naïf de la part de certains chrétiens sincères mais aveuglés, conduira à terme au Grand Remplacement et à la soumission de la civilisation chrétienne occidentale à l’islam conquérant.
Pourquoi n’invitez-vous pas des chrétiens conservateurs, apportant une réflexion différente, messagers d’une réalité difficile, d’un réveil prophétique? Par exemple, le Père Henri Boulad, prêtre jésuite égyptien, qui appelle l’Europe à se réveiller. Je cite les conclusions d’un entretien du Père Boulad avec Philippe Pellet, dans un message aux chrétiens européens et aux Français, en mars 2017, à Budapest: «Après vous être débarrassé du communisme et du nazisme, ce serait tragique de tomber dans un fascisme bien pire que les précédent car il se réfère à Dieu, ce qui fait qu’il serait plus difficile de l’éradiquer. Donc, une fois qu’il aura pris racine, vous aurez ce que nous avons connu pendant des siècles chez nous au Moyen-Orient et que je connais dans ma propre famille qui a vécu le massacre de 20’000 chrétiens en 1860, qui a fait que mon grand-père s’est réfugié en Égypte.»
Je lis toujours avec plaisir vos différents articles, qui m’amènent souvent à des réflexions fructueuses. Choisir est, par son format et par le choix des thèmes traités, la lecture idéale pendant les longues voyages en train ou en avion. En ce moment, bien au soleil et bercé par le bruit des vagues, je vous écris du fond de la Calabre en réfléchissant au thème la nuit, traité dans le dernier numéro. Très touchant l’article sur Etty Hillesum, qui jamais ne perd l’espoir.
J’aurais aimé pouvoir compléter les réflexions sur «la nuit» avec ses modestes pensées. La nuit est, pour nous, pas seulement une recharge physique et psychique, mais aussi un moment privilégié. Dans le noir, coupé de tous sens, sauf le tactile, nous sommes seuls. On peut, à l’abri du monde, être finalement vrai, se dire tout ce que l’on a pas osé faire pendant la journée, s’adresser au Seigneur sans qu’on se moque de nous, se libérer ainsi des peurs, comme quand nous étions gosses et qu'après avoir lu des romans d’épouvante, nous nous cachions au lit, sous les draps, dans un cocon bien chaud, à l’abri des fantômes et vampires (pour l’occasion le frère majeur).
Mais voilà Hypnos qui s’approche, bonne Nuit.

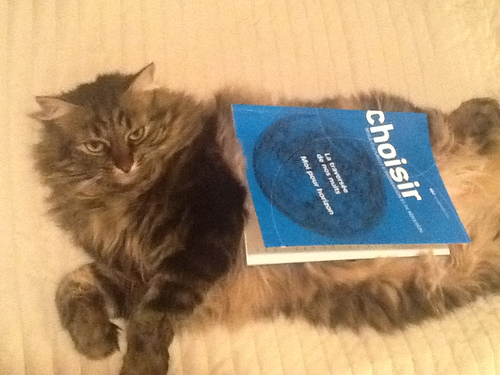 Un couple de lecteurs nous a envoyé cette sympathique photo et nous écrit:
Un couple de lecteurs nous a envoyé cette sympathique photo et nous écrit:
Le titre du n° 682, La traversée de nos nuits, aura retenu, avant lecture du tout, notre particulière attention. En effet, notre chatte pensionnaire Chapati a expressément souhaité poser pour une prochaine couverture de choisir en se couvrant, sur notre lit, du n° 682!
Plus...
L’entreprise de la guerre n’a jamais cessé dans l’histoire de l’humanité. Pire, elle fait rage aujourd’hui sous des formes nouvelles, notamment le terrorisme et le bombardement des populations par leurs propres gouvernants. Le livre Le tourment de la guerre de Jean-Claude Guillebaud, que choisir a recensé, nous en montre toutes les facettes, des fanfares destinées à galvaniser les soldats aux pillages des prédateurs qui suivent les victoires. Mais au terme de son percutant essai de synthèse des méfaits de la guerre, il évoque ces «faiseurs de paix» qui, même en eaux troubles, agissent comme des forcenés pour protéger et sauver des vies au lieu de les détruire.
En tant que vieux prêtre à la retraite, il m’arrive d’être invité à des célébrations du premier pardon. Elles me laissent de plus en plus perplexe. Comment ces enfants sont-ils préparés ? Essaye-t-on de leur donner un tant soit peu le « sens du péché » ? Cette année, par exemple, je me suis trouvé devant un panneau où les enfants avaient inscrit des exemples de péchés. Le premier mot était taper. Je ne me souvins pas des autres, mais il devait y avoir désobéir, dire des vilains mots, etc. Est-ce que ce sont vraiment des péchés ? Un péché, c’est une rupture avec Dieu. Or pas une seule fois il n’a été question de leur relation avec Dieu. « Est-ce que tu aimes le Seigneur ? Est-ce que de temps en temps tu lui parles ? Quand et comment fais-tu ta prière ? » Ce genre de questions figure parmi les abonnés absents ! Pourtant elles sont essentielles. Il s’agit bien d’un Sacrement que ces enfants sont censés célébrer.
Ils se présentent chez le prêtre avec un petit papier sur lequel ils ont écrit deux ou trois mots. Ce bout de papier leur enlève toute spontanéité. Au lieu de se raconter, de raconter leur histoire avec des détails, nous parler de ce qu’ils vivent ! Alors il faut leur poser des questions, essayer d’entamer un dialogue, ce qui prend un peu de temps. Or nous avons la consigne de faire court, parce que nous ne sommes que deux ou trois prêtres pour une quarantaine de gamins.
La cure d’une paroisse, quelque part au Brésil. Je tire, au hasard, une brochure d’un présentoir. Titre (et choc pour moi) sur la couverture de papier glacé : Marketing catholique. A l’intérieur, une présentation de la 20e rencontre de «Marketing catholique», organisée du 5 au 8 mai dernier, à l’hôtel Princesa Louça (ex-Hilton) de Belém, capitale de l’État du Pará. Messe d’ouverture célébrée par le cardinal de Rio de Janeiro, Dom Orani Jõao Tempesta, qui préside l’Institut brésilien de marketing catholique (IBMC).
Internet m’apprendra que le fondateur, il y a un peu plus de 20 ans, de l’IBMC s’appelle Antonio Kater Filho. Il se présente, dans son curriculum vitae, comme un catholique qui communie chaque jour et exerce de multiples activités : producteur de séries télévisées, musicien et compositeur, professeur d’université, écrivain, théologien, prédicateur de retraites pour couples. Et, par-dessus tout, « consulteur de marketing catholique ».
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les articles sur "L’environnement, Pari pour l’avenir", et Laudato Si' (in choisir octobre 2015, n° 669). C’est pourquoi je vous fais part de mes réflexions et observations concernant la détérioration de notre environnement : climat, eau, air, sols. Réflexion à partir de mon expérience et de mes activités en Afrique équatoriale de 1960 à 1970, et par la suite dans plusieurs ONG, avec de fréquents voyages en Afrique, à Cuba, au Nicaragua.
Laudatio Si’ est une importante contribution pour une conversion, pour s’engager résolument afin de RALENTIR la marche vers l’implosion de notre condition de vie. L’histoire et l’expérience nous prouvent qu’un cheminement vers la conversion est long, et que pour un changement important, il faut le nombre, une majorité. Une théologie positive ainsi que des projets pour un développement durable ont été diffusés depuis plus de 50 ans par des mouvements d’Action catholique (la JAC, la JOC...), par la théologie de la libération et par une multitude d’ONG de coopération Nord-Sud. Des progrès ont été faits. Mais nous devons constater les résultats : les forces négatives sont encore plus puissantes. Pour la plupart, la joyeuse espérance des années 60 a fait place à un désenchantement.
