
Livres
Marie-Joëlle Guillaume
Vincent de Paul. Un saint au Grand Siècle
Paris, Librairie Académique Perrin 2015, 490 p.
Les engagements tous azimuts de Vincent de Paul entre 1617 et 1660 le décrivent comme un homme d’exception, tant sur le plan civil que dans le contexte religieux de l’époque. Sa foi en la Providence et son humilité en toutes circonstances donnent un relief rayonnant à ses initiatives.
L’historienne Marie-Joëlle Guillaume précise : « De 1633 à 1648, il fait figure d’homme-orchestre de la charité. Au cours de la décennie, il sera à la fois supérieur de la congrégation de la Mission, directeur de Saint-Lazare, supérieur des Filles de la Charité, aumônier général des galères, supérieur de la Visitation de Paris, directeur des Dames de la Charité de l’Hôtel-Dieu, président de la Conférence des Mardis, organisateur et directeur des confréries de la Charité. Quant à la seconde décennie, qui va de la mort de Louis Xlll à la fin de la Fronde, elle est le théâtre d’une extension et d’une ascension remarquables du faisceau de ses activités. » Il se déplace, il écrit, il demeure sur le terrain en contact avec les chefs, la reine, les personnes de haut rang, il garde le souci de rencontrer personnellement les paysans et les pauvres. Il a le don de susciter des bénévoles, de partager ses engagements et d’assurer le suivi dans le détail.
La France de cette période connaît un chaos indescriptible: la guerre de Trente ans, la famine, la maladie et une hécatombe. Vincent de Paul cherche par tous les moyens à obtenir la paix ; il ose des démarches audacieuses. Quant aux Filles de la Charité et aux Lazaristes, ils transforment le tissu social. La lecture de ces innombrables récits donne l’impression d’une révolution silencieuse, avec des ramifications en Italie, dans les Iles Britanniques, en Tunisie et à Madagascar.
Un aspect lumineux transparaît au travers des faits et gestes de Vincent de Paul, qui laissent deviner l’ampleur de son rayonnement : déjà « dans son siècle, les œuvres nées de lui pèsent d’un poids d’humanité que les chiffres peinent à décrire », écrit l’auteure.
Un événement important : la rencontre à Paris, en 1618, de François de Sales et de Vincent de Paul, à l’origine d’une forte amitié, écourtée par le décès de François en 1622. Vincent écrit : « Il avait une si grande bonté que celle de Dieu se voyait sensiblement à travers la sienne. »
Par son souci d’exactitude, l’auteure, spécialiste du XVIIe siècle, nous conduit à travers des situations parfois surprenantes. Son écriture vivante facilite notre immersion dans le temps. Faire route avec Vincent de Paul, ce grand personnage, ce saint du Grand Siècle, c’est retrouver avec beauté sa confiance totale en Dieu et sa sollicitude inconditionnelle envers chacun.
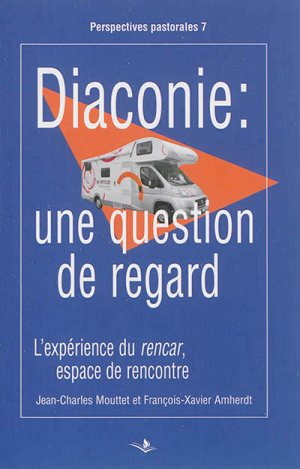 Jean-Charles Mouttet et François-Xavier Amherdt,
Jean-Charles Mouttet et François-Xavier Amherdt,
Diaconie : une question de regard
L’expérience du rencar, espace de rencontre
St-Maurice, Saint-Augustin 2014, 230 p.
Fin mai 2016, le pape François rencontrait à Rome les diacres pour célébrer les 50 ans du rétablissement du diaconat permanent, et les exhortait à sortir de leurs sécurités pour oser accueillir l’imprévu, tout en faisant montre de patience. A travers l’expérience du rencar, resituée théologiquement, cet ouvrage, bien construit et bien écrit, met en lumière la fécondité du ministère diaconal lorsqu’il part à la rencontre des innombrables marges du monde, avec miséricorde.
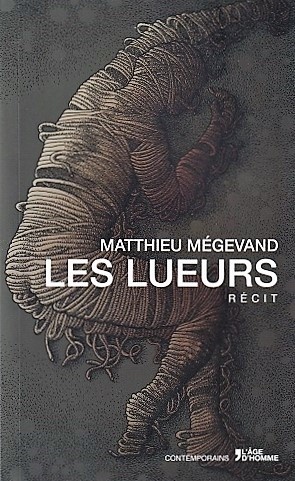 Matthieu Mégevand,
Matthieu Mégevand,
Les lueurs, récit
Lausanne, L’âge d’homme 2016, 190 p.
Après un précédent ouvrage remarqué sur le terrible accident de car de Sierre qui a provoqué la mort de 22 enfants en 20121, Matthieu Mégevand revient dans son nouveau récit sur un écueil de vie d’une toute autre nature, bien plus personnel. Un combat contre un cancer des ganglions dont il a souffert très jeune qu’il détaille tout en finesse dans un ouvrage autour de la maladie certes, mais aussi des notions de destin, de spiritualité et de foi.
En voici la recension par le théologien Sylvain Thévoz.
Gustavo Gutierrez
Heureux vous les pauvres
Paris, Parole et Silence 2015, 114 p.
Il y a, nous dit le pape François dans la préface, beaucoup de formes de pauvreté : physiques, économiques, spirituelles, sociales, morales. Mais la pauvreté économique est celle que l’on regarde avec le plus d’horreur.
Eric FuchsQ
Quand l’obligation se noue avec la liberté
Genève, Labor et Fides 2015, 132 p.
C’est un riche petit ouvrage que celui d’Eric Fuchs, professeur émérite d’éthique à la Faculté protestante de théologie de Genève. Un livre dont le titre reprend l’un des trois piliers sur lesquels repose la réflexion.
René Stockman
La boîte de Pandore
Réflexion sur l’euthanasie sous une perspective chrétienne
Namur, Fidélité/Editions jésuites 2015, 148 p.
Voilà un livre bien construit, honnête, provenant d’un homme dont l’autorité en la matière ne fait aucun doute : théologien flamand (actuel supérieur des Frères de la Charité), il a longtemps été directeur d’institutions psychiatriques. Le titre, La boîte de Pandore, résume bien le constat de l’auteur : la dépénalisation de l’avortement a préparé celle de l’euthanasie (en Belgique en 2002), ainsi que son combat : René Stockman s’est courageusement engagé dans le débat public. Ces deux dépénalisations, analyse-t-il, sont le résultat de la perte du sens de la vie et de la dignité de toute personne.
Anne Sandoz Dutoit
Vieillir. Un temps pour grandir
Bière, Cabédita 2014, 96 p.
L’auteure travaille comme bénévole dans un établissement médico-social. Les personnes âgées ne lui sont donc pas étrangères et la Bible non plus. Une Bible qu’elle va citer avec justesse tout au long de son livre, lequel se lit avec intérêt et émotion.
Yasmina Foehr-Janssens, Silvia Naef et Aline Schlaepfer (éd.), Voile, corps et pudeur. Approches historiques et anthropologiques, Genève, Labor et Fides 2015, 288 p.
Le port du voile suscite des débats passionnels. En France, en Belgique, dans certains cantons suisses,[1] des dirigeants politiques estiment que la présence sur leur territoire de femmes qui se couvrent la tête et le visage constitue un danger pour la société et que, par conséquent, ils doivent légiférer. Invoquant la laïcité, l’égalité des individus et des sexes, ils bricolent des lois qui interdisent la «couverture faciale» ; des lois qui, plus que de sanctionner les contrevenantes, amènent à incriminer «l’autre» comme fauteur de « choc de civilisations».
Plus...
Sylvoisal, Le spleen de Satan et Actéon, Vevey, Le Cadratin 2015, respectivement 68 p. et 30 p.
Le spleen de Satan est un savant mélange de deux genres, la poésie et le théâtre. Après D’Amour, de Mort et d’Infidélité en 2012, notre mystérieux poète reprend la forme du dialogue poétisé qu’il avait déjà employée pour donner son interprétation personnelle de la fin de Tristan et d’Yseult. La première page, avant la levée du rideau, fait penser au prologue du jongleur qui annonce au public « l’étrange histoire » qu’il chantera, celle des mortels et des dieux, celles de « l’âme à ses démons livrée. » Mais ce qui suit est plus proche du théâtre de Racine que d’une chanson de Geste. Des dialogues en alexandrins entre l’Ame, l’Ange et Satan, qui sont ici personnifiés, nous amènent au cœur même du mystère de l’homme qui est « Abel et Caïn issus du même père ».
Frère Roger de Taizé, Dynamique du provisoire. A l'écoute des nouvelles générations 1962-1968, Les Presses de Taizé 2014, 284 p.
En 1965 déjà, dans son livre Dynamique du provisoire que le pape Paul VI gardait toujours sur sa table, Frère Roger écrivait : « Autrefois, les schismes menaçaient. Aujourd'hui, c'est l'indifférence des plus jeunes. Ce que la nouvelle génération demande, c'est qu'on lui prouve qu'on vit l'Evangile dans sa fraîcheur première... en esprit de pauvreté, dans la solidarité avec tous et non seulement avec une famille confessionnelle ! Où est cette dynamique sinon dans un retour aux sources... une réconciliation. Car catholique ou protestantes, les générations montantes exigent la réforme des institutions vieillies. » Mais, poursuit-il, rien de durable ne s'accomplit sans une création commune ! Et cela, jour après jour, chaque membre de la communauté de l'Eglise participe à la recréation du corps tout entier. Et seul celui qui a le sens des continuités peut être au bénéfice du provisoire.
José Davin, Les personnes homosexuelles. Un arc-en-ciel dans les nuages, Namur, Fidélité 2014, 152 p.
L’orientation homosexuelle suscite de nombreuses interrogations et souvent déroute beaucoup d’entre nous. José Davin, prêtre jésuite, ayant une grande expérience pastorale avec les personnes homosexuelles, propose une réflexion sur l’homosexualité dans un livre émaillé de témoignages. Ce qui le rend très vivant et très émouvant. Ce qu’il demande, c’est un changement de regard, d’attitude, de la part de l’Eglise bien sûr, mais aussi de chacun d’entre nous : lorsque nous rencontrons une personne homosexuelle, c’est d’abord une personne que nous rencontrons et non pas une pratique sexuelle. Comme c’est le cas lorsque nous rencontrons une personne hétérosexuelle.
Michel Salamolard
En finir avec le « péché originel » ?
Paris, Editions jésuites/ Fidélité 2015, 288 p.
Un beau livre utile. Et j’insiste sur l’utilité, car il permet à un non spécialiste de s’orienter dans une problématique qui remonte à saint Augustin, qui comporte la difficile question des enfants non baptisés, c'est-à-dire qui porte aussi sur des croyances et des rites ancrés dans une tradition simplement transmise. Des questions qui finalement touchent à une interrogation séculaire : qu’est-ce que le mal, pourquoi y a-t-il du mal ? ; et avec saint Anselme : cur deus homo ?, pourquoi fallut-il un sauveur ?
Un coup de maître d’abord : une manière sûre et intelligente de séparer ce que la foi catholique a retenu de saint Augustin à ce sujet, et ce qui reste du registre de l’opinion personnelle. D’utiles précisions sur la notion de « dogme » sont à retenir à cette occasion.
