
Livres
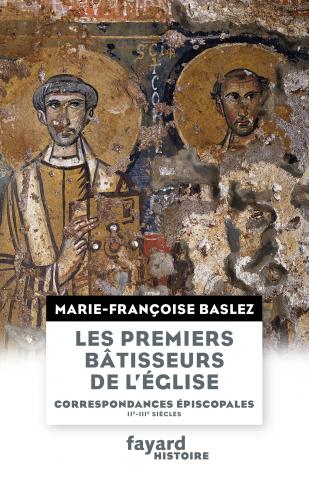 Historienne de l’Antiquité gréco-romaine, Marie-Françoise Baslez s’est fait connaître par des ouvrages de référence, notamment Saint Paul, artisan d’un monde chrétien (1991, réédité en 2012 avec des compléments) et Chrétiens persécuteurs. Destructions, exclusions et violences religieuses (2014) qui a suivi Les persécutions dans l’Antiquité. Victimes, héros, martyrs (2007).
Historienne de l’Antiquité gréco-romaine, Marie-Françoise Baslez s’est fait connaître par des ouvrages de référence, notamment Saint Paul, artisan d’un monde chrétien (1991, réédité en 2012 avec des compléments) et Chrétiens persécuteurs. Destructions, exclusions et violences religieuses (2014) qui a suivi Les persécutions dans l’Antiquité. Victimes, héros, martyrs (2007).
Elle vient d’écrire un passionnant article pour le dossier «Origines» de la revue choisir d’avril-mai-juin, n° 684, intitulé Christianisme - Le temps des bâtisseurs (ce numéro peut être commandé en écrivant à ).
C’est sur les traces de l’aventure solidaire Nord-Sud de tout un canton que nous entraîne le livre publié par la Fédération genevoise de coopération (FGC) à l’occasion des 50 ans de sa création, en 1966. Car ils sont nombreux ceux qui, au cours du demi-siècle écoulé, ont été impliqués dans «la facette altruiste» de Genève, que ce soit en tant qu’acteurs de la FGC elle-même, de l’une de ses 60 ONG membres ou d’une autorité publique donatrice.
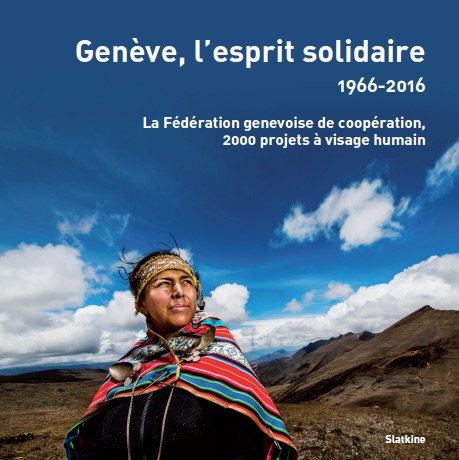
Genève, l’esprit solidaire. 1966-2016
La Fédération genevoise de coopération,
2000 projets à visage humain
Genève, Slatkine 2017, 168 p.
HISTOIRE
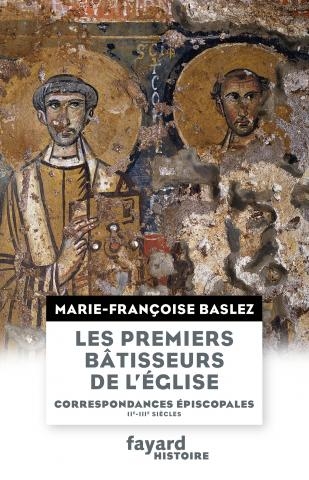 Marie-Françoise Baslez, Les premiers bâtisseurs de l’Église. Correspondances épiscopales (IIe-IIIe siècles)
Marie-Françoise Baslez, Les premiers bâtisseurs de l’Église. Correspondances épiscopales (IIe-IIIe siècles)
Fayard, Paris 2016, 303 p.+ 2 cartes
Historienne de l’Antiquité gréco-romaine, Marie-Françoise Baslez s’est fait connaître par des ouvrages de référence. Son nouveau livre analyse les correspondances des évêques des IIe et IIIe siècles jusqu’au début du IVe siècle, avec l’avènement de Constantin et le concile de Nicée (325). Les sources étudiées vont des Lettres d’Ignace d’Antioche (vers 115) à la correspondance de Cyprien de Carthage à la fin de la période, en passant par celles de Polycarpe de Smyrne (vers 156). L’auteure y ajoute quelques inscriptions, dont celle de l’évêque Abercius qui, au IIe siècle, a beaucoup voyagé et visité nombre d’Églises, entre Rome et la frontière de l’Empire perse.
En plus des épîtres publiées, M.-F. Baslez s’attache à dégager les nombreuses lettres citées ou résumées dans l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée, le premier grand historien de l’Antiquité chrétienne (mort en 340). Sa méthode consiste à extraire du récit historique à caractère théologique d’Eusèbe tout ce qui concerne les événements, les conflits, les débats qui ont agité l’Église des premiers siècles.
Avec les autres sources textuelles, l’historienne retrace les axes, les évolutions, les dynamiques qui ont conduit à l’émergence de la « Grande Église », selon le mot du païen Celse, cité par Origène. Elle fait apparaître des hommes de terrain, enracinés dans un terreau local ou venant de l’extérieur, susceptibles d’apporter du renouvellement, comme Irénée de Lyon ou Paul de Samosate à Antioche ; des hommes de réseaux, comme l’évêque Denys de Corinthe (vers 170) ou Denys d’Alexandrie (au milieu du IIIe siècle), qui, par leurs lettres, tissent un maillage régional en Grèce ou plus tard en Égypte.
L’évêque alors est avant tout l’ordonnateur de la chrétienté locale. Ce que nous appelons hiérarchie consiste d’abord en un développement d’une organisation pratique, souvent issue des modèles des associations civiles grecques. Les justifications théologiques, telle celle de l’évêque image du Père chez Ignace d’Antioche ou celle de l’évêque successeur des apôtres chez Eusèbe, viennent en second, après les réponses pragmatiques aux besoins de la communauté. L’apparition d’un cursus ecclésiastique, d’un « ordre » au sens romain, n’apparaîtra que plus tard et en Occident. Le presbytre recevra alors à Carthage des honneurs, des privilèges et une gratification : « Une forme de sacerdotalisation était en cours (...) qui séparait et distinguait le clerc de l’homme ordinaire, impliqué dans les activités profanes », note l’auteure. La charge de lecteur revêt alors une importance particulière car l’annonce de la parole est essentielle dans l’évangélisation. « Le ministère de la parole est une particularité des Églises à l’intérieur du mouvement associatif antique », remarque l’his-torienne.
À côté de l’idée de réseaux, M.-F. Baslez développe la question de l’autorité, en se distançant des thèses qui opposent l’évêque et les charismatiques. Ceux-ci, dès l’époque du Nouveau Testament (Philippe et ses filles prophétesses dans les Actes des Apôtres), jouent un rôle important. Parfois, comme en Phrygie, la « Nouvelle prophétie » s’érige en com-munauté séparée, comme une alternative à une Église trop installée et trop institutionnalisée. Mais il y aussi des évêques charismatiques (Méliton en Asie mineure, Narcisse à Jérusalem).
Les problèmes d’autorité ont été particulièrement cruciaux au moment des persécutions. Comment gérer l’absence de l’évêque lorsque celui-ci a fui ? Des « confesseurs », c’est-à-dire ordinairement des membres du clergé porteurs de l’Esprit, qui n’ont pas failli pendant la persécution et ont enduré les tortures, assurent l’intérim pendant l’absence de l’évêque.
La consolidation de l’autorité épiscopale se fera aussi par l’activation des réseaux horizontaux, par les lettres et en s’appuyant sur l’autorité charismatique du confesseur. L’absence de l’évêque, certes, ne facilitera pas les choses, toutefois ce problème restera interne au clergé. Entre exclure ou persuader, la pastorale compréhensive (le fait de réintégrer au coup par coup ceux qui ont abandonné la foi à cause des persécutions) l’emportera et, en définitive, renforcera l’autorité de l’évêque.
Progressivement, à travers les correspondances épiscopales, on voit ainsi se bâtir la « Grande Église ». « Ces lettres déroulent le film d’une Église en construction, que les évêques travaillent à édifier selon deux dynamiques : l’une fédérative, par la réunion des Églises locales et de leurs représentants dans l’institution synodale, et l’autre inclusive, par une pastorale qui vise à la réintégration plutôt qu’à l’excommunication », conclut l’historienne.
Sans succomber aux anachronismes, cette enquête historienne ouvre le regard sur l’Église actuelle. Un bel ouvrage, qui fourmille d’anecdotes prises sur le vif, tirées de ses sources, qui en rendent la lecture captivante.
Joseph Hug sj
PHILOSOPHIE
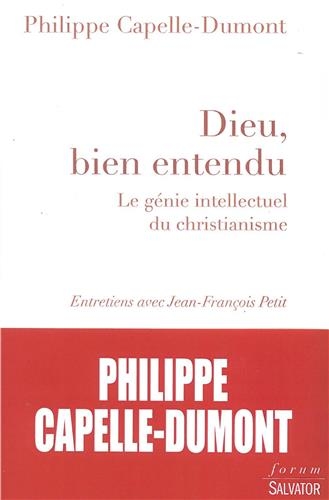 Philippe Capelle-Dumont
Philippe Capelle-Dumont
Dieu, bien entendu. Le génie intellectuel du christianisme,
entretiens avec Jean-François Petit
Paris, Salvator 2016, 242 p.
Dieu, bien entendu, signifie deux choses. C’est évidemment de Dieu qu’il est question, et c’est de Dieu si possible bien compris qu’il s’agit. Si possible, dans la mesure de ce qui est possible à l’homme, sous les deux modalités de la philosophie et de la théologie, de l’intelligence rationnelle et de l’intelligence de la foi.
Il y a longtemps que je n’ai lu quelque chose d’aussi généreux, d’aussi lumineux, d’aussi attentif à la pensée d’autrui que ces entretiens entre Jean-François Petit et Philippe Capelle-Dumont, ancien doyen de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, président de l’Académie catholique de France. Tout ce qui concerne aujourd’hui le « génie » du christianisme se profile ici, dans ce tour d’horizon et ce diagnostic de l’état de l’Église et de la chrétienté en tant qu’institution, espace de culture intellectuelle et large vivier spirituel. Et dans tous ces domaines, Philippe Capelle-Dumont répond aux questions de son interlocuteur avec une pertinence et une justesse d’information qui ravissent et étonnent à la fois.
Le ton général, témoin d’une conviction de fond et d’une fidélité sans faille, est sans doute donné par cette remarque : « L’Église par sa structure institutionnelle raconte l’histoire sainte et n’exprime pas d’abord ni essentiellement un dispositif démocratique de prises de parole croyantes. C’est là même une ligne de partage entre la conception mystérieuse et incarnée de l’Église et une conception idéologique soumise aux aléas du temps. » C’est dire aussi que la philosophie n’y est jamais abordée dans ses risques idéologiques, mais toujours dans sa dimension noble, scientifique et métaphysique, de recherche de la vraie sagesse.
Philibert Secretan
BIBLE
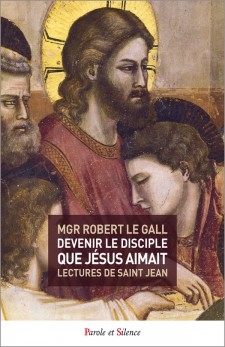 Mgr Robert Le Gall
Mgr Robert Le Gall
Devenir le disciple que Jésus aimait
Lecture de saint Jean
Paris, Parole et Silence 2016, 240 p.
Nous sommes fortement encouragés à faire une lecture suivie du quatrième Évangile qui, d’après Mgr Le Gall, est l’un des plus abordables par le langage, les images, les symboles profonds et saints à la fois. Il faut dire que le texte grec de Jean est le premier - tant il est clair et simple - que l’on donne à traduire aux étudiants en grec biblique. L’auteur nous propose une lectio divina partagée sur l’Évangile de Jean, ses lettres et des incursions dans son Apocalypse.
Qui était le « disciple bien-aimé » à qui Irénée attribue l’écriture de ce quatrième Évangile ? Le voile n’a pas tout à fait été levé, mais l’ouvrage de l’archevêque de Toulouse est fait pour que nous devenions toujours davantage, les uns et les autres, ce « disciple que Jésus aimait ». Pour que nous soyons de ceux qui répondent à Jésus, avec Simon Pierre : « Tu sais bien que je t’aime ! »
Le livre présente diverses interventions sur saint Jean, qu’elles soient dans le diocèse de Toulouse, à Toronto ou en Nouvelle Calédonie. Pour les prêtres, Mgr Le Gall montre la continuité entre le sacerdoce de Moïse et celui de Jésus, illustrant sa devise : « Donner Dieu aux hommes pour donner les hommes à Dieu. » Un ouvrage tonique, qui saura enrichir notre colloque intime avec le Seigneur.
Monique Desthieux
SPIRITUALITE
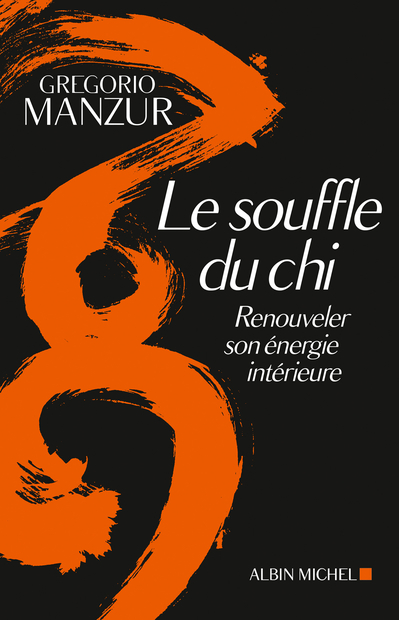 Gregorio Manzur
Gregorio Manzur
Le souffle du chi
Renouveler son énergie intérieure
Paris, Albin Michel 2016, 238 p.
Vous connaissez cet art martial, composé de cent huit mouvements continus et circulaires qui s’enchaînent avec lenteur et précision ? On en voit des adeptes dans les parcs. Tai-chi, chigong : ces pratiques découlent de siècles de recherches sur les fondements de notre nature humaine comme chemin spirituel et pour préserver une bonne santé.
Gregorio Manzur, écrivain, originaire d’Argentine et installé à Paris depuis 1965, a découvert une expérience qui a transformé sa vie. Les enseignements du maître Gu Meisheng en 1984, à la Sorbonne, l’ont ouvert aux grandes philosophies chinoises : taoïsme, confucianisme et bouddhisme chan. Puis il a lui-même enseigné cette pratique. Pour les Chinois, le chi est le souffle vital. C’est une énergie universelle qui est à l’origine de notre monde et de l’Univers. Nous ne possédons pas le chi, nous sommes le chi !
Ce livre, issu du dialogue entre l’auteur et ses élèves, peut aussi éclairer ceux qui découvrent cette sagesse.
Marie-Thérèse Bouchardy
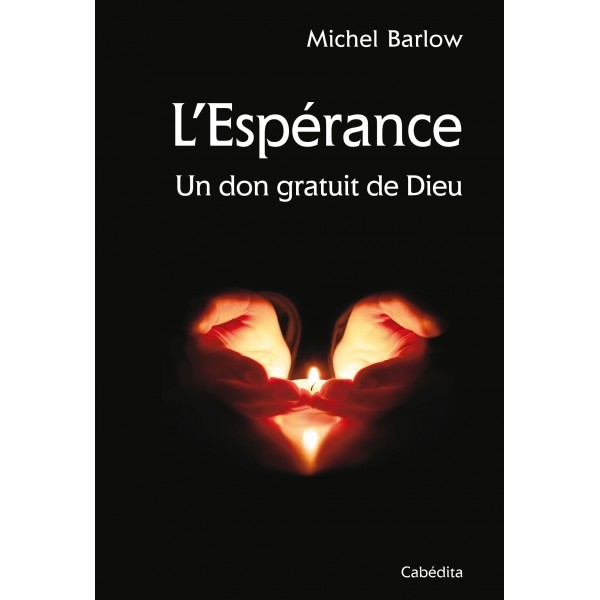 Michel Barlow
Michel Barlow
L’Espérance. Un don gratuit de Dieu
Bière, Cabédita 2016, 92 p.
L’espérance a mauvaise presse de nos jours. Pour nos contemporains, le plus souvent, n’est-elle pas une négation du réel? L’auteur, avec humour et des ima-ges particulièrement pertinentes et parlantes, redonne toutes ses lettres de noblesse à la deuxième vertu théologale, si chère à Péguy. L’espérance en un avenir meilleur s’oppose à une attitude passive, résignée. Un bon exemple en serait l’attitude des « résistants » au nazisme lors de la dernière guerre. Ils espéraient de tout leur être le retour du drapeau tricolore sur le sol français.
Michel Barlow, prédicateur laïc au sein de l’Église protestante, rejoint l’intuition de la Réforme en affirmant que le croyant n’a pas à gagner sa vie en accumulant les mérites. La grâce est donnée gratuitement. C’est cette grâce donnée par un Père infiniment aimant qui nous donne « l’espérance » d’être accompagnés par son Fils Jésus-Christ, pour nous aider à grandir en humanité, à nous humaniser toujours davantage. Revêtus de la grâce divine nous serons à même d’être comme un enfant qui se projette avec « espérance » dans l’avenir, tant il se sent encouragé, dynamisé par l’amour et la confiance que ses parents mettent en lui.
Monique Desthieux
SOCIÉTÉ
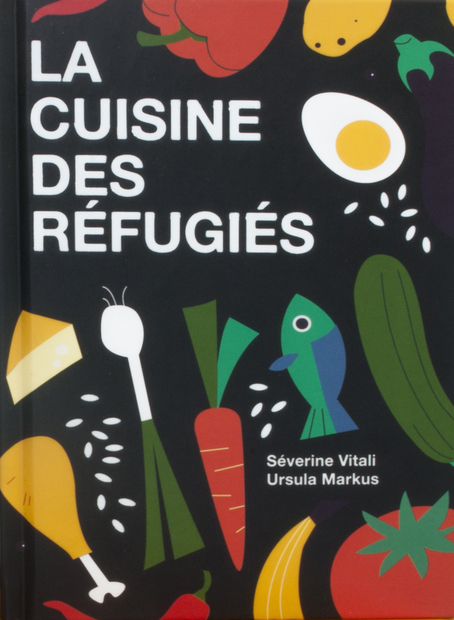 Séverine Vitali
Séverine Vitali
La cuisine des réfugiés
Photos Ursula Markus
Lausanne, Helvetiq 2016, 76 p.
« L’appétit vient en mangeant », dit le dicton. L’appétit pour le mon-de ne fait pas exception. Se joindre à la table d’autres cultures que la sienne permet d’attiser la curiosité et l’envie de rencontre. C’est le but visé par l’interprète zurichoise, mem-bre du réseau Solinetz, Séverine Vitali. Elle invite à découvrir les plats de seize pays desquels sont issus une grande majorité des réfugiés dans notre pays. Et pour attiser l’intérêt, elle accompagne les recettes de cuisine du portrait de son auteur et du récit de son parcours d’exilé. Ce livre ne force pas l’appétit, il dit : voilà qui je suis ; un être aux racines essentielles à son équilibre.
La cuisine des réfugiés est un livre de culture donc, mais aussi de papilles. Les recettes proposées ne sont pas de simples prétextes. Elles sont détaillées et accompagnées des photographies d’Ursula Markus. Un vrai travail d’exhausteur de goût. Ces images présentent les ingrédients, les plats et leurs auteurs. Elles dégagent une atmosphère familiale et dépeignent le cadre de vie des réfugiés. Et pour ne rien gâcher, l’objet est beau et agréable à tenir en main.
Céline Fossati
TEMOIGNAGE
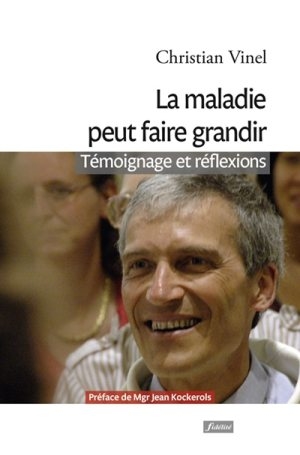 Christian Vinel
Christian Vinel
La maladie peut faire grandir
Témoignage et réflexions
Namur, Fidélité 2016, 142 p.
À 49 ans, un prêtre plein d’énergie et d’enthousiasme se voit confronté à la maladie : cancer du colon avec métastases aux poumons et au foie. La prière et la communion avec ses amis vont l’aider. Il se sent entouré et de Dieu et de ses proches, et sa confiance se met à croître alors que ses forces diminuent.
Dans ses news, les messages qu’il envoie, on redécouvre avec lui des passages de l’Évangile qui, relus et médités, font grandir chacun. Cette maladie, confie-t-il, est comme un temps sabbatique pendant lequel il prend soin de lui et s’émerveille des rencontres que le Seigneur suscite. Il cite le pape Benoît XVI : « Les malades ne sont pas étrangers au destin du monde. Dieu, en grand artiste, forme jour après jour, y compris avec la contribution des malades, une grande mosaïque dont ils sont comme les pierres précieuses. »
Cette difficile traversée de cinq ans, avec chimiothérapies, opérations, rémissions et dernier pèlerinage à Lourdes avant son passage dans l’au-delà, est à la fois bouleversante et vivifiante, tant la patience et la confiance du malade grandissent. Il se répète encore et encore que Dieu a son temps à Lui, même si c’est dur. Il apprend à accepter que tout ne dépend pas de lui-même, qu’un Autre s’occupe de lui... À être cool sans pour autant démissionner ou être fainéant. Il appelle ça «conversion ». Qu’Il grandisse et que je diminue... Et de citer Paul Claudel : « Dieu n’est pas venu pour supprimer la souffrance. Il n’est même pas venu l’expliquer, il est venu la remplir de Sa présence. »
Merci aux amis de Christian Vinel qui ont décidé de partager cette expérience de confiance, d’apprivoisement de la souffrance. On ne ressort pas de ce témoignage comme on y est entré. Les photos sont des rayons de soleil.
Marie-Luce Dayer
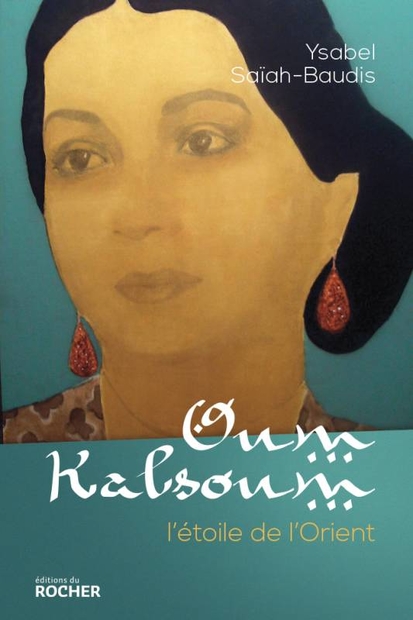 Ysabel Saïah-Baudis
Ysabel Saïah-Baudis
Oum Kalsoum
L’étoile de l’Orient
Paris, du Rocher 2016, 350 p.
Le Rossignol du Delta ! Oum Kalsoum (1904-1973), issue d’un petit village du delta du Nil, a accompagné de sa voix splendide, qui transcendait l’amour et magnifiait le pays, tout un siècle d’histoire de l’Égypte. Mais elle a aussi atteint le cœur de milliers d’Arabes. Elle a connu les plus grands de leurs poètes dont elle interprétait les textes. Aujourd’hui encore, elle « catalyse le mon-de arabe (...) elle exprime toute l’âme arabe » et touche les cœurs du peuple aussi bien que ceux des dirigeants.
« Je ne suis pas une personnalité politique, je suis une chanteuse qui aime son pays », disait-elle. Car elle savait se servir des mots aussi bien que de sa voix. Le mythe d’Oum Kalsoum n’a cessé de grandir. « C’est la personnalité la plus forte et la plus connue de l’art arabe... L’étoile de l’Orient. »
Ysabel Saïah-Baudis, journaliste et auteure, fait revivre cette « icône de l’art » à partir de témoignages de proches et d’admirateurs. Elle nous offre un éclairage lumineux sur cette star mythique orientale.
Marie-Thérèse Bouchardy
LITTERATURE
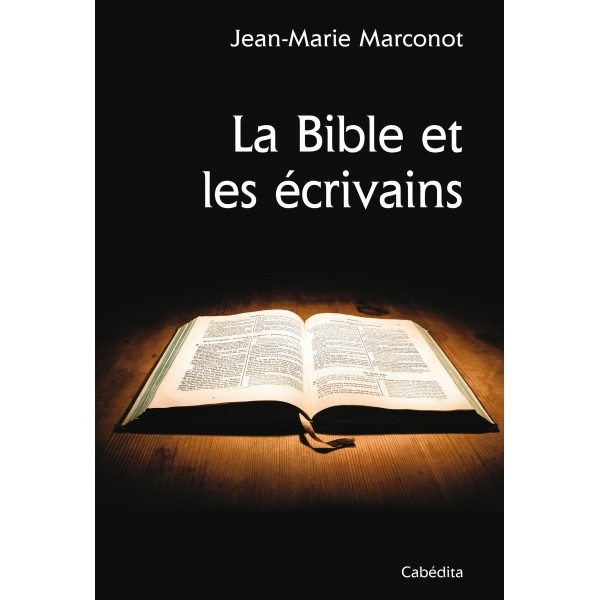 Jean-Marie Marconot
Jean-Marie Marconot
La Bible et les écrivains
Bière / Nîmes, Cabedita / Riresc 2016, 190 p.
Pendant une quinzaine d’années, l’auteur, formé à la sociolinguistique et intéressé par les récits de vie et de quartiers, a animé le groupe de Recherches bibliques interdisciplinaires à l’Université Paul Valéry de Montpellier. II nous offre, dans ce livre qui n’est pas ordinaire, un bref parcours de vingt-huit écrivains de langue française qui ont cité dans leurs œuvres certains passages de la Bible. Bien sûr, nous dit-il, il faudrait un livre pour chaque auteur !
Partant de la chanson de Roland, de Marie de France et de Villon, passant par Rousseau, Hugo, Lamartine, Ramuz, Sartre, Bernanos, Apollinaire et ... Geor-ges Brassens, pour n’en citer que quel-ques-uns, il nous entraîne dans des découvertes enthousiasmantes.
Je relèverai Agrippa d’Aubigné et sa tendresse pour les pauvres. Ramuz, montagnard tranquille que le roman Adam et Eve (1932) fit sortir de la pauvreté. Flaubert lu par Sartre ... surprenant ! Apollinaire, que sa mère n’habillait que de bleu et de blanc et qui la nuit, avec son camarade, quittait le dortoir pour aller prier dans la chapelle. Francis Jammes, qui pour comprendre son destin de poète se comparait à un animal domestique (un vieux cheval cassé ou une chienne à qui le maître prend les petits pour les jeter à l’eau). Enfin Brassens, que j’ai tant aimé et aime toujours, qui mettra en musique un poème de Jam-mes, chantera La mauvaise réputation, La ballade des cimetières, Le testament, la Chanson de l’Auvergnat et tant d’autres. Brassens cite Jésus (nom araméen), mais quand celui-ci est appelé Christ, nous dit-il, il devient un autre personnage ... celui des tableaux officiels dans les églises.
Je pourrais encore citer Joan Bodon qui écrit en langue d’oc, ou Renan ou Vigny, mais je vous laisse le soin de les découvrir avec le même bonheur qui fut le mien.
Étudier la Bible chez les écrivains est malaisé, confie l’auteur, car elle-même n’est pas simple. Mais il relève un trait essentiel : communautés religieuses et auteurs partagent le même destin et le même langage. Les symboles appartiennent à toute la vie sociale.
Marie-Luce Dayer
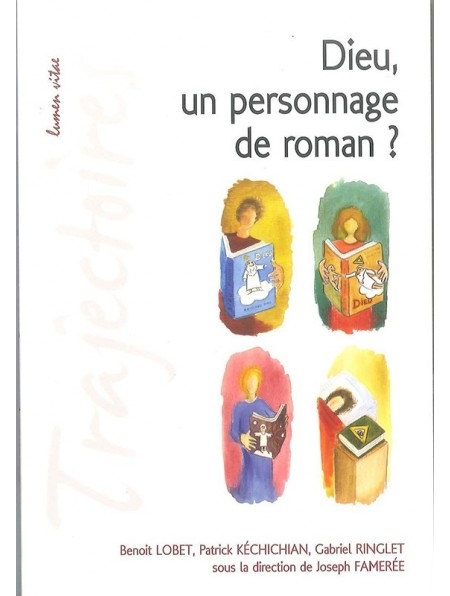 Sous la direction de
Sous la direction de
Joseph Famerée
Dieu, un personnage de roman ?
Namur, Lumen Vitae 2016, 86 p.
Cet ouvrage reprend les exposés d’un colloque tenu à Louvain. Patrick Kéchichian, l’un des auteurs, s’attaque à un vaste sujet : l’énigme de la littérature catholique en France, de la seconde moi-tié du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. Littérature catholique ... c’est de fait plus un paradoxe qu’une énigme comme l’annonce le titre de sa conférence.
Pour le philosophe Jacques Maritain, il fallait avoir le cœur et l’art assez purs pour peindre le mal sans connivence. D’où une vive discussion avec François Mauriac, qui aimait à se définir comme un catholique qui fait des romans, et qui était tourmenté, comme ses écrits en témoignent. La connivence du romancier est indispensable, disait Mauriac, elle est la condition de son art, car le romancier est un créateur de vie fictive et s’identifie à la créature. Les passions du cœur sont donc le pain et le vin de l’écrivain. Les décrire sans connivence est à la portée du philosophe et du moraliste, non de celui dont l’art consiste à rendre sensible l’imaginaire, ce monde plein de délices criminels mais aussi de sainteté.
Georges Bernanos se situait, lui, au-delà du carcan de la psychologie sociale ou individuelle. La grâce est l’axe de l’action, elle dessine et détermine les personnages, pensait-il. Et c’est le néant existentiel, la vacuité et la mort de l’âme qui traduisent l’absence de Dieu. Mais si ce métier d’écrivain est une aventure spirituelle, c’est aussi un calvaire. « Mes livres et moi ne font qu’un », dira-t-il.
Autre participant au colloque, l’écrivain Gabriel Ringlet, qui montre comment le personnage de Dieu est abordé dans quelques fictions. Ainsi Jean Grosjean raconte la Bible en en faisant un récit. Il comble les ellipses du texte et rend l’énigme qui le traverse : Dieu nous échappe car il passe, il est furtif.
Ce livre retient l’attention parce qu’il pose la question : le roman, la poésie, la littérature en général nous parlent-ils mieux de Dieu que la théologie ?
Jean-Daniel Farine
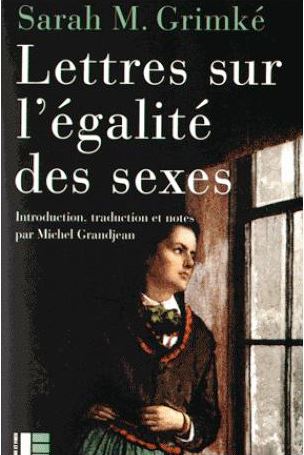 Sarah M. Grimké
Sarah M. Grimké
Lettres sur l’égalité des sexes
Introduction, traduction et notes par Michel Grandjean
Genève, Labor et Fides 2016, 278 p.
Sarah Grimké (1792-1873) a grandi à Charleston en Caroline du Sud, dans une famille riche et influente. Enfant, elle est déjà sensible aux inégalités et sympathise avec les enfants des esclaves des plantations. Adolescente, elle découvre qu’elle ne pourra pas devenir avocate, les études étant réservées aux garçons. Il ne lui reste qu’à combler ses lacunes d’instruction par elle-même... Les manuels de latin et de grec que lui amène son frère Thomas la rendent capable de lire la Bible dans ses langues d’origine, ce qui lui permet de contrer les interprétations de versets bibliques dont abusent certains pour justifier l’oppression des Noirs et des femmes.
 Inouïe la somme d’informations concernant les guerres! Une telle connaissance de l’Histoire, mêlé à ce sentiment d’étonnement face à la cruauté vécue par tant de soldats et de personnes est intriguant. L’auteur le révèle, après avoir vu un charnier en Sibérie: «Une chose est de savoir une autre de voir... Cette fois, à titre personnel, j’étais physiquement devant l’effroyable chose.» Un livre qui a captivé deux de nos recenseurs.
Inouïe la somme d’informations concernant les guerres! Une telle connaissance de l’Histoire, mêlé à ce sentiment d’étonnement face à la cruauté vécue par tant de soldats et de personnes est intriguant. L’auteur le révèle, après avoir vu un charnier en Sibérie: «Une chose est de savoir une autre de voir... Cette fois, à titre personnel, j’étais physiquement devant l’effroyable chose.» Un livre qui a captivé deux de nos recenseurs.
Jean-Claude Guillebaud
Le Tourment de la guerre
Paris, L’lconoclaste 2016, 394 p.
René Longet, un humaniste volontariste
Écrit par Jean-Blaise Fellay sj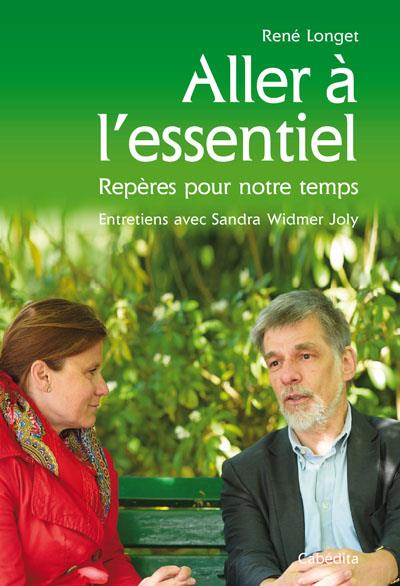 Partir de l’«indignez-vous» pour aller à l’«engagez-vous». Agir, fédérer, se responsabiliser, prendre conscience des menaces et des défis, se regrouper pour atteindre plus d’efficacité, telle est la morale très volontariste de René Longet. Elle s’est manifestée dans une vie d’engagement à en donner le tournis. Dans la politique d’abord. René Longet a commencé curieusement par le haut, avec neuf ans de présence au Conseil national, puis a terminé avec trois législatures à l’exécutif de la Commune d’Onex. Cela correspond à son très fort désir de rester au contact de la réalité. Socialiste certes, mais pragmatique.
Partir de l’«indignez-vous» pour aller à l’«engagez-vous». Agir, fédérer, se responsabiliser, prendre conscience des menaces et des défis, se regrouper pour atteindre plus d’efficacité, telle est la morale très volontariste de René Longet. Elle s’est manifestée dans une vie d’engagement à en donner le tournis. Dans la politique d’abord. René Longet a commencé curieusement par le haut, avec neuf ans de présence au Conseil national, puis a terminé avec trois législatures à l’exécutif de la Commune d’Onex. Cela correspond à son très fort désir de rester au contact de la réalité. Socialiste certes, mais pragmatique.
René Longet
Aller à l’essentiel. Repères pour notre temps
Entretiens avec Sandra Widmer Joly
Bière-Nîmes, Cabédita-Riresc 2016, 104 p.
Anne Deshusses-Raemy, François Xavier Amherdt, Parole à goûter. Itinéraire catéchétique pour adultes: la Samaritaine
L’ouvrage propose un intéressant itinéraire catéchétique pour adultes, en neuf étapes, construit en dialogue avec le texte de la Samaritaine (Jn 4,1-42). Cet itinéraire s’adresse à «des adultes qui cherchent à nourrir leur foi et qui ont soif de la Parole». Des adultes qui sont donc invités à une perspective catéchétique en vue de leur propre maturation et non de l’accompagnement de leurs enfants. Voilà qui est salutaire : les adultes sont rarement considérés «pour eux-mêmes», alors que les ouvrir à la Parole et leur permettre de construire une réelle stature de foi est, aujourd’hui plus que jamais, une urgence.
Depuis la disparition du Journal de Genève, pour lequel il a travaillé durant quinze ans, Thierry Mertenat est journaliste à la Tribune de Genève. Il y assume les reportages culturels ainsi que les « faits divers », la plupart du temps à partir des clichés du photographe de garde. N’étant pas sportif, souffrant de claustrophobie et de vertige, il exerce son métier de façon plutôt sédentaire. Il ne se sentait donc aucunement prédestiné à devenir pompier, avertit-il.
Mais lors d’une représentation du Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, en 1995, il revit l’incendie de l’immeuble dans lequel habitait sa famille....
Thierry Mertenat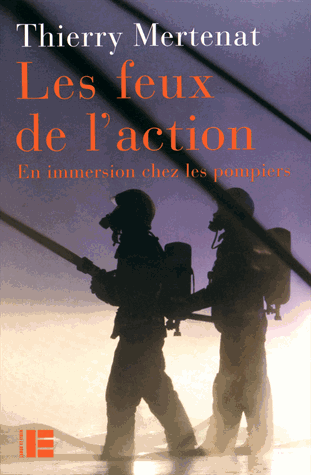 Les feux de l’action : En immersion chez les pompiers
Les feux de l’action : En immersion chez les pompiers
Genève, Labor et Fides/Favre 2016, 258 p.
Plus...
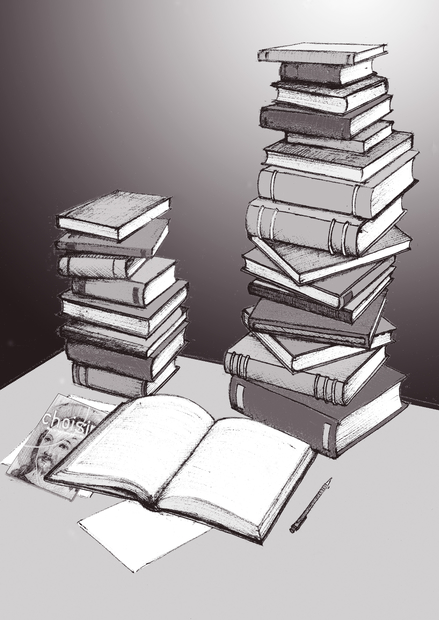 JÉSUITES
JÉSUITES
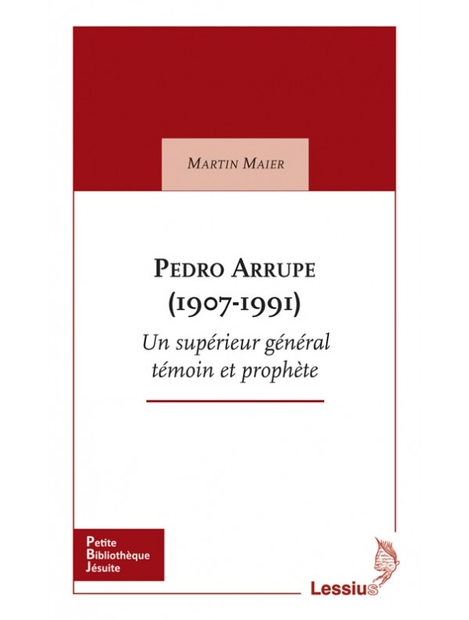 Martin Maier
Martin Maier
Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général, témoin et prophète
Paris, Éditions jésuites 2016, 110 p.
Le Père Pedro Arrupe a été un des acteurs les plus marquants du renouveau de l’Église au XXe siècle. Jésuite, supérieur général de son Ordre de 1965 à 1991, membre du concile Vatican II, il a été mêlé de près aux grands bouleversements religieux, sociaux et politiques qui ont conditionné l’évolution de l’Église catholique dans sa relation au monde contemporain. L’inculturation de la foi, l’affirmation du lien entre la foi et l’engagement pour la justice, une vision pastorale plus universelle, un dialogue ouvert avec l’athéisme, la théologie de la libération, l’option préférentielle pour les pauvres, la création d’un service en faveur des réfugiés, l’intensification du dialogue œcuménique et interreligieux, Arrupe s’est engagé sur tous les fronts. Vrai prophète, il a eu la lucidité et l’audace d’anticiper, au risque d’inquiéter les plus hautes instances de l’Église qui ne lui ont épargné ni critiques ni mesures vexatoires. Au moment de l’épreuve comme au cours de sa dernière maladie, il a fait preuve d’une immense patience et d’un indéfectible optimisme, soutenu par son amour du Christ et de l’Église et une vie spirituelle – mystique – intense, nourrie par les Exercices spirituels.
D’origine basque, comme Ignace de Loyola, solidement enraciné dans la spiritualité ignatienne, le Père Arrupe a réformé et dynamisé la Compagnie de Jésus. En la ramenant à ses sources, il l’a sortie, non sans résistances, de certains vieux schémas, pour l’introduire de manière plus décisive et audacieuse dans le monde contemporain.
L’auteur de cet excellent petit livre a su dégager l’essentiel de la pensée d’Arrupe, en esquissant à grands traits un portrait fidèle de ce jésuite qui a marqué de son empreinte non seulement l’histoire de la Compagnie de Jésus, mais aussi celle de l’Église catholique à une époque particulièrement turbulente.
En terminant sa lecture, on se prend à désirer voir paraître un jour en français une biographie complète de cette personnalité d’exception qui, avec d’autres protagonistes, incarne le renouveau de l’Église à la fin du XXe siècle.
Pierre Emonet sj
LITTÉRATURE
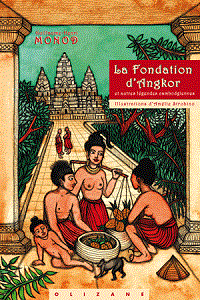 Guillaume-Henri Monod
Guillaume-Henri Monod
La Fondation d’Angkor et autres légendes cambodgiennes
Illustrations Amélie Stobino
Genève, Olizane 2016, 156 p.
Né le 1er janvier 1875 dans une famille protestante du canton de Vaud et établi en région parisienne depuis le début du XIXe siècle, Guillaume-Henri Monod (1875-1946) fit partie, à l’instar d’Auguste Pavie (cf. Contes populaires du Cambodge, du Laos et du Siam) de ces érudits que l’administration coloniale française envoya en Indochine pour leurs compétences scientifiques. Leur culture dépassait largement leur simple spécialité, et leur curiosité et leur intérêt pour les populations locales ont sauvé de l’oubli la culture populaire des contes.
Ceux-ci lui sont racontés par un certain gouverneur Khieu. Ils embrassent toute la psychologie humaine avec ses vices et ses vertus. Quant à la construction des temples d’Angkor, les dieux reconnaissent la puissance supérieure des humains pour une construction pérenne. Ils favorisent leur formation. « Un homme qui sait sans maître est comparable à un aveugle. » Cela fait penser aux « Artisans d’Angkor », une association qui forme aujourd’hui les jeunes à différents arts et artisanats de qualité.
Marie-Thérèse Bouchardy
SOCIÉTÉ
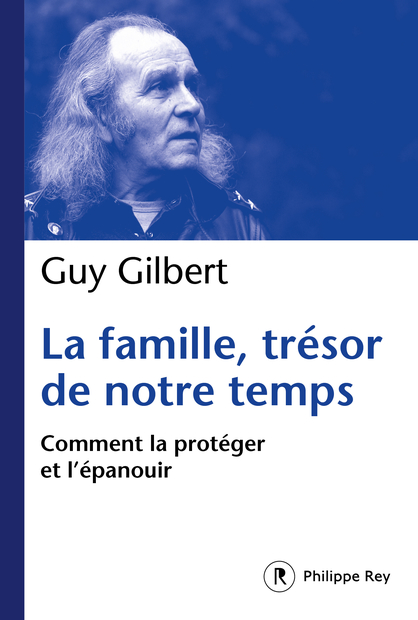 Guy Gilbert
Guy Gilbert
La famille, trésor de notre temps
Comment la protéger et l’épanouir
Paris, Philippe Rey 2016, 96 p.
La famille mérite un intérêt décuplé dans l’univers complexe actuel. Par son don d’observation, de lucidité et d’analyse, Guy Gilbert porte une vision globale positive en écartant certaines embûches. En particulier, le manque d’écoute et la place exagérée du numérique : « L’individu fuit dans des territoires virtuels. »
Les titres des chapitres indiquent l’orientation : Un lieu fait pour l’Amour, Réussite et échec des couples, Quand la famille fait grandir, Grands-parents, vous êtes irremplaçables. Tous les sujets discutés en public ou à l’intime prennent un aspect positif. Les difficultés existent ; les repérer facilite un accès à une autre vie. Divorcés remariés, homosexualité, mariage pour tous, opposition des ados, dérive d’un conjoint... autant de situations délicates, susceptibles de comportements apaisants. En fin du livre, un chapitre agréable, avec ces mots de Mgr Duval d’Alger : « L’amitié sacerdotale est le huitième sacrement. »
En forme de conclusion, une liste de conseils, dont « Sois toujours disponible pour tes enfants, qu’ils puissent t’approcher sans crainte de te déranger », souligne combien la famille demeure un trésor.
Willy Vogelsanger
BIBLE
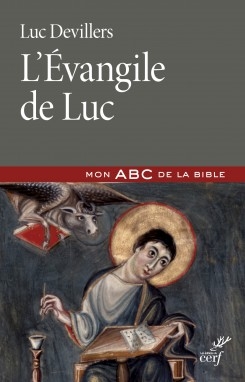 Luc Devillers
Luc Devillers
L’Évangile de Luc
Paris, Cerf 2016, 168 p.
À travers une lecture vivante et très accessible des principaux thèmes du troisième évangile, le dominicain Luc Devillers, qui enseigne le Nouveau Testament à l’Université de Fribourg, partage avec fougue sa passion pour les écrits de saint Luc.
Sans la connaissance du trésor lucanien, bien des éléments de la foi chrétienne, de la vie des Églises et de notre vie quotidienne demeureraient incompréhensibles. Pensons aux fêtes liturgiques, comme celle de l’Ascension et de la Pentecôte, ou aux services de secours qui, dans plusieurs pays, s’appellent Samaritain. Pensons encore à son impact dans l’art choral (Ave Maria, Magnificat...), aux tableaux de maîtres représentant l’Annonciation, la Visitation, l’Annonce aux bergers, le retour du Fils prodigue, les pèlerins d’Emmaüs...
À travers ses écrits, Luc apparaît comme un auteur doté d’une grande sensibilité, attiré par les petits, soucieux du salut des pécheurs, nous révélant un Dieu de tendresse proche dans nos détresses. Son style est imprégné de celui de la Septante ou de la plus élégante littérature grecque. Quelque 40 % de son texte lui sont propres.
Ce petit livre suit la tradition de la collection Mon ABC de la Bible en présentant un lexique très clair, notamment sur les « Personnages propres à l’Évangile de Luc », et de bonnes cartes de l’Empire romain et de la Palestine au temps de Jésus.
Monique Desthieux
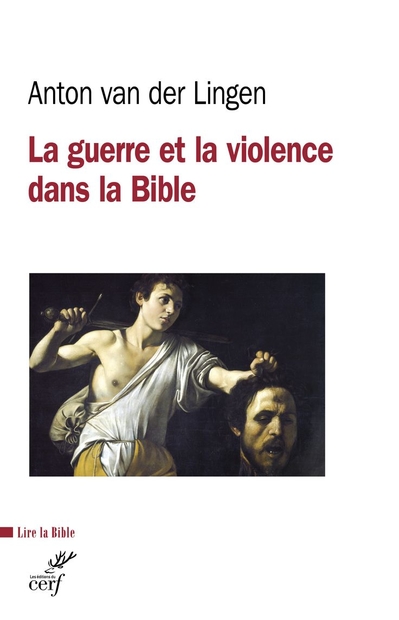 Anton van der Lingen
Anton van der Lingen
La guerre et la violence dans la Bible
Paris, Cerf 2016, 270 p.
Théologien protestant hollandais, l’auteur écrit, en un français agréable, un essai intéressant que j’actualiserais en posant cette question : y a-t-il dans la tradition judéo-chrétienne une place pour une « guerre sainte » ?
L’auteur parcourt et ausculte les principaux textes de l’Ancien Testament où la guerre est présente comme une réalité historique, et en tire des réflexions spirituellement nourrissantes. Certes, la guerre est présente, des têtes sont coupées, mais ces épisodes sont repris sous une lumière théologique : Israël est protégé et sauvé par son Seigneur. Cela ne sanctifie pas la guerre dans sa violence destructrice, mais dans ce danger extrême, croire en un Sauveur devient un acte de Foi, conditionné par l’état de religion d’une époque et d’un peuple donnés. Telle est donc la première partie de l’ouvrage.
La seconde partie n’est plus un choix de textes significatifs mais un exposé sur la meilleure façon de les interpréter, et sur l’esprit dans lequel il faut les lire. Or cet esprit est celui de l’Espérance, et l’espérance de l’auteur est celle d’un pacifiste. Mais d’un pacifiste pour qui la paix n’est pas essentiellement le résultat de tractations politiques ou de règlements juridiques, mais d’abord une libération intérieure qui crée les conditions d’une rencontre désarmante et désarmée avec l’Autre, et qui ouvre des perspectives toutes nouvelles : « La théologie de la liberté montre la Terre promise ; elle éclaire le sens du mot ‹ amour › qui est en soi libérateur, créatif et vif. » Vif comme ce livre à recommander.
Philibert Secretan
PHILOSOPHIE
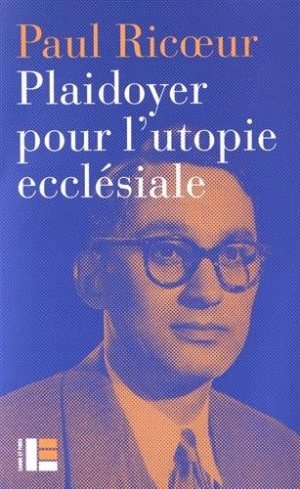 Paul Ricœur
Paul Ricœur
Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale
Conférence de Paul Ricœur (1967)
Genève, Labor et Fides 2016, 152 p.
Une fois de plus, la grande maison protestante Labor et Fides nous fait une surprise en publiant trois conférences inédites de Paul Ricoeur, tenues à Amiens en 1967, assorties des échanges qui les suivirent et d’une postface d’Olivier Abel et Alberta Romele qui les résume avec bonheur.
Si le titre Plaidoyer pour une utopie ecclésiale situe ce texte dans un registre de fidélité à l’utopie comme horizon d’espérance partagée en Église, le ton et l’argument sont donnés par la fin de la première conférence : « ...le protestantisme est à mes yeux ce lieu dans l’Église chrétienne, considérée comme un tout, où je peux vivre le plus authentiquement la dialectique entre la conviction et la responsabilité, la dialectique entre la mort de la religion et la réinterprétation de la foi. » Ce propos central s’enrichit par la suite de la dialectique de la Parole et du langage.
Dialectique signifie ici - dans ces réflexions sur l’Église présente au monde - une tension entre des pôles qui coexistent nécessairement et se conditionnent mutuellement, mais où l’écart de sens entre eux interdit toute conciliation ultime. La responsabilité (sociale et politique) n’abolira jamais la conviction (éthique et religieuse) ; la religion (du fait de sa tendance vers l’idolâtrie) n’absorbera jamais la foi ; la théorie du langage n’effacera jamais l’élan poétique. Ce « jamais » implique que la critique est toujours à l’œuvre : comme acte d’obéissance à la « violence » de l’Évangile, comme dénonciation des «synthèses hâtives » et comme exigence de sobriété philosophique - comme dis-analogie contre la démystification savante et la démythologisation croyante.
Peut-être faut-il avoir ce minimum d’information pour aborder utilement un texte dont la valeur est de faire écouter Ricœur, de faire entendre une parole elle-même conçue à l’écoute de la Parole et exemplairement inscrite dans la tension entre inspiration et raison.
Philibert Secretan
THÉOLOGIE
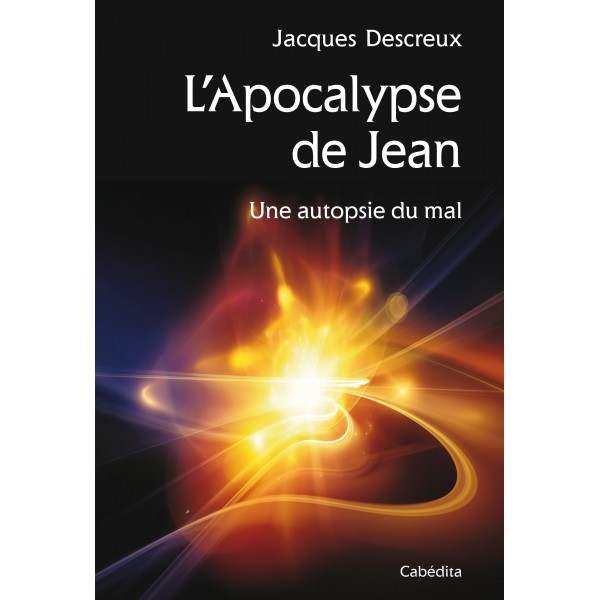 Jacques Descreux
Jacques Descreux
L’Apocalypse de Jean
Une autopsie du mal
Bière, Cabédita 2016, 94 p.
Sachant Dieu omniscient et omnipotent, de nombreux croyants sont désarçonnés par la présence du mal en ce monde et se demandent : « Pourquoi tolère-t-il cela ? » En effet, « les atrocités du XXe siècle, depuis les millions de morts de la Première Guerre mondiale jusqu’au génocide rwandais, ont instruit le procès de Dieu (...) bon et tout puissant ».
Analysant l’Apocalypse de Jean, Jacques Descreux expose le dessein divin, depuis la tentation d’Eve jusqu’à l’action constante du Malin, du Diable, de Satan dans notre monde. Personnifiant ce qui représente l’opposition au projet divin, le mal tente en permanence les humains, alimente leurs conflits et divisions : « Le mal survient à nos yeux de bien des manières : guerres, exclusions sociales, dictatures, atteintes aux personnes, pollution, extinction d’espèces animales, etc. » ; ou encore « dans l’expérience terriblement concrète de la souffrance (...) celle des autres ou celle que l’on éprouve »...
Comme « il est hors de portée des hommes d’éradiquer le mal », chacun est appelé à choisir son camp, dont l’opposition est figurée par l’antithèse biblique entre Babylone et Jérusalem. La voie juste se gagne à travers la résistance : sans tentation pas de mérite, pas de salut.
René Longet
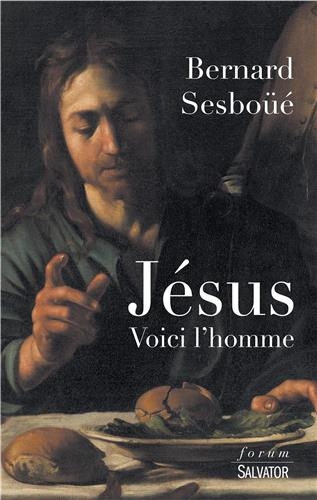 Bernard Sesboüé
Bernard Sesboüé
Jésus. Voici l’homme
Paris, Salvador 2016, 186 p.
Le Père jésuite Bernard Sesboüé a déjà beaucoup écrit sur le ministère du Christ en montrant comment ses disciples ont reconnu sa divinité. Il lui semblait important de montrer à présent que Jésus, en s’incarnant, s’adresse à nous à travers toute sa corporéité. Ses actions sont toujours des signes révélateurs de sa personne. Il n’y a pas la moindre distance entre ce qu’il dit et ce qui le fait. Jésus a pleinement accompli sa vocation humaine. Si Jésus avait été un homme médiocre, il n’aurait pas pu faire rayonner son caractère divin.
L’auteur a reconstitué une journée de Jésus. Qui est-il, cet homme vrai ? Quelqu’un qui a quitté sa famille, qui est devenu un « sans domicile fixe », enseignant le plus souvent dans les synagogues. Il secourt pauvres et souffrants et se retire seul pour prier son Père. Il s’entoure de disciples et d’un groupe de femmes qui donnent de leurs ressources, ce qui est assez original pour l’époque. Il se laisse approcher par tous les publics, ceux qui s’ouvrent à la foi, comme ceux qui l’agressent, le critiquent ou même veulent sa mort. C’est un homme de son temps, de plain-pied avec ceux qui le rencontrent. Il a des amitiés personnelles avec des femmes, et aussi des amitiés masculines. Jésus a bien partagé les affections humaines que nous connaissons tous.
L’auteur n’a pas manqué d’esquisser les quelques pages de l’Évangile où la violence de Jésus pourraient nous heurter, comme lorsque Jésus chasse les vendeurs du Temple ou quand il invective les pharisiens. Toutes ces scènes attestent la complète humanité de Jésus et la profondeur de sa sensibilité et de la passion qui l’habitent pour le service de son Père. Elles nous renvoient à la colère de Dieu dans l’Ancien Testament devant le refus de l’Alliance.
En de courts chapitres très accessibles, le grand théologien qu’est Bernard Sesboüé nous amène à mieux saisir et à admirer le comportement humain de Jésus, modèle de l’homme parfait.
Monique Desthieux
ÉGLISES
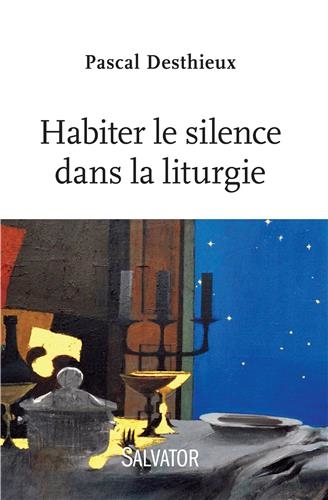 Pascal Desthieux
Pascal Desthieux
Habiter le silence dans la liturgie
Paris, Salvador 2016, 190 p.
En 2014, Pascal Desthieux, actuel vicaire épiscopal du canton de Genève (diocèse LGF), a écrit sa thèse sur Le silence dans la célébration de l’Eucharistie : une étude et une analyse des documents liturgiques d’après le concile Vatican II. Ce livre en est le résultat tout public.
« Dans la liturgie [...] le silence contribue à mettre en valeur un rite accompli, une parole proclamée, un geste effectué. » C’est de cette mise en valeur qu'il est question ici à partir de la pratique liturgique proposée par le Concile et le Missel actuel. De manière très concrète, l’auteur décrit les actions liturgiques et les temps de silence à proposer, qu’ils soient prescrits ou facultatifs.
On s’aperçoit vite que le silence, qu’il soit de recueillement, de méditation, de louange ou de prière tout simplement, est un outil liturgique indispensable au bon déroulement de toute célébration. Chaque chrétien présidant ou participant à celle-ci doit y être attentif, pour donner tous son sens à la liturgie. Car le silence liturgique dit quelque chose de l’Église et de son lien au Christ. Il est comme le sel et donne saveur à toute la messe.
L’auteur nous livre ainsi quelque chose d’intime dans sa manière de penser la liturgie.
Anne Deshusses-Raemy
POLITIQUE
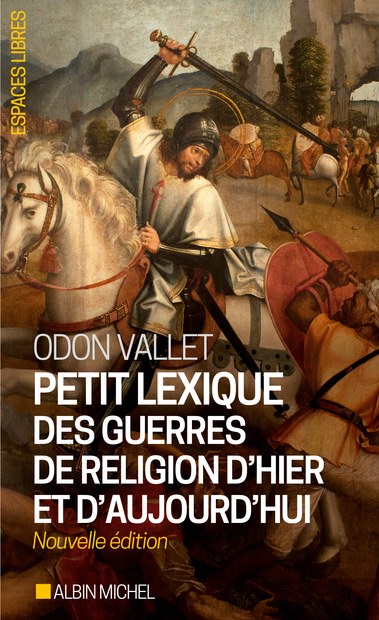 Odon Vallet
Odon Vallet
Petit lexique des guerres de religion d’hier et d’aujourd’hui
Nouvelle édition
Paris, Albin Michel 2016, 170 p.
Aujourd’hui, certains pensent qu’éradiquer les religions reviendrait à éradiquer les guerres. Or tout idéal d’une cause peut remplacer l’absolu de Dieu et mener à la guerre. Cet ouvrage s’en tient aux guerres liées à une religion traditionnelle et recense 41 conflits.
Il n’y a jamais de guerres purement de religion, elles sont toujours liées au contexte, historique, géographique, économique. Ce petit lexique alphabétique va d’Acétone au Vietnam, en passant par Calvin, les Croisades, l’Irlande, le Jihad, la Suisse et le concile Vatican I. Pourquoi Vatican I ? Car c’est au lendemain de la proclamation du dogme de l’infaillibilité papale qu’a éclaté la guerre franco-allemande et que les troupes italiennes entrèrent à Rome.
Et sous le mot Suisse, qu’allons-nous trouver ? Principalement le Sonderbund... En Suisse, les conflits religieux ont été très nombreux et il est intéressant de noter que le pays qui fournit la garde du pape est celui qui semble avoir le plus lutté contre l’Église catholique.
Ce Petit lexique n’est pas une somme complète, mais, par petites touches, il permet de comprendre qu’aujourd’hui, au XXIe siècle, les conflits l’emportent sur le dialogue, qu’il y a un renouveau de l’intégrisme et de la cruauté. La guerre est un exutoire aux passions refoulées.
Anne Deshusses-Raemy
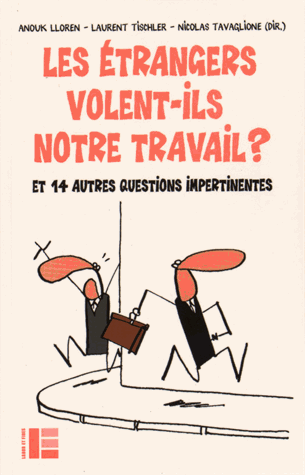 Sous la direction de
Sous la direction de
Anouk Lloren, Nicolas Tavaglione et Laurent Tischer
Les étrangers volent-ils notre travail ?
Et 14 autres questions impertinentes
Illustrations Mix et Remix
Genève, Labor et Fides 2016, 242 p.
Les auteurs, jeunes politologues de l’Université de Genève, se sont donné pour tâche de déconstruire en quinze chapitres les lieux communs sur les questions qui font débat aujourd’hui, dont Peut-on tout dire au nom de la liberté d’expression ? ou Les jeunes profitent-ils du chômage ? Les jugements à l’emporte-pièce, qui font le lit des populismes, sont passés au scanner de la raison sociologique.
Faisant le point sur ces questions, que des partis comme l’UDC mettent en avant, le livre apporte une vulgarisation raisonnée et raisonnable. Les sciences sociales comme modérateur de la discussion, tel est le choix des auteurs, que l’on ne peut que saluer, tant il éloigne les conflits stériles pour prendre le recul nécessaire lors d’un débat. Cela suffit-il à faire taire les a priori (pas toujours faux d’ailleurs) de café du commerce ?
Très agréable à lire, loin du jargon parfois confiné aux pairs universitaires, le livre pourrait faire état de statistiques plus récentes que celles citées sur la migration en Suisse par exemple (Office fédéral de la statistique, 2009). Et l’on peut regretter que sur une question comme L’aide humanitaire est-elle une nouvelle forme de colonialisme ?, on n’ait pas abordé les cas des (rares) pays non coloniaux (la Suisse, par exemple) et de leurs propres approches humanitaires. Mais on sortirait des lieux communs sur lesquels le livre prend appui aux fins de démythification...
Valérie Bory
BANDE DESSINÉE
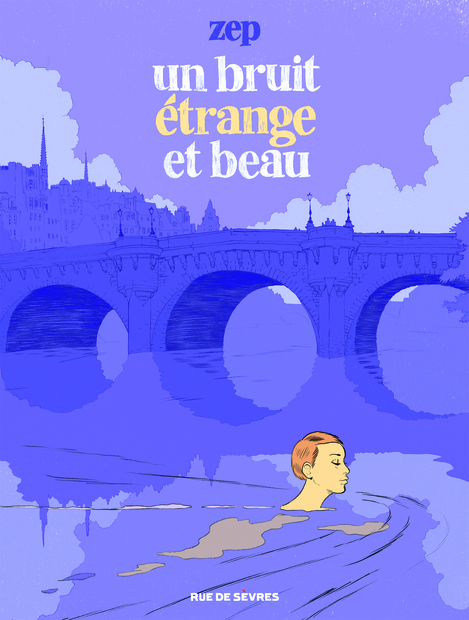 Zep
Zep
Un bruit étrange et beau
Voyage au pays du silence
Paris, Rue de Sèvres 2016, 96 p.
L’histoire est celle d’un chartreux qui sort d’un long silence sur demande de son supérieur. Il doit aller assister à l’ouverture du testament de sa tante. Cette dernière lui a légué une part de son patrimoine qui permettrait à une aile vétuste du monastère d’être rénovée. Il se rend donc à Paris, où il retrouve un cousin alcoolique et une cousine mélancolique qui, tout comme sa mère, n’a jamais compris le choix drastique de son cousin.
En chemin, le moine croise une femme. Jeune et séduisante, sans peurs, sauf celle de sa mort qui pourrait être imminente au vu de la maladie dont elle souf-fre. Le chartreux se laisse séduire, juste une nuit, avant de retourner se murer à la Valsainte. Le temps de goûter à une vie d’homme ordinaire et de repartir là où l’existence permet de s’habituer à sa fin terrestre en se détachant petit à petit de son emprise : « J’ai voulu croire en un Dieu plus fort qu’elle (la mort). J’ai fini par choisir une vie voisine de la mort », dira-t-il.
Ce récit séduisant laisse perplexe. Trop lisse, trop soigné, trop poétique pour sonner juste, il effleure le sujet plus qu’il ne l’empoigne. Le déroulé est lent, les images silencieuses et belles, mais l’intrigue a le souffle court. Et cède peu de place à la surprise. Cette bande dessinée laisse comme un goût d’inachevé. À l’image de ses personnages attachants, qui ont une vraie présence que le récit exploite mal.
Céline Fossati
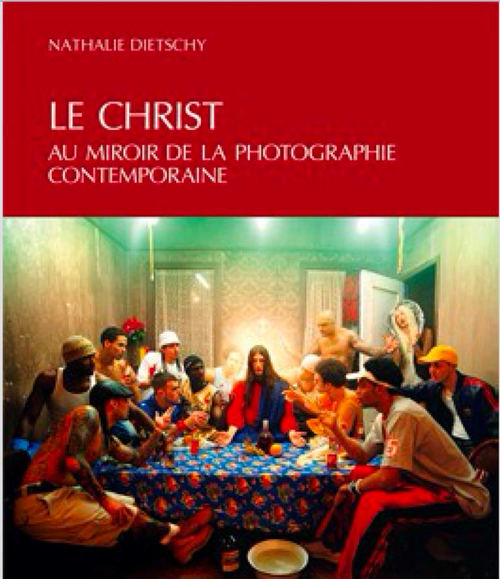 «Soyez Jésus.» L’incitation occupait toute la page du quotidien. Au bas, en petites lettres, rendez-vous était donné pour le casting d’un film à venir. Qui répondit à l’invitation? Probablement des hommes correspondant au modèle «stéréotypé» forgé par la peinture et le cinéma et inscrit dans la mémoire collective: homme barbu, la trentaine, cheveux longs, visage oblong...
«Soyez Jésus.» L’incitation occupait toute la page du quotidien. Au bas, en petites lettres, rendez-vous était donné pour le casting d’un film à venir. Qui répondit à l’invitation? Probablement des hommes correspondant au modèle «stéréotypé» forgé par la peinture et le cinéma et inscrit dans la mémoire collective: homme barbu, la trentaine, cheveux longs, visage oblong...
Nathalie Dietschy, Le Christ au miroir de la photographie contemporaine, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses 2016, 358 p.
Serge Molla est un connaisseur de la question des représentations iconographiques de Dieu. Cf. Serge Molla et Gilles Legrin, Dieu, otage de la pub, Genève, Labor et Fides 2008, 206 p.
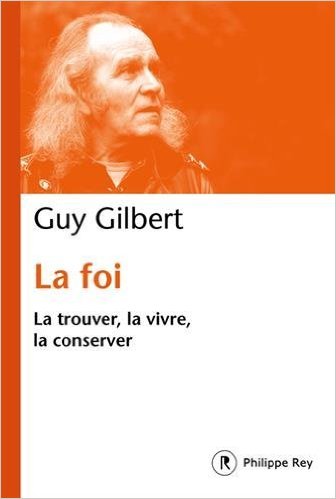 Bénéfique ce parcours proposé à travers un labyrinthe vers la rencontre avec Dieu invisible et mystérieux! «La foi consiste d'abord à se dire que Dieu m'aime avant que je L'aime moi-même.... La foi est un chemin escarpé... la foi est un risque....»
Bénéfique ce parcours proposé à travers un labyrinthe vers la rencontre avec Dieu invisible et mystérieux! «La foi consiste d'abord à se dire que Dieu m'aime avant que je L'aime moi-même.... La foi est un chemin escarpé... la foi est un risque....»
Guy Gilbert
La foi
La trouver, la vivre, la conserver
Paris, Philippe Rey 2016, 93 p.
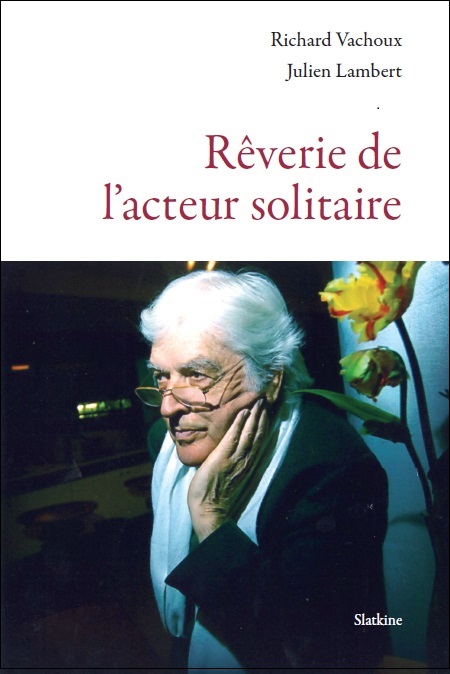 «Écris-moi», «prolonge-moi»... dit un jour l'homme de théâtre à son élève. Ces mots, ce dernier les a avalés et, suite à de nombreuses conversations, après des heures et des heures de réflexion, les a transcrits librement. Cette longue rêverie, divisée en 80 fragments, nous emporte du début à la fin, confie la préfacière Françoise Courvoisier. Alors, laissons-nous emporter et remercions l'élève - dont j'ai beaucoup aimé sa Messe sur le Monde1 - de nous offrir ce parcours.
«Écris-moi», «prolonge-moi»... dit un jour l'homme de théâtre à son élève. Ces mots, ce dernier les a avalés et, suite à de nombreuses conversations, après des heures et des heures de réflexion, les a transcrits librement. Cette longue rêverie, divisée en 80 fragments, nous emporte du début à la fin, confie la préfacière Françoise Courvoisier. Alors, laissons-nous emporter et remercions l'élève - dont j'ai beaucoup aimé sa Messe sur le Monde1 - de nous offrir ce parcours.
Richard Vachoux, Julien Lambert
Rêverie de l'acteur solitaire
Genève, Slatkine 2016, 178 p.
