
 Le missionnaire et sa mission suscitent beaucoup d’émotions, d’interprétations… et de malentendus. Comment s’y retrouver et, à fortiori, comment répondre à l’appel du pape d’organiser un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019? La bonne nouvelle, c’est que François s’est clairement positionné sur la question. Et avant lui saint Paul, et encore avant, le Christ!
Le missionnaire et sa mission suscitent beaucoup d’émotions, d’interprétations… et de malentendus. Comment s’y retrouver et, à fortiori, comment répondre à l’appel du pape d’organiser un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019? La bonne nouvelle, c’est que François s’est clairement positionné sur la question. Et avant lui saint Paul, et encore avant, le Christ!
Matthias Rambaud est coordinateur romand du Mois missionnaire extraordinaire chez Missio (Œuvres pontificales missionnaires en Suisse). Il est aussi entrepreneur et agent pastoral en formation.
Nécessaire et subtil discernement des esprits
Écrit par Pierre Emonet sj © Philippe Lissac/Godong
© Philippe Lissac/Godong
«Dialoguant avec un groupe de jésuites, lors de son voyage au Chili, le pape François a affirmé qu’actuellement, le plus grand besoin de l’Église est la pratique du discernement. Dénonçant une théologie fondée sur le permis et défendu, il a cité en exemple l’exhortation apostolique Amoris Lætitia “qui va dans une toute autre direction; sans entrer dans ce genre de distinctions, elle pose le problème du discernement”(1)», relate Pierre Emonet sj, directeur de la revue choisir dans un article paru dans les Cahiers de Spiritualité Franciscaine du mois de mars 2019 (n°23) que nous retranscrivons ci-dessous.
 Mosaïque du P. Rupnik sj © Centro AlettiQuand Dieu surgit et provoque un bouleversement radical dans une vie, un chemin de conversion s’impose alors. Pour s’ajuster à cette Présence, l’interpellé cherche à mieux l’entendre pour y répondre. Il s’adonne à une certaine discipline. Elle implique un style de vie dans le quotidien des jours. Un chemin d’initiation s’ouvre à lui. Il peut être austère. Il résonne toutefois de la paix et de la joie évangélique. L’appel à l’Alliance crée, modèle, nourrit, accompagne, régule et finalise son itinéraire. Elle donne à celui qui s’engage sur cette voie de s’épanouir en une vie nouvelle qui germe en et surgit du plus profond de lui. Celle-ci provoque un dépouillement libérateur qui ne va pas sans renoncements.
Mosaïque du P. Rupnik sj © Centro AlettiQuand Dieu surgit et provoque un bouleversement radical dans une vie, un chemin de conversion s’impose alors. Pour s’ajuster à cette Présence, l’interpellé cherche à mieux l’entendre pour y répondre. Il s’adonne à une certaine discipline. Elle implique un style de vie dans le quotidien des jours. Un chemin d’initiation s’ouvre à lui. Il peut être austère. Il résonne toutefois de la paix et de la joie évangélique. L’appel à l’Alliance crée, modèle, nourrit, accompagne, régule et finalise son itinéraire. Elle donne à celui qui s’engage sur cette voie de s’épanouir en une vie nouvelle qui germe en et surgit du plus profond de lui. Celle-ci provoque un dépouillement libérateur qui ne va pas sans renoncements.
 Alep © JRSAlors que la Syrie est dans sa neuvième année de guerre, le Liban peine à assumer le million et demi de réfugiés syriens qu’il accueille (935'454 selon les chiffres 2019 du HCR). Pays limitrophe, le Liban compte le plus grand nombre de réfugiés syriens par habitant et cette situation devient difficilement soutenable, ce qui a conduit les autorités à prendre des mesures délétères pour les réfugiés. Ces dernières devraient être mises en œuvre rapidement, ne laissant guère de temps aux migrants pour trouver un moyen de se sortir de la misère. Inquiet, le Père Nawras Sammour sj, directeur régional du JRS pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a publié une déclaration plaidant pour «Reconnaître les droits des réfugiés syriens au Liban».
Alep © JRSAlors que la Syrie est dans sa neuvième année de guerre, le Liban peine à assumer le million et demi de réfugiés syriens qu’il accueille (935'454 selon les chiffres 2019 du HCR). Pays limitrophe, le Liban compte le plus grand nombre de réfugiés syriens par habitant et cette situation devient difficilement soutenable, ce qui a conduit les autorités à prendre des mesures délétères pour les réfugiés. Ces dernières devraient être mises en œuvre rapidement, ne laissant guère de temps aux migrants pour trouver un moyen de se sortir de la misère. Inquiet, le Père Nawras Sammour sj, directeur régional du JRS pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a publié une déclaration plaidant pour «Reconnaître les droits des réfugiés syriens au Liban».
 «Comment la discipline fait-elle croître l’épanouissement, la sérénité et la foi dans le contexte de la vie monastique?» Cette question pertinente s’est mise à habiter ma réflexion et mon cœur, compris comme lieu des affects, mais aussi des souvenirs, des idées, des projets et des décisions. C’est là, dans cette profondeur, que s’enracine la discipline si elle ne veut pas courir le risque de devenir un échafaudage.
«Comment la discipline fait-elle croître l’épanouissement, la sérénité et la foi dans le contexte de la vie monastique?» Cette question pertinente s’est mise à habiter ma réflexion et mon cœur, compris comme lieu des affects, mais aussi des souvenirs, des idées, des projets et des décisions. C’est là, dans cette profondeur, que s’enracine la discipline si elle ne veut pas courir le risque de devenir un échafaudage.
 Contrairement à une idée reçue, la tradition spirituelle chrétienne se méfie de la discipline, qui «sent trop l’homme». Son programme pourrait se réduire à cette seule règle: faire de la place pour réserver bon accueil aux largesses du jour et répondre aux appels qui nous sont adressés à chaque instant.
Contrairement à une idée reçue, la tradition spirituelle chrétienne se méfie de la discipline, qui «sent trop l’homme». Son programme pourrait se réduire à cette seule règle: faire de la place pour réserver bon accueil aux largesses du jour et répondre aux appels qui nous sont adressés à chaque instant.
Théologien, journaliste et essayiste, Yvan Mudry est l’auteur de divers ouvrages à la frontière entre spiritualité et thèmes de société. Ainsi de L’Expérience spirituelle aujourd’hui. De l’exil au grand large (St-Maurice, Saint-Augustin 2016, 156 p.).
Un jour, alors que j’étais au noviciat et que nous évoquions l’ascèse, ma curiosité fut titillée et je sollicitai un entretien avec le maître des novices. Je lui demandai à quoi ressemblait la discipline, ce petit fouet dont j’avais entendu parler. Il me regarda un peu surpris, puis il sourit, se leva et revint avec une boîte…
Bruno Fuglistaller sj, Genève, accompagnateur spirituel; il est enseignant à l'Atelier œcuménique de théologie (AOT) à Genève.
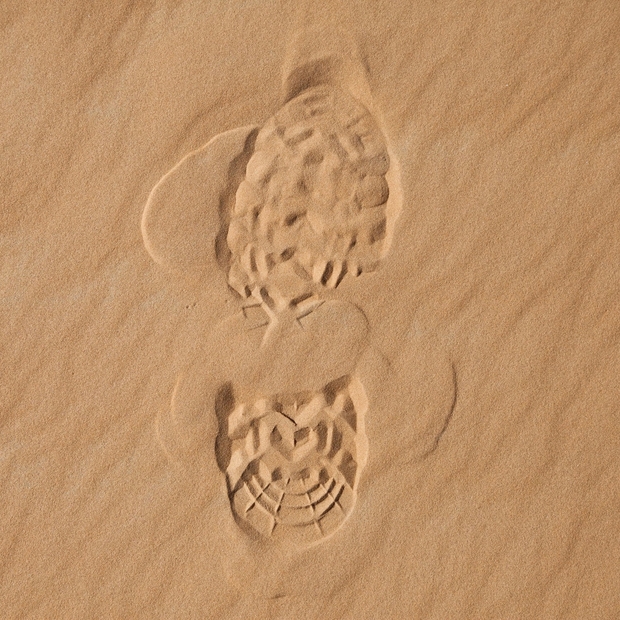 Le mythe de Sisyphe illustre l’absurde de l’éternel recommencement des cycles terrestres. Ainsi en est-il du venir et du partir. Comment trouver du sens dans notre monde? L’espérance chrétienne propose une rupture, l’offre d’un nouveau départ et une réconciliation finale. La parabole du fils prodigue nous y invite.
Le mythe de Sisyphe illustre l’absurde de l’éternel recommencement des cycles terrestres. Ainsi en est-il du venir et du partir. Comment trouver du sens dans notre monde? L’espérance chrétienne propose une rupture, l’offre d’un nouveau départ et une réconciliation finale. La parabole du fils prodigue nous y invite.
Jean-Blaise Fellay a été directeur spirituel des séminaires diocésains des évêchés de Lausanne, Genève et Fribourg et de Sion, professeur à l’Institut Philanthropos et rédacteur en chef de notre revue durant 14 ans. Il tient une chronique régulière sur jesuites.ch.
Plus...
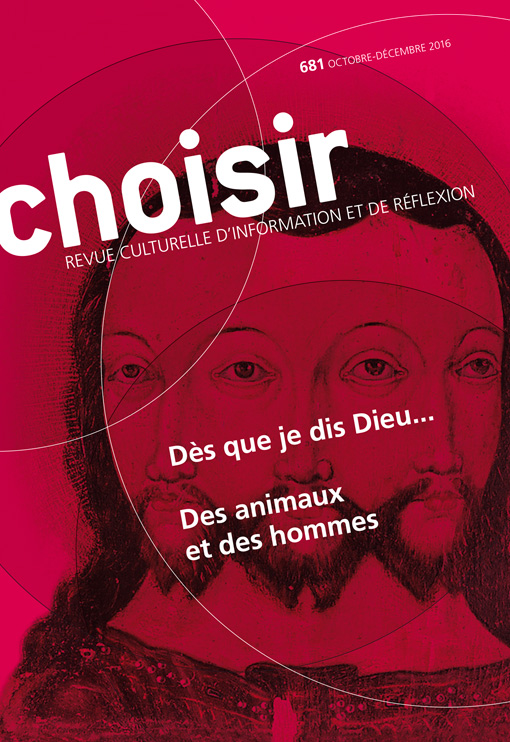 La fête de la Sainte Trinité est célébrée par les chrétiens le premier dimanche qui suit la Pentecôte. La doctrine trinitaire, qui est au cœur de la théologie chrétienne, est difficile à comprendre. Une plongée dans le Prologue de l’évangile de Jean, hymne de louange à un Dieu de relations, créateur par la parole, aide à l’appréhender. Les explications du philosophe et théologien Bernard Rordorf, professeur honoraire à la Faculté de théologie de Genève.
La fête de la Sainte Trinité est célébrée par les chrétiens le premier dimanche qui suit la Pentecôte. La doctrine trinitaire, qui est au cœur de la théologie chrétienne, est difficile à comprendre. Une plongée dans le Prologue de l’évangile de Jean, hymne de louange à un Dieu de relations, créateur par la parole, aide à l’appréhender. Les explications du philosophe et théologien Bernard Rordorf, professeur honoraire à la Faculté de théologie de Genève.
 Drapeaux de l'OIT © Crozet M./ILOLa présence d’un prêtre jésuite au sein du personnel du Bureau International du Travail (BIT), le secrétariat de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), n’est guère connue du grand public -encore moins le fait que le titulaire actuel de ce poste est l’héritier d’une décision prise en 1926- pas plus qu'on ne sait que ce prêtre est presque toujours de nationalité française. C'est pourtant le cas, aujourd’hui encore, puisque le Père Pierre Martinot-Lagarde sj est un jésuite français issu de la province d’Europe occidentale francophone (EOF).
Drapeaux de l'OIT © Crozet M./ILOLa présence d’un prêtre jésuite au sein du personnel du Bureau International du Travail (BIT), le secrétariat de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), n’est guère connue du grand public -encore moins le fait que le titulaire actuel de ce poste est l’héritier d’une décision prise en 1926- pas plus qu'on ne sait que ce prêtre est presque toujours de nationalité française. C'est pourtant le cas, aujourd’hui encore, puisque le Père Pierre Martinot-Lagarde sj est un jésuite français issu de la province d’Europe occidentale francophone (EOF).
Aurélien Zaragori est docteur en Histoire contemporaine de l'Université Lyon III/LARHRA. Un article en marge de notre dossier sur le Travail, édité à l'occasion des 100 ans de l'OIT.
Le mythe du déluge est-il vraiment universel ? Qu’est-ce qui relie et différencie les récits bibliques du déluge de ceux du monde mésopotamien ? Tout en répondant à ces questions, le professeur Thomas Römer a ouvert un champ d’interrogations passionnant, lors de sa conférence du 29 mars, à Genève. Cet éminent spécialiste de la Bible hébraïque, professeur au Collège de France et aux Universités de Genève et Lausanne, était l’invité de la revue choisir dans le cadre du Festival Histoire et Cité.
Retrouvez ici sa conférence. © Histoire et Cité, Mathias Popee.
 Un artisan sculpte une statue de Bouddha (Vietnam). © Fred de Noyelle/Godong À l’occasion de son centenaire célébré cette année, l’Organisation internationale du travail (OIT) a lancé un vaste mouvement de réflexion sur l’avenir du travail. Convaincue que ce dernier vise le bien-être matériel et spirituel de l’Homme, l’institution onusienne a très vite tissé des liens avec les religions. Lors d’une rencontre interreligieuse, organisée par le Saint-Siège en février dernier à l’OIT, le vice-président de l’Union bouddhiste de France, Michel Aguilar, a exposé une perspective bouddhiste de l’avenir du travail.
Un artisan sculpte une statue de Bouddha (Vietnam). © Fred de Noyelle/Godong À l’occasion de son centenaire célébré cette année, l’Organisation internationale du travail (OIT) a lancé un vaste mouvement de réflexion sur l’avenir du travail. Convaincue que ce dernier vise le bien-être matériel et spirituel de l’Homme, l’institution onusienne a très vite tissé des liens avec les religions. Lors d’une rencontre interreligieuse, organisée par le Saint-Siège en février dernier à l’OIT, le vice-président de l’Union bouddhiste de France, Michel Aguilar, a exposé une perspective bouddhiste de l’avenir du travail.
