
«La Nature aime à se cacher», disait déjà le philosophe Héraclite d’Éphèse à la fin du VIe siècle av. J.-C. Un aphorisme qui se prête bien à la recherche en physique des particules élémentaires. Prenons la matière noire. Invisible, elle composerait pourtant 27% de l’Univers (CERN). Petit tour dans la face «sombre» du cosmos avec Laura Baudis.
Laura Baudis est astrophysicienne et professeure de physique à l’Université de Zurich. Ses recherches portent sur la matière noire et la physique des neutrinos. Elle est impliquée dans les expériences liées aux détecteurs XENON. Elle a été membre du Comité scientifique du CERN de 2016 à 2018.
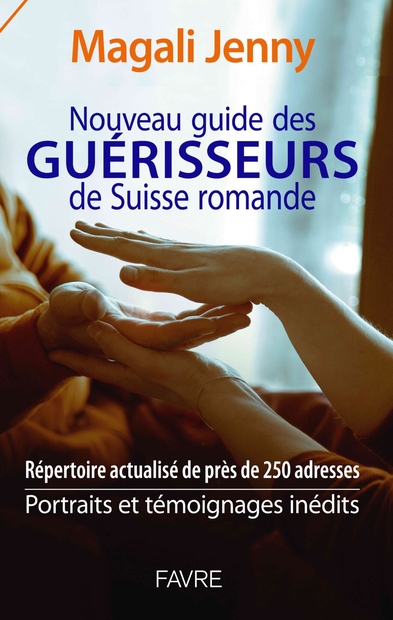 Un journaliste de la RTS l’a nommée «la Joël Dicker des guérisseurs» tant ses guides ont du succès et «sont nimbés de mystère». Une jolie formule pour dire que l’ethnologue Magali Jenny est lue par un large public et que son Nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande n’aura pas un succès moindre que le précédent auprès d’une large frange de la population.
Un journaliste de la RTS l’a nommée «la Joël Dicker des guérisseurs» tant ses guides ont du succès et «sont nimbés de mystère». Une jolie formule pour dire que l’ethnologue Magali Jenny est lue par un large public et que son Nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande n’aura pas un succès moindre que le précédent auprès d’une large frange de la population.
Ethnologue spécialisée en ethnomédecine -avec un mémoire de licence dédié aux guérisseurs fribourgeois-, anthropologie des religions, et collaboratrice scientifique au Tibet Museum à Gruyères, Magali Jenny est l’auteure du Guide des guérisseurs de Suisse romande (Favre), dont la dernière version vient de paraître avec un répertoire actualisé de près de 250 adresses (Lausanne, Favre 2021).
 Les gens qui se décrivent comme médiums, spirites ou voyants passent soit pour des personnes extraordinaires soit pour des malades soit pour des escrocs ou affabulateurs. Des études récentes montrent que, de fait, ils sont plus enclins que la population générale à vivre certaines expériences hallucinatoires - ce qui peut les amener à croire qu’ils communiquent véritablement avec les morts.[1]
Les gens qui se décrivent comme médiums, spirites ou voyants passent soit pour des personnes extraordinaires soit pour des malades soit pour des escrocs ou affabulateurs. Des études récentes montrent que, de fait, ils sont plus enclins que la population générale à vivre certaines expériences hallucinatoires - ce qui peut les amener à croire qu’ils communiquent véritablement avec les morts.[1]
Adam J. Powell est psychologue et chercheur (professeur assistant) au Département de théologie et de religion de l’Université de Durham. Spécialiste des mouvements religieux au XIXe siècle, ses recherches concernent les théories sociologiques de l’identité. Il est l’auteur de Hans Mol and the Sociology of Religion (Routledge, 2017).
 La justice restaurative prend de l’ampleur en Suisse, même si notre pays reste encore à la traîne par rapport à d’autres pays en Europe. Ces rencontres entre victimes et auteurs de délits reposent sur la circulation d’une parole réparatrice, corsetée par la justice pénale traditionnelle. Décryptage avec Claudia Christen, présidente du Swiss RJ Forum, un organisme mandaté pour mener à bien ces rencontres.
La justice restaurative prend de l’ampleur en Suisse, même si notre pays reste encore à la traîne par rapport à d’autres pays en Europe. Ces rencontres entre victimes et auteurs de délits reposent sur la circulation d’une parole réparatrice, corsetée par la justice pénale traditionnelle. Décryptage avec Claudia Christen, présidente du Swiss RJ Forum, un organisme mandaté pour mener à bien ces rencontres.
 Quand on entre dans un lieu qui semble vide, on est souvent amené à lancer à haute voix: «Il y a quelqu’un?» Et de constater: il n’y a personne. Le «quelqu’un» définit une identité quelconque. «Il n’y a personne» semble considérer qu’il n’y a aucun responsable à qui s’adresser. Petite excursion dans les arts et les mythes pour mieux cerner la différence entre la personne affirmée et sa réduction à quelque chose de vague, voire à l’état de chose.
Quand on entre dans un lieu qui semble vide, on est souvent amené à lancer à haute voix: «Il y a quelqu’un?» Et de constater: il n’y a personne. Le «quelqu’un» définit une identité quelconque. «Il n’y a personne» semble considérer qu’il n’y a aucun responsable à qui s’adresser. Petite excursion dans les arts et les mythes pour mieux cerner la différence entre la personne affirmée et sa réduction à quelque chose de vague, voire à l’état de chose.
Gérald Morin a cofondé à Sion la Fondation Fellini pour le cinéma et a réalisé en 2013 le documentaire Sur les Traces de Fellini. Il a été durant près de dix ans le rédacteur en chef du magazine CultureEnJeu.
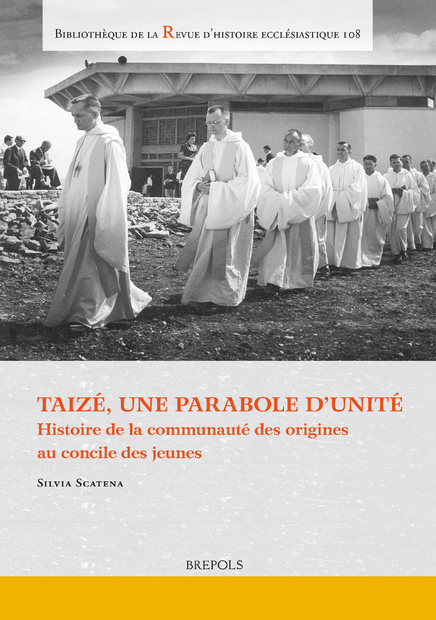 Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Modène et Reggio Emilia en Italie, Silvia Scatena nous livre une monumentale histoire de Taizé, depuis les origines jusqu’au concile des jeunes (1970-1974). S’appuyant sur des sources écrites, sur des archives et sur de nombreux témoignages recueillis auprès des frères anciens et d’autres personnes, l’historienne retrace avec beaucoup de précision la trajectoire de la communauté.
Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Modène et Reggio Emilia en Italie, Silvia Scatena nous livre une monumentale histoire de Taizé, depuis les origines jusqu’au concile des jeunes (1970-1974). S’appuyant sur des sources écrites, sur des archives et sur de nombreux témoignages recueillis auprès des frères anciens et d’autres personnes, l’historienne retrace avec beaucoup de précision la trajectoire de la communauté.
Les fausses couches tardives et les naissances d’un enfant en fin de vie ou déjà mort sont des expériences traumatisantes. Des efforts ont été entrepris en Suisse pour gérer de façon plus délicate et sensible les problèmes et conflits qui surgissent lors de ces circonstances. L’attribution à ces enfants d’un nom légal en fait partie.
Alberto Bondolfi est un théologien catholique, professeur honoraire de la Faculté de théologie protestante de Genève. Il a été membre de diverses associations et commissions d’éthique, dont le Comité national d’éthique dans le domaine de la médecine humaine.
 Depuis 1988, la question du changement de nom -ou pas- des fiancés au moment de leur mariage et du nom de naissance que recevront leurs futurs enfants fait objet de débats à Berne. La dernière réforme du Code civil en 2013 a été suivie d’une nouvelle initiative parlementaire, sur laquelle la Commission juridique du National planche encore. Pourquoi tant de lenteurs, de difficultés à trouver une formule rassembleuse, claire et si possible simple? Parce que les questions qui se jouent autour du nom reflètent à la fois celles des identités personnelles et des valeurs d’une société, et qu’elles sont donc éminemment émotionnelles.
Depuis 1988, la question du changement de nom -ou pas- des fiancés au moment de leur mariage et du nom de naissance que recevront leurs futurs enfants fait objet de débats à Berne. La dernière réforme du Code civil en 2013 a été suivie d’une nouvelle initiative parlementaire, sur laquelle la Commission juridique du National planche encore. Pourquoi tant de lenteurs, de difficultés à trouver une formule rassembleuse, claire et si possible simple? Parce que les questions qui se jouent autour du nom reflètent à la fois celles des identités personnelles et des valeurs d’une société, et qu’elles sont donc éminemment émotionnelles.
Plus...
Alors qu’aujourd’hui l’un des critères principaux du choix du prénom d’un enfant semble être l’originalité, il en était tout autrement au Moyen Âge où sa fonction principale était d’être un vecteur d’appartenance, à la famille, à un territoire politique, à un statut social ou à l’Église.
Florian Besson, Port-Saint-Louis-du-Rhône (F), docteur en histoire médiévale et professeur d’histoire-géographie
On ne cesse, en Occident, d’évoquer la notion de dignité de la personne. Cette notion n’est pas sans receler quelque ambiguïté. La dignité est-elle intrinsèque à la personne ou doit-elle être acquise à force de performance et de raison, ce qui exclurait les plus vulnérables d’entre nous?
Bernard N. Schumacher dirige le pôle de recherche et d’enseignement «Vieillissement, éthique et droit» à l’Institut interdisciplinaire d’éthique et de droits de l’homme de Fribourg, dont il est le coordinateur. Il est l’auteur de L’éthique de la dépendance face au corps vulnérable (érès 2019).
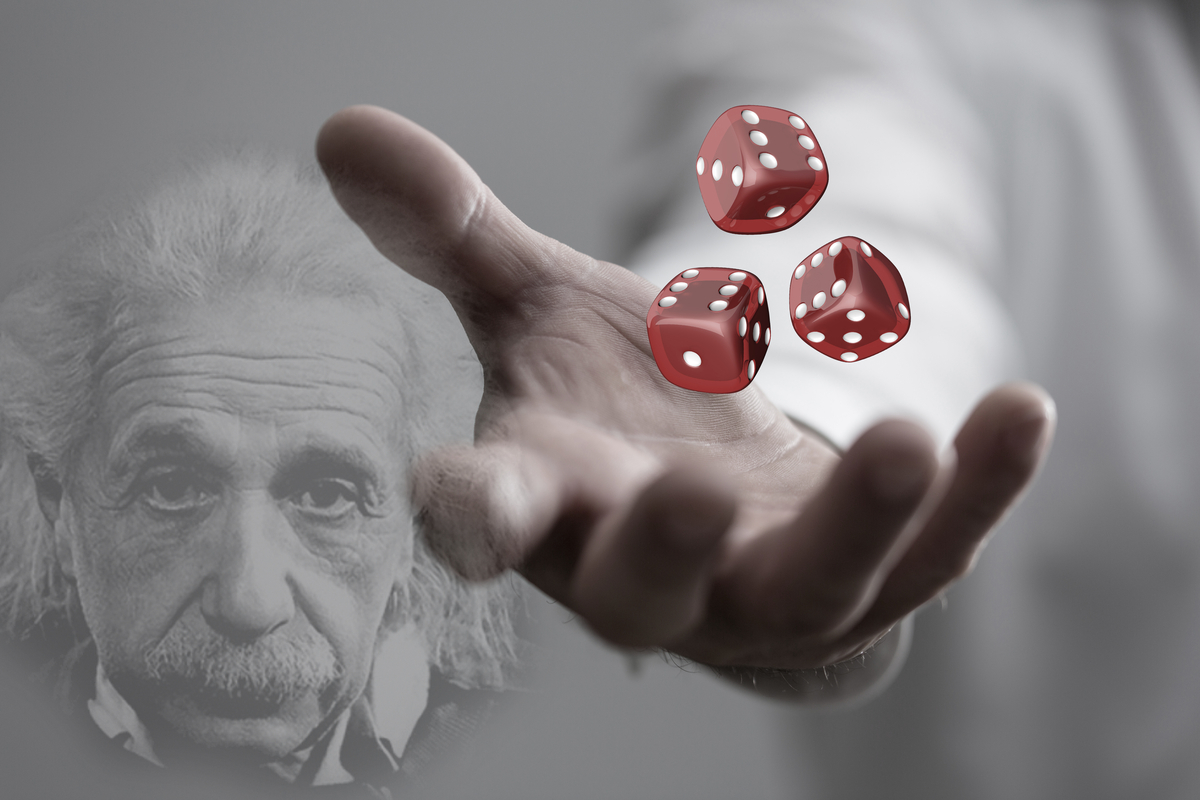 L'autorité de la science héritée d'Einstein paraît bien ébranlée. Le perfectionnement de l’armement, les armes de destruction massive, les produits chimiques aux effets toxiques, le détournement de la biologie pour affaiblir l’adversaire, bref, les horreurs dues aux «avancées» de la science appliquées à l'usage militaire -pour ne parler que d'elles- sont dans tous les esprits. Inutile d'insister. Je rappellerai simplement deux événements surgis dans le domaine scientifique qui ont ébranlé le postulat de la rationalité -et donc de la maîtrise possible- des phénomènes naturels.
L'autorité de la science héritée d'Einstein paraît bien ébranlée. Le perfectionnement de l’armement, les armes de destruction massive, les produits chimiques aux effets toxiques, le détournement de la biologie pour affaiblir l’adversaire, bref, les horreurs dues aux «avancées» de la science appliquées à l'usage militaire -pour ne parler que d'elles- sont dans tous les esprits. Inutile d'insister. Je rappellerai simplement deux événements surgis dans le domaine scientifique qui ont ébranlé le postulat de la rationalité -et donc de la maîtrise possible- des phénomènes naturels.
Les 34’517 rescapés de SOS Méditerranée
Elliot Guy et Lucienne Bittar La Semaine des droits humains 2021 de l’Université de Genève aborde la question des inégalités avec notamment ce titre évocateur: Fuir vers un monde meilleur. Mais à quel prix? Les regards ne peuvent que se tourner vers la mer Méditerranée... et la Manche. Caroline Abu Sa’Da, directrice de SOS Méditerranée, est une témoin-clé des drames qui se jouent chaque jour aux rives de l’Europe. Or elle le constate: la situation s’est aggravée. Renforcer la lutte contre les passeurs est bien sûr une nécessité. Mais sauver les vies de ceux qui s'embarquent dans ce périple, «porter assistance au plus grand nombre de personnes possible en mer, c’est un devoir légal et moral!», lance-t-elle.
La Semaine des droits humains 2021 de l’Université de Genève aborde la question des inégalités avec notamment ce titre évocateur: Fuir vers un monde meilleur. Mais à quel prix? Les regards ne peuvent que se tourner vers la mer Méditerranée... et la Manche. Caroline Abu Sa’Da, directrice de SOS Méditerranée, est une témoin-clé des drames qui se jouent chaque jour aux rives de l’Europe. Or elle le constate: la situation s’est aggravée. Renforcer la lutte contre les passeurs est bien sûr une nécessité. Mais sauver les vies de ceux qui s'embarquent dans ce périple, «porter assistance au plus grand nombre de personnes possible en mer, c’est un devoir légal et moral!», lance-t-elle.
