
Livres
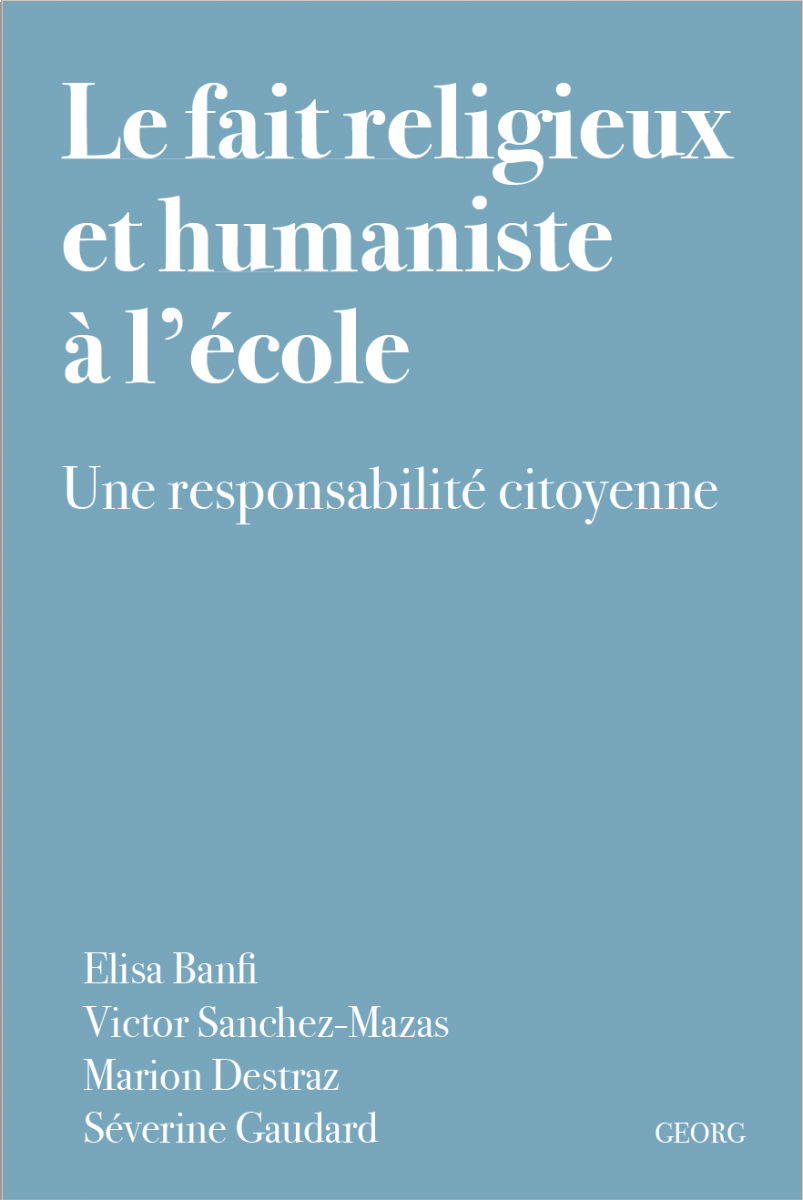 Cet ouvrage collectif raconte la passionnante aventure déployée sur près de 30 ans qui a conduit à la constitution du Groupe citoyen «Culture religieuse et humaniste à l’école laïque» à Genève (Groupe citoyen) et à l’inscription de l’article 11 dans la loi sur la laïcité de l’État acceptée par le peuple du bout du Lac, le 10 février 2019: «Dans le cadre de scolarité obligatoire au sein de l’école publique […], il est dispensé l’enseignement du fait religieux dans sa diversité.» Un livre qui est fort bien documenté et d’une grande clarté. Pour ce faire, le Groupe citoyen a sollicité la collaboration de l’Institut d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève (InCite) pour lui confier ses archives à des fins d’évaluation et de mise à disposition du grand public.
Cet ouvrage collectif raconte la passionnante aventure déployée sur près de 30 ans qui a conduit à la constitution du Groupe citoyen «Culture religieuse et humaniste à l’école laïque» à Genève (Groupe citoyen) et à l’inscription de l’article 11 dans la loi sur la laïcité de l’État acceptée par le peuple du bout du Lac, le 10 février 2019: «Dans le cadre de scolarité obligatoire au sein de l’école publique […], il est dispensé l’enseignement du fait religieux dans sa diversité.» Un livre qui est fort bien documenté et d’une grande clarté. Pour ce faire, le Groupe citoyen a sollicité la collaboration de l’Institut d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève (InCite) pour lui confier ses archives à des fins d’évaluation et de mise à disposition du grand public.
 Emmanuel Rolland et Henry Fauche ont eu l’heureuse initiative de convaincre Francine Carrillo de publier quelques-unes de ses prédications. Ce livre sera donc une piqûre de rappel pour celles et ceux qui les ont entendues et une ouverture à la méditation pour les autres. Dans la fidélité à l’Évangile, elle nous incite à «inventer et non pas simplement répéter ce que (nous avons) entendu» dans la promesse d’un Sens sans cesse renouvelé. Ces méditations bibliques s’articulent autour de neuf mots, accompagnés chacun par une calligraphie hébraïque, œuvre de l’auteure.
Emmanuel Rolland et Henry Fauche ont eu l’heureuse initiative de convaincre Francine Carrillo de publier quelques-unes de ses prédications. Ce livre sera donc une piqûre de rappel pour celles et ceux qui les ont entendues et une ouverture à la méditation pour les autres. Dans la fidélité à l’Évangile, elle nous incite à «inventer et non pas simplement répéter ce que (nous avons) entendu» dans la promesse d’un Sens sans cesse renouvelé. Ces méditations bibliques s’articulent autour de neuf mots, accompagnés chacun par une calligraphie hébraïque, œuvre de l’auteure.
Chaque trimestre, la revue choisir présente une sélection de recensions d'ouvrages.
 Anne Brécart
Anne Brécart
La Patience du serpent
Chêne-Bourg, Zoé 2021, 190 p.
James H. Cone. La théologie noire américaine de la libération
Écrit par Stjepan Kusar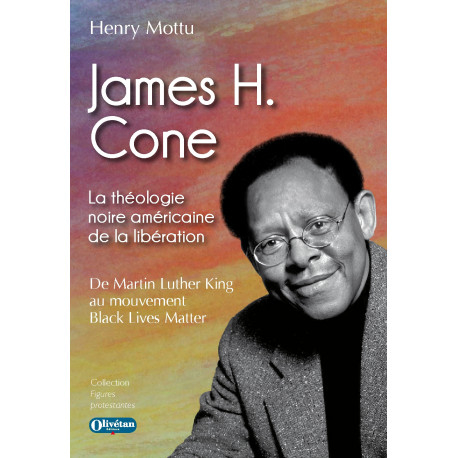 Henry Mottu
Henry Mottu
James H. Cone. La théologie noire américaine de la libération
De Martin Luther King au mouvement Black Lives Matter
Lyon, Olivétan 2020, 160 p.
En bon connaisseur de la théologie protestante aux États-Unis, Henry Mottu, pasteur et professeur honoraire de la Faculté de théologie de l’Université de Genève, offre une présentation claire et bien documentée d’un des représentants les plus connus de la théologie noire américaine de la libération: James H. Cone (1936-2018).
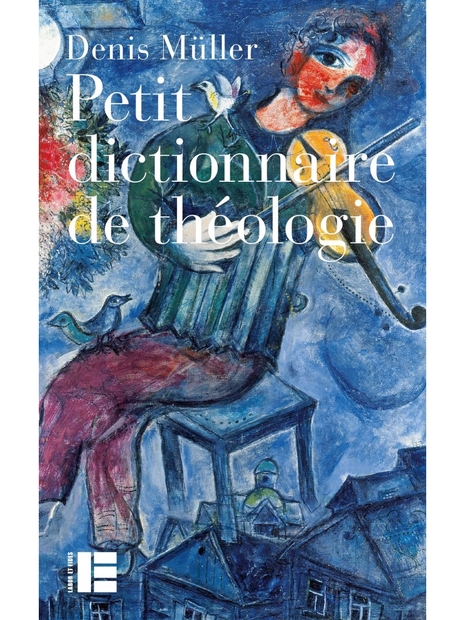 Denis Müller
Denis Müller
Petit dictionnaire de théologie
Genève, Labor et Fides 2021, 255 p.
Feuilleter un dictionnaire par pur plaisir? Peu d’entre nous le feront… Pourtant ce « petit dictionnaire » en vaut la peine.
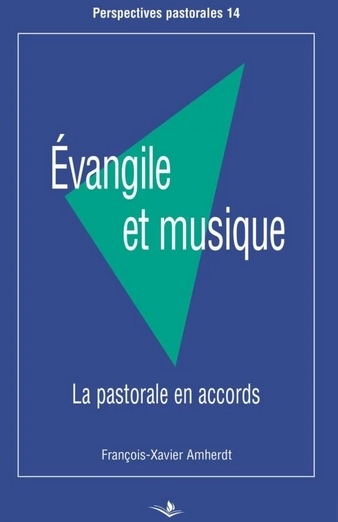 François-Xavier Amherdt
François-Xavier Amherdt
7 jours - 7 dons - 7 béatitudes
Zurich /Wien/ Münster, LIT Verlag 2021, 114 p.
À chacun des sept jours de la semaine, l’auteur, professeur de théologie pastorale et de pédagogie religieuse à l’Université de Fribourg, associe une béatitude et un don de l’Esprit saint.
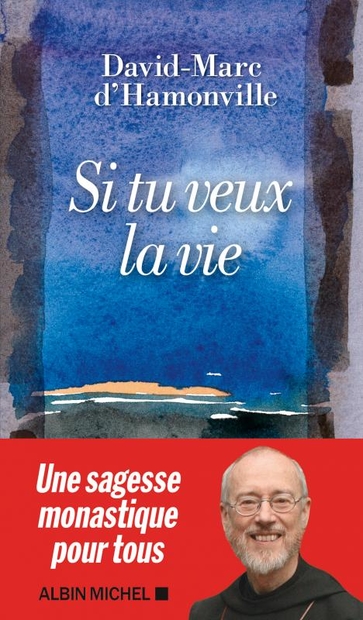 David-Marc d’Hamnonville
David-Marc d’Hamnonville
Si tu veux la vie
Paris, Albin-Michel 2021, 272 p.
L’auteur, peintre, poète et depuis de nombreuses années moine bénédictin, a cherché à s’unifier de plus en plus en suivant la Règle qu’il aime, celle de saint Benoît. Ce trésor de sagesse, il a voulu le partager avec son neveu Télio, en proie à des difficultés dans sa vie professionnelle et de jeune papa.
Plus...
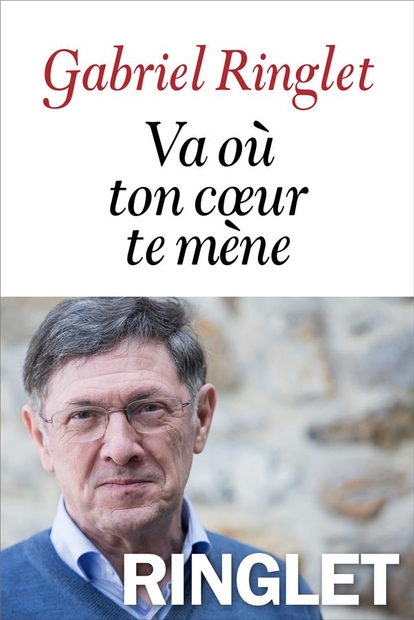 Gabriel Ringlet
Gabriel Ringlet
Va où le cœur te mène
Paris, Albin Michel 2021, 160 p.
C’est dans la fabuleuse histoire du prophète Elie -d’une modernité sidérante!- que nous entraîne Gabriel Ringlet, avec ce récit d’une naissance à la vie spirituelle, tissé autour du poème de la montagne (ou le poème de l’Horeb). Voilà Elie à la recherche d’un «Dieu-poème» afin de «changer de Dieu»!
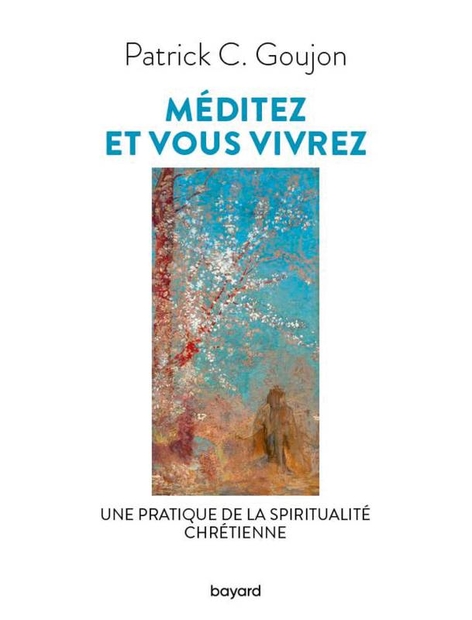 Patrick C. Goujon
Patrick C. Goujon
Méditez et vous vivrez
Une pratique de la spiritualité chrétienne
Paris, Bayard 2021, 192 p.
Que faire quand tout semble voler en éclat et le sol se dérober sous nos pas? La méditation ne résout pas ces crises, mais elle nous aide à devenir des hommes et des femmes capables de répondre et d’agir.
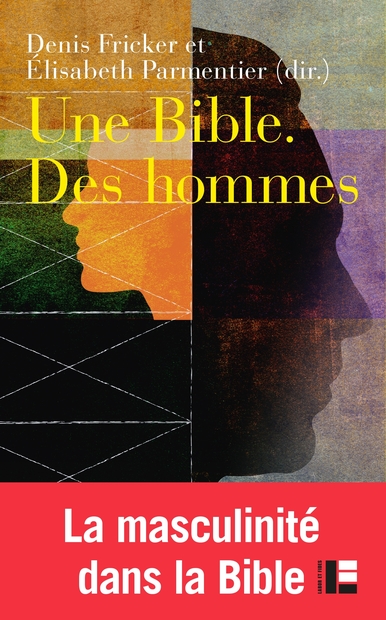 Denis Fricker et Élisabeth Parmentier (dir.)
Denis Fricker et Élisabeth Parmentier (dir.)
Une Bible. Des hommes
Genève, Labor et Fides 2021, 256 p.
Voici un livre original, qu’il ne faut pas lire à la suite, mais en choisissant tel ou tel chapitre. Il s’agit, en effet, de «regards croisés sur le masculin dans la Bible», écrits en tandems mixtes et œcuméniques, ce qui rend la lecture passionnante et parfois amusante.
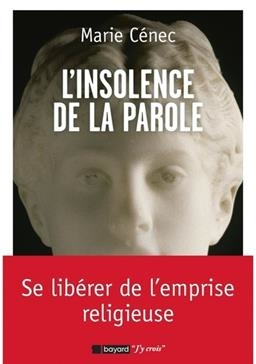 Marie Cénec
Marie Cénec
L’insolence de la Parole
Paris, Bayard 2020, 104 p.
Marie Cénec, théologienne et pasteure, nous offre un livre-témoignage sur l’évolution de sa foi: le «passage de la contrainte à la liberté de croire», l’évolution d’une «foi utilisée pour prendre le pouvoir sur les consciences et sur les corps» des milieux évangéliques extrêmes, à une voix de liberté des textes bibliques.
