
Eglises
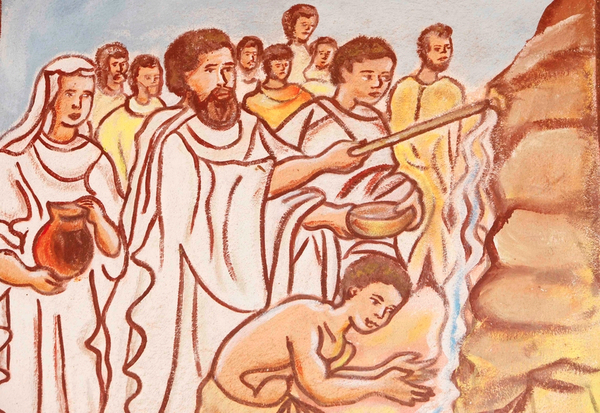 Quelle place a l’Église dans la sphère politique? La question se pose avec acuité en Suisse depuis la votation sur l'initiative pour des entreprises responsables, en novembre 2020. Mais pour le théologien allemand Norbert Mette, professeur émérite de théologie pratique à l’Université de Dortmund, le livre de l'Exode déjà l'indique clairement: la foi dans le Dieu de la vie implique la lutte contre l’injustice et pour la solidarité. Assumer cette responsabilité, est-ce faire de la politique? Et quel rapport avec la mystique? Entretien.
Quelle place a l’Église dans la sphère politique? La question se pose avec acuité en Suisse depuis la votation sur l'initiative pour des entreprises responsables, en novembre 2020. Mais pour le théologien allemand Norbert Mette, professeur émérite de théologie pratique à l’Université de Dortmund, le livre de l'Exode déjà l'indique clairement: la foi dans le Dieu de la vie implique la lutte contre l’injustice et pour la solidarité. Assumer cette responsabilité, est-ce faire de la politique? Et quel rapport avec la mystique? Entretien.
«L’Église connaît un véritable effondrement»
Écrit par Jean-Blaise Fellay sj Il est favorable à l’abandon du célibat des prêtres et à l’accession des femmes au sacerdoce. Historien de l’Église, ex-rédacteur en chef de la revue choisir et collaborateur actuel, Jean-Blaise Fellay sj porte un regard critique sur l’Église. Il a répondu sans détour aux questions de Laure Lugon du journal Le Temps sur le tabou de la sexualité, la misogynie et la culture du secret qui entoure l’homosexualité au sein de l’Église. Un article à lire dans son intégralité sur le site des Jésuites de Suisse (en cliquant ici) et sur celui du Temps.
Il est favorable à l’abandon du célibat des prêtres et à l’accession des femmes au sacerdoce. Historien de l’Église, ex-rédacteur en chef de la revue choisir et collaborateur actuel, Jean-Blaise Fellay sj porte un regard critique sur l’Église. Il a répondu sans détour aux questions de Laure Lugon du journal Le Temps sur le tabou de la sexualité, la misogynie et la culture du secret qui entoure l’homosexualité au sein de l’Église. Un article à lire dans son intégralité sur le site des Jésuites de Suisse (en cliquant ici) et sur celui du Temps.
 La proposition de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, de réduire de moitié le nombre de prêtres dans son diocèse, en particulier les prêtres étrangers qui forment aujourd'hui la moitié de l'effectif, soulève de bonnes questions, notamment celle du sens de la Mission et du cocktail nécessaire pour que celle-ci soit une réussite. Fuite des cerveaux, intégration des missionnaires dans les communautés locales ont été abordées dans notre édition d'octobre 2019, avec le Lucernois Martin Brunner-Artho, directeur de Missio, et le guinéen Comé Traoré, de la basilique Notre-Dame de Genève.
La proposition de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, de réduire de moitié le nombre de prêtres dans son diocèse, en particulier les prêtres étrangers qui forment aujourd'hui la moitié de l'effectif, soulève de bonnes questions, notamment celle du sens de la Mission et du cocktail nécessaire pour que celle-ci soit une réussite. Fuite des cerveaux, intégration des missionnaires dans les communautés locales ont été abordées dans notre édition d'octobre 2019, avec le Lucernois Martin Brunner-Artho, directeur de Missio, et le guinéen Comé Traoré, de la basilique Notre-Dame de Genève.
«Fratelli tutti: une conception chrétienne de l'homme»
Christian Rütishauser sj Samedi 3 octobre dernier, le pape François signait à Assise sa nouvelle encyclique Fratelli tutti. Dans un style direct, le Pontife appelle à plus de fraternité, et condamne les conséquences d'une mondialisation purement axée sur le profit, technocratique et néolibérale. Provincial des jésuites de Suisse, Christian Rutishauser sj propose une lecture humaniste de Fratelli tutti, un commentaire paru initialement en allemand sur le site feinschwarz.net.
Samedi 3 octobre dernier, le pape François signait à Assise sa nouvelle encyclique Fratelli tutti. Dans un style direct, le Pontife appelle à plus de fraternité, et condamne les conséquences d'une mondialisation purement axée sur le profit, technocratique et néolibérale. Provincial des jésuites de Suisse, Christian Rutishauser sj propose une lecture humaniste de Fratelli tutti, un commentaire paru initialement en allemand sur le site feinschwarz.net.
 Conseillé pour les questions socio-religieuses auprès du Bureau international du travail (OIT) à Genève, Pierre Martinot-Lagarde sj propose quelques clés pour mieux comprendre la nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti, publiée le 4 octobre 2020. Ce texte, pas toujours facile à comprendre, se présente comme une sorte de récapitulatif de la pensée sociale du pape François. En tant que tel, il ne comporte donc pas de nouveautés majeures, telles que celles qui figurent dans la précédente encyclique sociale Laudato si’.
Conseillé pour les questions socio-religieuses auprès du Bureau international du travail (OIT) à Genève, Pierre Martinot-Lagarde sj propose quelques clés pour mieux comprendre la nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti, publiée le 4 octobre 2020. Ce texte, pas toujours facile à comprendre, se présente comme une sorte de récapitulatif de la pensée sociale du pape François. En tant que tel, il ne comporte donc pas de nouveautés majeures, telles que celles qui figurent dans la précédente encyclique sociale Laudato si’.
Institution et communauté à l’épreuve en Hongrie et au Québec
Attila JakabLa pandémie a mis en évidence la fragilité des réseaux internationaux et l’inclination des politiques à se renfermer sur leurs engagements régionaux (plus positivement, à les renforcer). L’Église n’a pu se soustraire au mouvement. L’imprévisible a révélé la disparité locale énorme qui règne au sein d’une même confession religieuse, et la capacité ou l’incapacité de ses institutions nationales à répondre au défi. Une réflexion sous la loupe de la Hongrie et du Québec.
Attila Jakab, historien de l’Église et docteur de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, il est historien au Mémorial de la Shoah de Budapest. Il travaille dans le domaine du christianisme ancien et de l’antisémitisme ecclésiastique entre les deux guerres mondiales en Hongrie.
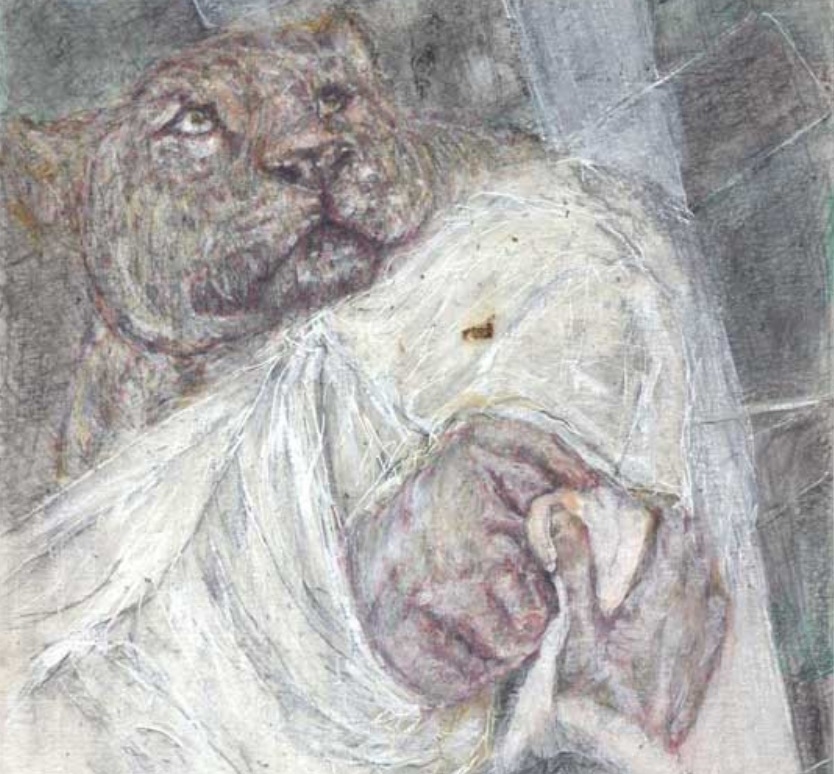 La fête de saint François d’Assise, protecteur des animaux, approche. En attendant le 4 octobre, quelques messes, cérémonies œcuméniques ou bénédictions destinées à l’animal trouvent leur place dans l'agenda de paroisses. Très engagé dans cette cause, l'abbé Olivier Jelen souligne que la supériorité de l’homme sur l’animal est un postulat culturel profondément ancré, bousculé par les connaissances scientifiques actuelles et les avancées de l’éthique, au point de remettre en cause le droit de manger des animaux (voir notre dossier Le malaise des carnivores). Le pape lui-même dénonce une vision anthropocentrique de la création et appelle à une conversion des consciences.
La fête de saint François d’Assise, protecteur des animaux, approche. En attendant le 4 octobre, quelques messes, cérémonies œcuméniques ou bénédictions destinées à l’animal trouvent leur place dans l'agenda de paroisses. Très engagé dans cette cause, l'abbé Olivier Jelen souligne que la supériorité de l’homme sur l’animal est un postulat culturel profondément ancré, bousculé par les connaissances scientifiques actuelles et les avancées de l’éthique, au point de remettre en cause le droit de manger des animaux (voir notre dossier Le malaise des carnivores). Le pape lui-même dénonce une vision anthropocentrique de la création et appelle à une conversion des consciences.
Un article publié in choisir n° 681, octobre 2016.
 Le pape François a dit vouloir une «présence féminine plus incisive» dans l'Église. Coup de théâtre en mai dernier, la théologienne Anne Soupa se porte candidate à la charge d'archevêque de Lyon. Depuis, le débat sur la place des femmes dans l’Église agite la chrétienté européenne. Regards croisés de la Fribourgeoise Marianne Pohl-Henzen et de la Genevoise Isabelle Hirt sur la question. Toutes deux très engagées au sein de l’Église, elles ont récemment été nommées à des postes importants par Mgr Morerod.
Le pape François a dit vouloir une «présence féminine plus incisive» dans l'Église. Coup de théâtre en mai dernier, la théologienne Anne Soupa se porte candidate à la charge d'archevêque de Lyon. Depuis, le débat sur la place des femmes dans l’Église agite la chrétienté européenne. Regards croisés de la Fribourgeoise Marianne Pohl-Henzen et de la Genevoise Isabelle Hirt sur la question. Toutes deux très engagées au sein de l’Église, elles ont récemment été nommées à des postes importants par Mgr Morerod.
Plus...
Dis-moi comment tu as vécu ecclésialement le confinement et je te dirai quelle image de l’Église et du Christ tu portes. La période que nous venons de vivre est très révélatrice, au sens photographique ou apocalyptique (dévoilement), de nos conceptions ecclésiales et théologiques. Elle manifeste des déséquilibres et provoque à la créativité, au nom même de Vatican II et du pape François.
François-Xavier Amherdt est professeur de théologie pratique à l’Université de Fribourg; il a été directeur de l’Institut romand de formation aux ministères laïques et vicaire épiscopal du diocèse de Sion. Il dirige les collections «Perspectives pastorales» et «Les cahiers de l’ABC». Il est l’auteur de nombre d’ouvrages, en particulier de pastorale. Dernier en date, Ce que dit la Bible sur le sport (Nouvelle Cité 2020).
 Le trajet qui conduit vers le Vitrocentre, au château de Romont, longe la Collégiale de la ville, un sublime édifice médiéval, doté d’un ensemble emblématique de vitraux du XIVe au XXe siècle. Les merveilles de cette église côtoyée durant trente ans m’ont procuré une sensation qui a profondément marqué ma perception des vitraux : ces œuvres d’art ne sont jamais les mêmes.[1]
Le trajet qui conduit vers le Vitrocentre, au château de Romont, longe la Collégiale de la ville, un sublime édifice médiéval, doté d’un ensemble emblématique de vitraux du XIVe au XXe siècle. Les merveilles de cette église côtoyée durant trente ans m’ont procuré une sensation qui a profondément marqué ma perception des vitraux : ces œuvres d’art ne sont jamais les mêmes.[1]
Stefan Trümpler est historien de l’art. Il a dirigé pendant une trentaine d’année le Vitrocentre Romont, Centre de recherche sur le vitrail et les arts du verre, ainsi que le Vitromusée de Romont. Il est chercheur et artiste. Cet article se base sur une contribution parue dans le Nike-Bulletin 1/2019, revue du Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE.
 Depuis le 27 mars, une cloche spéciale de la cathédrale de Lausanne résonne à 22h sur un rythme inhabituel, celui de l’alerte, comme au Moyen-Age. Cette urgence planétaire, faire front au coronavirus, en particulier par le confinement, a pour conséquence une prolifique effervescence créatrice, et pas seulement dans le milieu des arts et de la culture. Les initiatives pour rester en contact, pour partager de bons tuyaux et informations (et non des fakes news!), et surtout pour soutenir physiquement ou psychologiquement ceux qui en ont besoin se multiplient. Même les Églises, qui jouissent d’une réputation d’immobilisme, pas toujours fondée d’ailleurs, s’y sont mises.
Depuis le 27 mars, une cloche spéciale de la cathédrale de Lausanne résonne à 22h sur un rythme inhabituel, celui de l’alerte, comme au Moyen-Age. Cette urgence planétaire, faire front au coronavirus, en particulier par le confinement, a pour conséquence une prolifique effervescence créatrice, et pas seulement dans le milieu des arts et de la culture. Les initiatives pour rester en contact, pour partager de bons tuyaux et informations (et non des fakes news!), et surtout pour soutenir physiquement ou psychologiquement ceux qui en ont besoin se multiplient. Même les Églises, qui jouissent d’une réputation d’immobilisme, pas toujours fondée d’ailleurs, s’y sont mises.
 L'affaire de Jean Vanier est vécue avec douleur par les membres des communautés de l'Arche et par de nombreux catholiques. Elle pose des questions fondamentales en Église, dont celle-ci: comment garder son individualité, sa liberté, tout en s'inscrivant dans la tradition et en se permettant l'admiration? En faisant preuve de discernement pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. En ne transformant pas en icônes les grands témoins de la chrétienté, dont les catholiques, si malmenés aujourd'hui tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église, ont tant besoin.
L'affaire de Jean Vanier est vécue avec douleur par les membres des communautés de l'Arche et par de nombreux catholiques. Elle pose des questions fondamentales en Église, dont celle-ci: comment garder son individualité, sa liberté, tout en s'inscrivant dans la tradition et en se permettant l'admiration? En faisant preuve de discernement pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. En ne transformant pas en icônes les grands témoins de la chrétienté, dont les catholiques, si malmenés aujourd'hui tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église, ont tant besoin.
